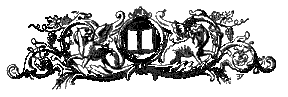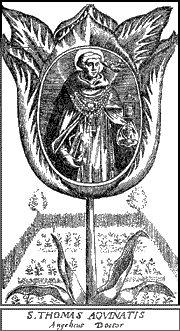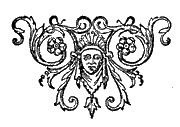| Chapitre V Le moyen Age et lAngéologie (395-1453)
Non seulement le Moyen Age a hérité des croyances des Pères de l'Église en matière d'angéologie, mais il a développé le thème par la littérature religieuse, par la peinture et la sculpture. Nous n'en retiendrons qu'un exemple entre beaucoup, celui du mystique dominicain, le peintre Giovanni da Fiesole, dit Fra Angelico ou le peintre des anges (1387-1455). Dans son uvre on retrouve à plusieurs exemplaires, l'Annonciation à Marie avec l'archange Gabriel, la Nativité avec des cohortes d'anges qui célèbrent la naissance du Sauveur; l'Assomption du Christ et celle de la Vierge avec la foule des anges qui exultent et chantent des hymnes de gloire, accompagnés de nombreux anges musiciens; les anges du Christ dans sa gloire, les anges de la Parousie, conduits par l'ange éclatant de lumière qui s'avance en portant la croix avec les anges qui sonnent de la trompette et ceux qui séparent les bons d'avec les méchants; des anges en prière, des anges sur des nuages, l'archange saint Michel en lutte avec le dragon et deux anges servant un repas aux dominicains. On le voit, Fra Angelico a bien mérité son surnom de peintre des anges; il est le représentant parfait de la conception que les fidèles du Moyen Age se faisaient du ministère des anges. Dans la littérature de l'époque on trouve quantité de récits relatant l'apparition et l'assistance d'anges gardiens ou protecteurs; en voici un exemple: Saint Isidore (1110-1170), patron des agriculteurs, avait déjà dans sa jeunesse une dévotion toute spéciale; il passait la plus grande partie de son temps en oraison; son père voulant en faire un bon agriculteur, l'envoie au champ pour le labourer; deux anges, sous la forme de vigoureux jeunes gens, viennent assister l'adolescent dans son travail afin qu'il soit exécuté plus rapidement et qu'Isidore puisse méditer et prier tout à loisir. Deux noms vont retenir notre attention en matière d'angéologie, exprimée par la plume: Saint Thomas d'Aquin et Dante.
SECTION 1
1. Saint Thomas d'Aquin et l'Angéologie.
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274) est considéré comme étant le plus grand théologien catholique; sa profonde science théologique lui a valu le titre de Docteur angélique et Ange de l'École. Il est l'auteur de la Somme théologique, dans laquelle nous trouvons un long chapitre consacré à l'étude de la création des anges, à leur nature et à leur ministère auprès des humains. Durant sa vie, Thomas d'Aquin fut bénéficiaire de visions angéliques et de communications avec des esprits et des saints, notamment avec l'esprit de sa sur, abbesse de Sainte-Marie et avec les apôtres Pierre et Paul. Au début de sa vie, le jeune Thomas fut en butte aux persécutions de sa famille et notamment de sa mère; la comtesse Théodora s'opposait à ce que, selon son désir ardent, le jeune homme prit l'habit de saint Dominique; comme Thomas persistait dans son idée, sa mère et ses frères le retinrent, pendant plusieurs mois, captif au château de Rocca-Secca; ne pouvant vaincre Thomas sur le terrain de la mystique pure, on imagina de le faire succomber par l'appel et l'éveil de la sensualité; on introduisit une femme de murs légères dans sa cellule; elle avait comme mission de le tenter et de le faire renoncer à ses vux de chasteté absolue. Voici comment le Chanoine Jules Didiot, l'historien de saint Thomas retrace l'événement: Le nouveau martyr de la chasteté voit soudain le vice apparaître au seuil de son cachot. D'abord il recule d'effroi; puis, par un mouvement d'inspiration divine, il saisit à son foyer, car c'était alors l'hiver, un tison enflammé. Il s'élance, il repousse cette vile courtisane. Il est vainqueur de ses ennemis, et de lui-même. Il est fidèle à son très pur et très unique amour de la Sagesse éternelle. Et pour attester sa victoire, revenant dans l'angle de sa prison, il trace sur la muraille, avec l'extrémité du tison, comme un chevalier avec son épée, un large et glorieux signe de croix. Devant cette croix, il se prosterne tout en larmes. Il demande à Dieu le don d'une virginité perpétuelle, supérieure à toutes les attaques. Un sommeil extatique s'empare de lui. Deux anges lui sont envoyés du ciel, qui le félicitent, l'assurent du bon succès de sa prière, et de la part de Dieu lui ceignent fortement les reins d'une ceinture de chasteté. La douleur qu'il en ressent lui arrache un cri et le réveille. Ses gardiens accourent: ils l'interrogent, mais inutilement. Il ne révélera que plus tard, et à son intime ami, le privilège qui, désormais, le met à l'abri des injurieux et diaboliques soufflets, dont le grand apôtre saint Paul se plaignit lui-même au milieu de ses révélations. En une autre occasion saint Thomas vit un ange qui lui montrait un livre merveilleux dont les lignes étaient d'or et d'azur; celles qui étaient d'or se rapportaient aux martyrs inscrits dans ce livre de vie. Alors qu'il était à Paris, lecteur en théologie, il lui fut ordonné de préparer sa leçon inaugurale de Docteur en théologie; Thomas, dans sa modestie, se juge indigne de recevoir un tel grade; il se met en prière et supplie qu'il soit délivré de ce fardeau du doctorat. Alors, un ange, messager céleste, ayant pris la forme d'un majestueux vieillard, revêtu de la robe des frères-prêcheurs, lui apparut et lui dit qu'il devait préparer sa leçon inaugurale et il lui indiqua même le thème qu'il devait développer au cours de son exposé. Alors qu'il était en passe de dicter ses commentaires sur les Epîtres de saint Paul qu'il appréciait particulièrement, lorsqu'il se trouvait momentanément embarrassé, il renvoyait ses scribes et, se mettant en prière, il était assisté par l'apôtre lui-même, qui lui donnait les éclaircissements nécessaires, et les aides rappelés, la dictée reprenait son cours lumineux. Un autre jour, arrêté par un passage d'Isaïe, qu'il était en train de commenter, il fit sortir son secrétaire le frère Raynald; celui-ci entendit son maître en conversation avec deux interlocuteurs rappelé par son maître, la dictée étant finie, le disciple insista pour savoir avec qui Thomas avait conversé. Celui-ci se refusa d'abord à satisfaire la curiosité de son disciple, mais il finit par lui dire que c'étaient les apôtres Pierre et Paul, et il lui fit jurer de ne parler du fait à personne tant qu'il serait en vie. Ayant composé une étude sur le Saint Sacrement, avant de 1e lire à ses frères, il déposa le cahier sur l'autel et proféra cette prière: Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes véritablement présent dans ce sacrement admirable, et qui opérez ici, divin ouvrier, beaucoup de merveilles que je désire comprendre et enseigner exactement; je vous prie et vous supplie, si ce que j'ai écrit à votre sujet est vrai et vient de vous, de daigner m'accorder la grâce de le bien dire et de l'exposer clairement. Si, au contraire, j'avais écrit quelque chose qui ne fût pas conforme à votre sainte foi, et qui ne répondît pas bien aux mystères de votre sacrement, empêchez-moi de dire le plus petit mot qui semblerait seulement s'écarter de la foi catholique. Le frère Raynald et d'autres religieux dominicains observaient le saint docteur durant cette prière; tout à coup, ils virer Jésus apparaître au-dessus du cahier; et le Maître des anges de dire: «Vous avez bien écrit touchant ce sacrement de mon corps vous avez fort bien et fort justement résolu la question que l'on vous a proposée, autant que l'intelligence humaine peut la comprendre et la résoudre sur la terre». Puis Thomas fut ravi, en extase et s'éleva d'une coudée au-dessus de terre. Vers la fin de sa vie, saint Thomas ayant été ravi en extase pendant un certain temps, déclara que tout ce qu'il avait vu était si indiciblement merveilleux et à tel point que tout ce qu'il avait écrit n'était que foin et paille. Et depuis lors, il cessa d'écrire au grand désespoir de ses disciples. Thomas fut également bénéficiaire de l'assistance de la Vierge Marie, la Reine des anges; il confia à ses frères dominicains «qu'il avait obtenu tout ce qu'il avait demandé par l'intercession de Marie, notamment la grâce de ne point quitter l'ordre dominicain». Thomas n'eut pas seulement la faveur de visions angéliques et divines, mais le démon vint également le troubler. Jean de Blasio raconte qu'un jour alors qu'ils se promenaient sur la terrasse du couvent à Naples, ils virent un fantôme ténébreux et vêtu de noir qui venait à leur rencontre; Thomas s'élança vers lui et le chassa; alors le fantôme diabolique disparut. Saint Thomas était habile à déceler les embûches du démon; un jour un frère ayant reçu une pâtisserie de la part d'un inconnu, la cacha dans sa cellule alors que les frères étaient à la messe; il pensait que, personne ne l'ayant vu, il pourrait jouir tout seul de cette friandise, ce qui l'aurait fait tomber dans le péché de gourmandise; mais l'office terminé, Thomas s'approcha de ce frère et le mit en garde contre la tentation dont il était victime, car cette tentation était suscitée par le diable. Quelques jours avant la mort du saint, un enfant qui était de garde auprès de Thomas étendu sur sa couche, vit une splendide et lumineuse étoile pénétrer par la fenêtre et s'arrêter pendant un certain temps au-dessus de la tête du malade; manifestation effective de la protection angélique et divine dont Thomas était le bénéficiaire. Il découle de tout ce que nous venons de dire sur la vie et le comportement de saint Thomas d'Aquin, qu'il était particulièrement compétent pour élucider la question des anges, pour parler de leur nature et de leurs ministères multiples. Il a consacré à cette étude les questions 50 à 64 de la Somme théologique nous allons maintenant analyser en détail cette étude, car c'est là l'exposé le plus lumineux sur cette question. D'après saint Thomas, le cri de guerre des anges est: «Qui est comme Dieu?» Voici l'opinion de saint Thomas d'Aquin sur la signification du monde angélique: «La surveillance angélique est comme une extension de la Providence divine; or, comme aucune créature n'échappe à celle-ci, toutes doivent se trouver sous la garde des anges». Tout au long de son étude, saint Thomas d'Aquin se référera à l'ouvrage de saint Denys, l'Aréopagite, dont nous nous sommes déjà occupé; tout d'abord saint Thomas traite de la nature des anges et il procède, selon son habitude, par questions, thèse, anti-thèse et réponses: Les anges sont-ils corporels ou incorporels, composés de matière et forme? L'ange est composé de ce par quoi il est et de ce qu'il est, ou de lêtre et de ce qui existe; ce qu'il est représente la forme subsistante elle-même. Les Anges sont-ils nombreux? Denys: «Les armées bienheureuses des esprits célestes sont nombreuses; la quantité des esprits dépasse la limite faible et restreinte de nos nombres matériels». Thomas: «Dieu ayant dans la création, comme but principal, la perfection, plus les êtres sont parfaits, plus Dieu les a créés en abondance. La cause de la multiplicité des anges n'est donc ni la matière, ni les corps, mais la divine sagesse qui a établi les divers ordres de substances immatérielles». Les Anges diffèrent-ils d'espèce? Denys enseigne que dans un même ordre d'anges, il y a les premiers, les intermédiaires et les derniers. Thomas: Les anges diffèrent donc d'espèce. La perfection de la nature angélique exige de ce fait la multiplication des espèces, non la multiplication des individus dans une même espèce. Les Anges sont-ils incorruptibles? Thomas: C'est en raison de son immatérialité que l'ange est incorruptible par nature. Les Anges ont-ils des corps et en assument-ils? Thomas: Ce n'est pas pour eux que les anges ont besoin d'assumer des corps, mais pour nous. Il est dit que des anges apparurent à Abraham sous des corps qu'ils avaient assumés(1). Les anges exercent donc les activités des êtres vivants dans les corps qu'ils assument. Certains anges sont apparus marchant. D'autre part, ils ont mangé et bu. Ces corps ne sont cependant pas inutiles, puisqu'ils ne sont pas formés pour sentir, mais pour manifester par leurs organes les vertus spirituelles des anges. L'Ange est-il dans un lieu? Thomas: L'ange n'est pas corps; il n'est donc pas dans un lieu. Cependant (pour accomplir une mission sur terre), il convient à l'ange d'être dans un lieu; être dans un lieu, n'a pas le même sens pour l'ange et pour un corps (humain). L'ange bien loin d'être contenu par le lieu qu'il occupe, l'enveloppe d'une certaine manière. L'Ange peut-il se mouvoir localement? Thomas: L'ange bienheureux peut se mouvoir localement. L'ange loin d'être mesuré et contenu par le lieu, le contient plutôt. Dès lors il n'est pas nécessaire que son mouvement local soit mesuré par le lieu ni qu'il se plie à ses exigences pour être continu, mais il peut être aussi bien continu ou discontinu. L'ange n'est, en effet, dans un lieu que par contact virtuel; son mouvement local ne peut donc être qu'une succession de contacts divers avec des lieux divers... C'est donc pour nos besoins que l'ange se meut localement. L'Ange traverse-t-il le milieu intermédiaire en passant d'un lieu à un autre? Thomas: La possibilité de pouvoir passer d'un extrême à l'autre sans passer par les intermédiaires ne peut d'ailleurs convenir qu'à l'ange, non au corps. Le corps étant mesuré et contenu par le lieu, il doit en suivre les lois dans son mouvement; tandis que la substance de l'ange n'est pas soumise au lieu, comme étant contenue par lui; au contraire, elle lui est supérieure et le contient. Il est donc au pouvoir de l'ange de s'appliquer à un lieu de la manière qu'il veut, soit en passant par les intermédiaires, soit en n'y passant pas. Concluons donc que le mouvement de l'ange est dans le temps; dans le temps continu, si son mouvement est continu; dans le temps discontinu, si son mouvement est discontinu, car l'ange peut se mouvoir de ces deux manières... Or, le temps du mouvement angélique pouvant être discontinu, l'ange peut être à tel instant ici, à tel autre instant ailleurs sans qu'il y ait de temps intermédiaire. Du pouvoir de connaissance des Anges. Thomas: L'acte de connaissance de l'ange est identique à son existence... Recevoir est le propre de l'intellect possible et illuminer est le propre de l'intellect agent. Or, l'ange reçoit la lumière de ce qui est au-dessus de lui et illumine ce qui est au-dessous de lui. Il y a donc en lui un intellect agent et un intellect possible. N'y a-t-il dans l'Ange que la connaissance intellectuelle? Saint Augustin dit que dans les anges il y a «la vie qui comprend et qui sent». Saint Isidore dit: «Les anges savent beaucoup de choses par expérience». Or l'expérience est le fruit de nombreux actes de mémoire. Les anges ont donc une mémoire. Les Anges connaissent-ils toutes choses par leur substance? Denys: «Les anges connaissent ce qui est sur terre, selon la nature propre de leurs esprits». Thomas: Or la nature de l'ange est son essence. L'ange connaît donc les choses par son essence... Dans les êtres immatériels comme les anges, le médium d'intellection est la substance même du sujet connaissant. La lumière de l'intelligence angélique est plus vigoureuse que la lumière de l'intellect agent de notre âme. Les similitudes des choses sont effectivement dans l'esprit des anges, sans être, pour autant, tirées des créatures; elles viennent de Dieu, qui est cause des créatures et en qui préexistent les similitudes des choses. Denys dit que les anges supérieurs participent à la science d'une manière plus universelle que les anges inférieurs. Et on lit dans le De Causis que les anges supérieurs ont des formes plus universelles. Thomas: Ce que Dieu connaît par un seul principe, les intelligences inférieures le connaissent par plusieurs, et moins l'intelligence est élevée, plus ces médiums de connaissance sont nombreux. Plus un ange sera élevé, moins nombreuses seront les species par lesquelles il peut saisir l'universalité des intelligibles. Les Anges connaissent-ils les choses futures? Thomas: Les anges sont en fait de connaissance, plus puissants que les hommes. Or certains hommes connaissent beaucoup de choses futures. À plus forte raison les anges. Les hommes ne connaissent les futures que dans leurs causes ou par révélation divine. Et, de cette façon, les anges les connaissent beaucoup mieux que les hommes. Un ange peut voir ce qui est dans la conscience de l'autre. Chaque ange voit les autres anges et les âmes et peut voir les pensées. Les Anges connaissent-ils les mystères de la grâce? Saint Augustin dit: «Ce mystère a été caché en Dieu pendant tous les siècles, mais non sans être connu des Principautés et des Puissances célestes». Et Saint Paul dit aussi: «Ce grand mystère a été découvert aux anges». Les anges connaissent donc les mystères de la grâce. Denys dit que les prophètes sont instruits par les anges et c'est par les anges que les prophètes ont connu les mystères de la grâce. Y a-t-il une volonté dans les anges? Thomas: II y a dans les anges, non pas une volonté, mais une faculté supérieure à la volonté. Le libre arbitre existe-t-il chez les Anges? Thomas: En tout être où il y a une intelligence, il y a un le libre arbitre. Le libre arbitre se trouve donc chez l'ange, et même d'une manière plus excellente que chez l'homme, comme il en appert pour l'intelligence. L'Amour ou la Dilection chez les anges. A ce sujet cinq questions se posent: 1) Y a-t-il dans l'ange une dilection naturelle? 2) Y a-t-il un amour de choix? 3) L'ange s'aime-t-i1 lui-même naturellement ou d'un amour de choix? 4) L'ange aime-t-il naturellement un autre ange? 5) L'ange aime-t-il naturellement Dieu plus que lui-même? Réponse à la première question, amour naturel de l'ange: Il est nécessaire de placer dans l'ange une dilection naturelle. Tous les êtres de l'univers sont de quelque manière agis, sauf évidemment le Premier Agent qui ne l'est d'aucune façon et en qui nature et volonté sont identiques. Rien n'empêche par conséquent que l'ange soit agi en ce sens que son inclination naturelle lui est donnée par l'auteur même de la nature... De même que toute connaissance naturelle est vraie, de même toute dilection naturelle est droite, car l'amour naturel est une inclination de nature qui vient de l'Auteur des natures. Réponse ad 2, amour de choix: La nature de l'ange étant parfaite, on ne trouve en lui que la seule connaissance naturelle, et non la connaissance rationnelle. Mais on trouve en lui et l'amour naturel et l'amour de choix. Réponse ad 3, l'ange s'aime-t-il d'un amour naturel ou de choix? L'amour naturel a pour objet la fin; l'amour électif, les moyens... Chez les êtres matériels, il est manifeste que chacun désire acquérir ce qui lui est bon; ainsi le feu tend à s'élever. Il en est de même chez l'ange et l'homme qui naturellement désirent leur bien et leur perfection. Cela, c'est s'aimer soi-même. L'ange comme l'homme s'aime donc lui-même naturellement quand il désire un bien d'un désir naturel. Mais quand il désire un bien par choix, il s'aime d'un amour électif. Réponse à la question 4, lange aime-t-il naturellement un autre ange comme lui-même? On doit reconnaître que l'ange aime naturellement un autre ange sous le rapport où celui-ci lui ressemble en nature. Mais sous d'autres points de vue, ou en raison des différences existantes, il ne l'aime pas d'un amour naturel. Quant à la question 5, l'ange aime-t-il naturellement Dieu plus que lui-même? En voici la réponse: L'ange aime Dieu pour Dieu. Il aime Dieu plus que lui-même, car il désire plus le bien divin que son propre bien. La question 61 de la Somme traite de la production des anges selon leur être naturel. A ce point de vue, quatre questions se posent: 1) L'ange a-t-il une cause de son être? 2) L'ange existe-t-il de toute éternité? 3) L'ange a-t-il été créé avant la créature corporelle? 4) Les anges ont-ils été créés dans le ciel empyrée? À la question 1: L'existence des anges a-t-elle une cause? Il sera répondu: On lit au Psaume 148 (2-5): Louez l'Eternel, vous tous ses anges! car l'Éternel commande et ils ont été créés. Les anges sont donc nécessairement créés par Dieu. A la question 2: L'ange a-t-il été produit par Dieu de toute éternité? Il est répondu: Dieu est cause de l'ange par son être. L'être de Dieu est éternel. Il a donc produit les anges de toute éternité. L'ange est au-dessus du temps, ainsi qu'il est dit dans le livre Des Causes. Et si l'on ne peut pas dire que l'ange, à un moment donné, existe, et qu'à un autre, il n'existe pas, c'est donc qu'il existe toujours. L'ange est au-dessus du terme mesuré par le mouvement du ciel, car il est au-dessus de tout mouvement de la nature corporelle. Mais il n'est pas au-dessus du temps qui mesure la succession du non-être et de l'être, ni au-dessus du temps qui mesure la succession de ses opérations. C'est pourquoi saint Augustin peut écrire que «Dieu meut la créature spirituelle dans le temps». A la troisième question: Les anges ont-ils été créés avant le monde corporel? il est répondu: Saint Jérôme dit: «Pendant combien de temps, combien de siècles, ne faut-il pas penser que les Anges, les Thrônes et les Dominations, les autres hiérarchies célestes étaient déjà au service de Dieu?» Saint Jean Damascène remarque: «Certains disent que les anges furent produits avant toute autre création». C'est également l'opinion de Grégoire, le Théologien: «En premier lieu Dieu conçut les Puissances angéliques et célestes, et ce fut là son uvre». Il y a plus de distance entre la nature angélique et la nature corporelle qu'entre deux natures corporelles différentes. Mais les natures corporelles ont été créées l'une après l'autre en six jours selon le récit de la Genèse. À plus forte raison, la nature angélique a-t-elle été produite avant toute nature corporelle. Saint Jérôme s'appuyant sur l'opinion des Docteurs grecs dit que tous s'accordent à reconnaître que les anges ont été créés avant le monde corporel. Dieu n'est pas une partie de l'univers; il est au-dessus, et en possède la perfection d'une manière éminente. L'ange, au contraire, fait partie de l'univers. À la dernière question: Les anges ont-ils été créés dans le ciel empyrée? Il est répondu: Les anges sont des substances incorporelles qui ne dépendent pas d'un corps dans leur être, ni par conséquent dans leur devenir. Ils n'ont donc pas été créés dans un lieu corporel. Dans la Glose de Strabon, nous lisons: Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel dont il s'agit n'est pas le firmament visible, mais le ciel empyrée ciel de feu ou ciel spirituel ainsi appelé non pas à cause de son ardeur, mais de sa splendeur. Et aussitôt qu'il fut produit, il fut rempli par les anges. Les créatures corporelles et spirituelles constituent un seul univers. Il y a donc un ordre entre elles, et les spirituelles président aux corporelles. Il convient donc que les anges fussent créés dans la partie suprême du monde corporel pour présider à tout l'ensemble de ce monde. Peu importe d'ailleurs que l'on donne à cette partie le nom de ciel empyrée ou une autre appellation quelconque, car comme il est dit dans le Deutéronome: «C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux» (10,14). Rien n'empêche de concevoir que les anges supérieurs ayant une puissance plus élevée et plus universelle sur tous les corps, aient été créés dans la partie suprême du monde matériel. Les Anges ont-ils été créés bienheureux? Thomas: La nature angélique est formée et parfaite par le moyen de la béatitude qui la fait jouir de Dieu. Le «matin» dont il est question dans le récit de la Genèse, n'est autre que la connaissance angélique, en tant qu'elle a pour objet le Verbe et les choses vues dans le Verbe. Or une telle connaissance constitue la béatitude de l'ange. C'est donc que l'ange est bienheureux au principe même de sa création. L'Ange a-t-il besoin de la grâce pour se tourner vers Dieu? Thomas: Nous n'avons pas besoin de la grâce pour accomplir ce qui est en notre pouvoir naturel. Mais l'ange se tourne naturellement vers Dieu puisqu'il l'aime d'un amour naturel. Il n'a donc pas besoin de grâce pour se tourner vers Dieu. Les Anges ont-ils été créés en grâce? Thomas: D'après saint Augustin, la nature angélique fut d'abord créée informe et appelée ciel; puis elle fut revêtue d'une forme et appelée lumière. Mais cette forme dont il est question ne peut être que la grâce. Il semble donc plus raisonnable de concevoir que les anges ont été d'abord créés avec leurs natures propres; puis qu'ils ont reçu la grâce, et qu'enfin ils sont devenus bienheureux. L'Ange a-t-il mérité sa béatitude? Thomas: Le mérite vient de la difficulté de l'acte méritoire, mais l'ange n'eut aucune difficulté à bien agir. Son acte bon ne fut donc pas méritoire... À Dieu seul la béatitude parfaite est naturelle, car elle est identique à son être. Pour toute créature, la béatitude n'est pas naturelle, mais représente sa fin ultime... Nous savons que la béatitude surpasse le pouvoir de la nature angélique et humaine. Il appartient donc à l'homme, comme à l'ange, de mériter leur béatitude... Personne ne mérite ce qu'il possède déjà... La difficulté de bien agir ne vient pas, pour l'ange, d'une contrariété ou d'un empêchement qui s'opposerait à sa puissance naturelle; mais elle vient de ce que l'oeuvre bonne à accomplir est au-dessus de ses forces natives. Les Anges ont-ils obtenu la grâce et la gloire en proportion de leurs dons naturels? Thomas: La grâce dépend de la volonté de Dieu, le degré de grâce en dépend donc aussi et n'a rien à voir avec le degré de la perfection naturelle. Il est cependant raisonnable de penser que les dons de la grâce et la perfection de la béatitude ont été attribués aux anges d'après leur degré de perfection naturelle. L'Ange bienheureux peut-il pécher? Thomas: La béatitude n'enlève pas la nature. Or il est de l'essence de la nature créée d'être déficiente. L'ange bienheureux peut donc pécher. Cependant la béatitude consiste à voir Dieu dans son essence. Or l'essence de Dieu, c'est l'essence même de la bonté. Par ce fait l'ange bienheureux ne peut vouloir ou agir qu'en se référant à Dieu; il ne peut pécher d'aucune manière. Les Anges bienheureux peuvent-ils progresser en béatitude? Thomas: La charité est principe de mérite, mais dans les anges, la charité est parfaite; ils peuvent cependant mériter et progresser en béatitude. Toutefois le mérite et le progrès appartiennent à l'état de voie. Les anges ne sont plus dans cet état; ils ne peuvent donc ni mériter, ni progresser en béatitude. Les ministères des anges bienheureux leur sont utiles, car ils font d'une certaine manière partie de leur béatitude: diffuser sa perfection sur autrui appartient en effet à l'être parfait en tant qu'il est parfait. Bien qu'absolument parlant, l'ange bienheureux n'atteigne pas le degré suprême de la béatitude, cependant, pour ce qui est de lui et compte tenu de la prédestination divine, il est parvenu au terme ultime et au sommet de son bonheur. Néanmoins, peut croître chez les anges la joie quil éprouvent du salut de ceux près desquels ils sont appelés a exercer leur ministère.
Le péché des anges Première question: L'Ange peut-il pécher? Dans Job nous lisons: Dieu découvre du mal (des fautes) dans ses anges. (4,18) L'ange aussi bien qu'une créature rationnelle quelconque, si on la considère dans sa seule nature, peut pécher... Le péché n'est pas autre chose qu'une déviation par rapport à la rectitude de l'acte à poser... Chez les anges au-dessus de leur activité naturelle, il y a l'activité du libre arbitre, et c'est là que le mal peut se trouver. Y a-t-il dans l'ange d'autres péchés que ceux d'orgueil et d'envie? Tout aussi bien que l'orgueil et l'envie, l'acédie (apathie, affaissement de la volonté), l'avarice et la colère sont des péchés spirituels qui relèvent de l'esprit comme les péchés charnels relèvent de la chair. Les anges ont donc pu les commettre. L'acédie est une certaine tristesse qui rend l'homme paresseux dans les activités spirituelles, en raison d'une certaine langueur physique. Seuls l'orgueil et l'envie sont des péchés spirituels. De l'orgueil et de l'envie découlent tous les autres péchés. Sans aucun doute, l'ange a péché en désirant être comme Dieu, mais cela peut s'entendre d'une double manière: soit par égalité, soit par similitude. Il y a péché à considérer comme un droit de devenir semblable à Dieu par ses propres forces et non par vertu divine. Celui qui voudrait être capable de créer le ciel et la terre, pouvoir qui est propre à Dieu, un tel désir serait un péché et c'est en ce sens que le Diable a désiré être comme Dieu. L'ange a désiré posséder sa béatitude dernière par ses propres forces, ce qui n'appartient qu'à Dieu. Enfin l'ange a désiré également une certaine principauté sur les créatures, en quoi il a voulu d'une façon perverse s'assimiler à Dieu. Certains démons sont-ils naturellement mauvais? Porphyre parle d'une certaine espèce de démons trompeurs par nature qui simulent les dieux et les âmes des morts. Or être trompeur, c'est être mauvais. Il y a des démons naturellement mauvais. Les anges comme les hommes, ont été créés par Dieu, mais il y a des hommes naturellement mauvais, dont il est dit dans l'Écriture: «La malice leur est naturelle». Il peut donc se trouver aussi des anges naturellement mauvais. Le Diable a-t-il été mauvais par sa propre faute dès le premier instant de sa création? Dans saint Jean (8,44), Jésus déclare: «Le Diable a été meurtrier (homicide) dès le commencement; et il n'a pas persévéré dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui». Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fonds parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Le péché de l'ange fut postérieur à l'opération créatrice. Le plus élevé parmi les anges pécheurs fut-il aussi le plus élevé de tous les anges? On lit dans Ezéchiel: «Tu étais un Chérubin protecteur; je t'avais placé sur la montagne sainte de Dieu». Mais, d'après Denys, l'ordre des Chérubins est inférieur à celui des Séraphins. Le plus élevé des anges pécheurs n'était donc pas le plus élevé de tous les anges. Cependant saint Grégoire écrit que le premier ange qui a péché, «supérieur à toutes les troupes angéliques, les dépassait en clarté et resplendissait encore davantage quand on le comparait aux autres anges» (Lucifer). En conclusion, il faut considérer deux choses dans le péché. Pour ce qui est de l'inclination, il semble que les anges supérieurs étaient moins portés à pécher que les anges inférieurs. C'est ce qui fait dire à Damascène que, dans ce cas, «le plus grand des anges» signifie, le supérieur de l'ordre terrestre. Toute la création corporelle est administrée par Dieu au moyen des anges. Rien n'empêche donc d'affirmer que les anges inférieurs sont préposés par Dieu à l'administration des corps inférieurs, tandis que les anges supérieurs ont pour rôle d'administrer les corps plus élevés; les anges suprêmes étant assistants au trône de Dieu... Ceux qui tombèrent faisaient partie de l'ordre inférieur, encore que, même dans cet ordre, il y en eut qui demeurèrent fidèles. Si, d'autre part, on considère le motif que l'ange avait de pécher, ce motif apparaît plus fort chez les anges supérieurs. Le péché des démons fut en effet un péché d'orgueil dont le motif est la propre excellence du pécheur. Or cette excellence était plus grande chez les anges supérieurs. C'est pourquoi saint Grégoire affirme que le premier ange pécheur fut le plus élevé de tous. Et cette opinion semble la plus probable. Mais nous n'entendons pas préjuger de l'autre opinion, car il a pu y avoir aussi bien chez le prince des anges inférieurs un motif de pécher. Solution: Le mot Chérubin signifie, selon l'interprétation commune, plénitude de science; le mot Séraphin, ardent ou enflammé. Le premier nom se tire donc de la science qui peut exister avec le péché mortel; le second se tire de l'ardeur de la charité qui est incompatible avec le péché. Dès lors le premier ange pécheur ne peut être appelé Séraphin, mais Chérubin. Quelque grande que fut l'inclination au bien chez l'ange suprême, elle ne lui imposait pas une nécessité, et, par son libre arbitre, il pouvait s'y soustraire. Le péché du premier ange fut-il la cause des péchés des autres? Le premier péché de l'ange ne peut être que l'orgueil et l'orgueil recherche l'excellence. Or, il répugne à celui qui désire exceller de se soumettre à un inférieur... Dans la Glose nous lisons: «Lui qui était supérieur aux autres dans son être est devenu aussi le plus élevé en méchanceté». Dans l'Apocalypse, on lit: «La queue du dragon a entraîné avec lui le tiers des étoiles du ciel» (12,4). L'orgueilleux, toutes choses égales d'ailleurs, préfère se soumettre à un supérieur plutôt qu'à un inférieur... Et parce que l'ange suprême avait une puissance naturelle supérieure à celle des anges inférieurs, il s'est précipité dans le péché avec plus de violence. Y a-t-il eu autant d'anges pécheurs que d'anges fidèles? Il est dit dans l'Ecriture: «Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux», parole que l'on applique aux bons anges qui nous portent secours, tandis que les mauvais nous sont contraires. Conclusion: Il y eut plus d'anges fidèles que de pécheurs, car le péché va à l'encontre de l'inclination naturelle de la créature; or ce qui est contre nature ne se produit qu'accidentellement dans un petit nombre de cas. Pour ceux qui pensent que le Diable appartenait à la hiérarchie inférieure de ces anges qui président au monde terrestre, il est évident que les anges pécheurs ne ressortissent pas à toutes les hiérarchies, mais seulement à la dernière... Si l'on admet au contraire que le Diable appartenait à la hiérarchie suprême, il est probable que ceux qui sont tombés ressortissent à toutes les hiérarchies, et que les hommes sont introduits en celles-ci pour suppléer au vide produit par la chute angélique. En quoi s'avère avec plus d'évidence l'indépendance du libre arbitre qui peut s'infléchir vers le mal, quelle que soit la dignité de la créature... Cependant dans la Sainte Ecriture, les noms de certaines hiérarchies, comme les Séraphins et les Trônes, ne sont pas attribués aux démons, car ces noms sont pris de l'ardeur de la charité et de l'habitation de Dieu, lesquelles sont incompatibles avec le péché mortel. On attribue, au contraire, les noms de Chérubins, de Puissances et de Principautés aux anges susceptibles de pécher, car ces noms sont pris de la science et de la puissance, lesquelles peuvent être communes aux bons et aux mauvais anges.
Le Châtiment des Démons
L'intelligence des Démons est-elle obscure au point d'être privée de la connaissance de toute vérité? Thomas: Les démons ne peuvent connaître la vérité naturellement; ils ont été privés de la connaissance des mystères du royaume de Dieu; ils sont séparés des bons anges comme les ténèbres le sont de la lumière. Pour Denys, les dons angéliques accordés aux démons n'ont pas changé; ils demeurent dans leur intégrité et leur splendeur. Or parmi ces dons se trouve la connaissance de la vérité. Tous les anges, au principe, ont connu de quelque manière le mystère du royaume de Dieu qui devait être accompli par le Christ; mais surtout ceux qui furent béatifiés dans la vision du Verbe que les démons ne connurent jamais. Du fait de la lumière de leur nature intellectuelle les démons sont cependant lucides. La volonté des Démons est-elle obstinée dans le mal? Thomas: Le libre arbitre appartient à la nature intellectuelle, et il demeure chez les démons. Or le libre arbitre, de soi et par mode de priorité, est ordonné au bien plutôt qu'au mal. La volonté des démons ne peut donc être obstinée dans le mal au point de ne pouvoir faire retour au bien. La miséricorde infinie de Dieu est plus grande que la malice finie du démon. Le démon confesse parfois la vérité en disant du Christ: «Je sais que tu es le Saint de Dieu». D'après Denys les démons désirent ce qui est bon et même ce qui est meilleur, à savoir, l'être, la vie, l'intelligence. Le péché commis au principe demeure dans le Diable pour autant qu'il comporte le désir de son objet, bien que le Diable se sache très bien dans l'impossibilité de l'atteindre. L'activité vraiment propre du démon provient d'une délibération de sa volonté; elle est toujours mauvaise chez le démon. Y a-t-il de la souffrance chez les démons? Thomas: D'après saint Augustin: «Le Diable a pouvoir sur ceux qui méprisent les préceptes de Dieu, et de ce malheureux pouvoir, il se réjouit». Il n'y aurait donc pas de souffrance chez les démons. Or, d'après l'Apocalypse (18,7), il est dit: «Autant Babylone s'est glorifiée et plongée dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de deuils» (afflictions). À plus forte raison le Diable, qui s'est glorifié souverainement, sera-t-il puni dans les lamentations de la souffrance. Parce qu'ils sont jaloux, les démons voudraient que soient damnés ceux qui sont sauvés. Il faut reconnaître qu'il y a entre eux de la souffrance. Chez les démons, la souffrance a pour objet ce qui est présent, et la crainte de ce qui est à venir. Dans lÉpître de Jacques (2,19), on lit: «Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi et ils tremblent». Mais en raison de la perversité et de l'obstination de sa volonté, le démon ne souffre pas du mal de la faute. L'atmosphère terrestre est-elle le lieu de châtiment des Démons? Les démons sont punis de la peine du feu. Mais il n'y a pas de feu dans l'air ténébreux. Saint Augustin dit: «L'air ténébreux est comme la prison des démons jusqu'au jour du jugement. Un double lieu pénal doit être attribué aux démons; l'un en raison de leur faute, c'est l'enfer, l'autre en raison de l'épreuve humaine, c'est l'air ténébreux. * * * Par le résumé du chapitre consacré à l'étude des anges dans la Somme de saint Thomas d'Aquin, on peut déjà se rendre compte combien cet auteur a étudié la question sous tous ses aspects, et, dès lors, tous ceux qui aborderont le même sujet s'en référeront à l'opinion du Docteur de l'Ecole ou Docteur angélique.
2. Le Rd. P. J. Berthier et son Etude de la Somme (Les Anges). En 1893, le Rd. P.J. Berthier, professeur à l'Université de Fribourg, a fait paraître sous le titre «L'Étude de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin» une série de leçons données sur le thomisme et cela en conformité avec l'Encyclique de Léon XIII, tendant à promouvoir et recommander l'étude de la philosophie thomiste. Voici comment dans cette importante étude est traitée la question des Anges: «Dieu sera l'auteur de cette sublime hiérarchie des êtres: en haut, les purs esprits, les anges; en bas, le monde purement matériel; entre deux, l'homme composé d'un corps et d'un esprit... Quelle gradation lente et harmonieuse (p. 95).» Entre Dieu et l'homme, s'élèvent les hiérarchies angéliques. Les anges sont des formes pures, non plus destinées à informer la matière, comme les formes inférieures, mais à subsister et à agir par elles-mêmes.» Le P. Berthier reprend une expression de saint Thomas qu'il estime très juste, soit, les «émanations successives de la divinité»; et de dire: «Saint Thomas commence par l'étude des anges et examine successivement leur nature, leur intelligence, leur volonté, leur création.» Partant de ce principe qu'ils sont des formes pures, placées entre Dieu et l'homme, il en déduit le magnifique traité, qui, selon quelques-uns, aurait mérité à saint Thomas son titre d'Angélique. Il s'empare des données que lui fournissent la Révélation et la Tradition, et en fait jaillir des torrents de lumière, sur l'immatérialité des anges, leur manière d'agir sur le monde matériel, leur mode de croissance, la puissance de leur volonté, l'heure de leur création, les grâces qui leur furent prodiguées par la munificence divine, sur la chute et le châtiment des anges rebelles (p. 96).» Un passage de saint Thomas, relevé par le P. Berthier, montre que, pour ce Docteur de l'Église, les manifestations que l'on range actuellement sous la dénomination de spiritisme et d'hypnotisme peuvent s'expliquer de deux façons: imagination, hallucination ou action des esprits; et l'auteur de dire: «Les esprits bons ou mauvais peuvent agir sur le monde matériel, et dès lors sur les imaginations» (p. 315). Et le P. Berthier de conclure par cette affirmation: «Saint Thomas attribuait la plupart de ces phénomènes aux esprits angéliques, et ajoutait que ces manifestations se peuvent produire durant l'état de veille, comme durant l'état de sommeil». Nous retrouverons le P. Berthier, traducteur et commentateur de la Divine Comédie, lorsque nous traiterons de Dante et de sa façon de concevoir l'angéologie. __________________________________ (1) Assumer, de sumerer == prendre sur soi, se charger de. |