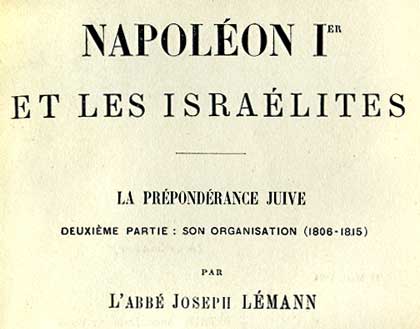
PREFACE
Ce nouveau volume vient mettre en lumière, et montrer dans les détails, l’organisation de la prépondérance juive: il fait suite à celui qui en a raconté les origines.
Cette organisation ne se borne pas à être, comme beaucoup le croient, une concentration savante de forces hébraïques: elle compte parmi ses éléments les forces vives elles-mêmes de la nation hospitalière. Elle se développe, aidée des événements, des institutions, des lois, des mœurs. Les événements lui ont été favorables; les mœurs n'ont plus offert bientôt qu'une faible résistance; les lois et les institutions se sont prêtées à ses racines.
En outre, elle s’accroît de la décadence d'autrui:
Le magnifique essor des nations chrétiennes avait été comparé par le Prophète royal à la majesté des grandes eaux. Ces eaux majestueuses, en coulant à pleins bords, passaient, victorieuses, par-dessus un rocher, transformé en écueil par le Talmud: c'était le peuple juif, renfermé dans leur sein. Mais le jour où les eaux sont devenues basses, où les lois, les institutions, les mœurs, se sont affaiblies, le rocher a émergé, pour devenir une cime, un sommet, une prépondérance.
Un pareil état de choses s'explique difficilement si l'on ne prend la peine de remonter jusqu'à l'Empire, continuateur de la Révolution française. A l'Assemblée constituante, de 1789 à 1791, la prépondérance juive fut redevable de son origine; à Napoléon, de 1806 à 1815, elle est redevable de son organisation.
Ce vaste génie, aux intentions conservatrices et généreuses, a fait en grande partie fausse route dans ses mesures vis-à-vis du peuple juif. Il a voulu emporter d'assaut la fusion de ce peuple avec les autres peuples, et le résultat n'est pas un vrai succès. Il a cru, par ses lois et ses institutions, fortifier la société et dissoudre les hébreux, et c'est le contraire qui devait se produire. Enfin, lorsque la lutte s'est engagée entre le puissant Empereur et les débris vivants du Sinaï, ce sont les débris qui ont résisté, et triomphé.
Ces diverses péripéties forment un épisode très peu connu de l'Empire, et du plus vif intérêt. Nous le racontons.
Puisse le lecteur, quel qu'il soit, nous rendre ce témoignage: que la vérité nous est chère, et, non moins, la charité ! Notre tâche est difficile. Mais en prenant la défense du peuple chrétien, et, à l'exemple de Dieu, le parti d'Isaac contre Ismaël, nous n'oublions pas les ménagements qui peuvent aider à la possibilité d'une réconciliation. Les deux peuples n'appartiennent-ils pas ensemble au Christ de Dieu, l'un comme enfant, l'autre comme ancêtre ?... Napoléon faisait assurément une chose louable, lorsqu'il travaillait à un rapprochement: son tort fut de l'avoir tenté sans l'Eglise. C'était tenter l'impossible ! Seule, l'Eglise peut reprendre en sous-œuvre l'édifice de concorde, en réparer les brèches et le perfectionner. Quelle heureuse chose pour la société, lorsqu'on dira: Les Israélites et les autres peuples sont frères, non sous des apparences civiles, mais pour de bon !
Fasse donc le ciel que cette étude historique, qui éclaire les situations en racontant loyalement le bien et le mal, diminue aussi la distance qui sépare !
Lyon, le 19 mars 1891.
LIVRE PREMIER
Napoléon entreprend de relever les Israélites dans leurs mœurs
et de les réconcilier avec les peuples.
CHAPITRE PREMIER
COMMENT NAPOLÉON FUT AMENE A S’OCCUPER DES ISRAÉLITES
I. La gloire le Napoléon n'a pas dédaigné les juifs. — II. Le décret d'émancipation et d'égalité, émané de l'Assemblée constituante en l791, ne les avait nullement améliorés; il n'avait pas, non plus, rapproché d'eux les Français. La haie du Talmud. — III. Par quel enchaînement de circonstances Bonaparte est amené à entreprendre cette amélioration et ce rapprochement. Sa première rencontre avec les juifs: en Syrie. Rêve oriental du vainqueur des Pyramides. — IV. Puis, il les rencontre à la suite de ses armées, lors de la campagne d'Austerlitz: l'aigle et les vautours. — V. Troisième rencontre: à Strasbourg. L'Alsace, dévorée par eux, se plaint à Napoléon. La lèpre de l'usure. La conscription éludée. L'empereur retient son irritation. — VI. Rentré à Paris, il décharge un coup de sabre sur toutes les créances des juifs d'Alsace. Le Conseil d'Etat saisi de la question juive. Séance présidée par l'empereur où il exhale son irritation. La pensée de sa gloire le ramène à l'examen calme de la question. Un éclair de son génie: convocation d'Etats généraux juifs. —
VII. Importance de bien préciser le milieu historique au moment où ces singuliers Etats généraux vont se réunir: c'est l'apogée de l'Empire; on se fait, de Napoléon, l'idée d'un demi-dieu; ce que lui-même pensait des religions.
I
« Il aime la gloire, parce que tout le reste ne peut remplir le vide immense de son âme. Il dévore le temps, il dévore l'espace, parce qu'il lui faut vivre plus vite, marcher plus vite que les autres hommes. Il pèse le monde dans sa main, et il le trouve léger; et le front à demi penché sur l'abîme, il se met à rêver l'éternité de sa dynastie et la monarchie universelle (1). »
C'est bien Napoléon !
Il y a des peuples qui ont adoré le soleil, Napoléon a adoré sa propre gloire. Elle s'était levée comme un soleil. Aigle, il la fixait, il la buvait.
C'est elle qu'il consultait dans toutes ses entreprises, elle qu'il invoquait dans ses proclamations à ses soldats. Il en était épris, ébloui, infatué. Il a aimé passionnément la France: injuste, qui le contesterait; il la voulait rayonnante, impératrice du monde, enveloppée de gloire: mais le glorieux vêtement de la France, c'était lui-même, avec ses victoires, ses couronnes, son nom !
Aussi sa gloire avait-elle les caractères particuliers aux divinités antiques: elle se montrait insatiable, teinte de pourpre, de sang, despotique, terrible.
Un jour, elle rencontra le peuple juif.
Son premier mouvement fut, sans doute, le dédain et le mépris. La gloire avait-elle quelque chose à faire avec ces gens-là ?
Peut-être !
Et la figure de l'Empereur dut devenir pensive. Que n'a-t-on entendu son monologue !
Le soleil qui fait étinceler le dôme doré des Invalides n'a-t-il pas aussi quelques rayons pour les ruelles des juifs ? et l'aigle, après qu'il a plané au plus haut des cieux, n'entre-t-il pas dans les trous des abîmes ?
Et monté sur le faîte, il aspire à descendre !
Du faîte du Concordat et du maniement des trônes, descendre dans les affaires des juifs, quel écart pour ton génie, ô Napoléon !
Mais n'y a-t-il pas une gloire à s'élancer d'un extrême à un extrême, et n'a-t-on pas dit que cette marche superbe était celle du Tout-Puissant (2) ?
Allons, Napoléon, il n'y aura, pour toi, ni perte de temps ni diminution de prestige à t'occuper d'eux !
Et sa gloire, qui, à la date de 1806, avait déjà fixé ses rayons sur tant de peuples, se mit à les considérer aussi.
Nous allons raconter, dans ce premier livre, sa loyale entreprise de corriger leurs mœurs et de les réconcilier avec le reste de la terre.
II
L'entreprise de l'Empereur ne laissera pas que de surprendre quiconque aura lu notre précédent ouvrage. On se demandera: « Mais l'Assemblée constituante n'avait-elle pas déjà invité les israélites à entrer dans la vie commune » Cette invitation ne s'est-elle pas faite en 1791, par le décret de leur émancipation ? On est en 1806. Quinze années se sont écoulées. Durant ces quinze années, aucune transformation n'a-t-elle donc commencé à poindre, aucun rapprochement ne s'est-il opéré entre les Français et les juifs ? »
L'Histoire répond. aucune transformation, aucun rapprochement.
Les populations, en effet, se sont montrées moins qu'empressées à ouvrir leurs rangs aux nouveaux citoyens, et ceux-ci ont jugé prudent de ne pas abandonner leurs ruelles. On s'est regardé de part et d'autre, comme si l'on eût été en faïence ! Mais pouvait-il en être autrement ? N'y avait-il pas quelque naïveté à penser que des gens, habitués depuis de longs siècles à exister séparés de la société générale, abandonneraient tout d'un coup leurs mœurs et leurs logis pour se mettre à vivre à la française ?
Toutefois, il y a d'autres causes à cette circonspection mutuelle. Quelles sont-elles ?
Les événements y ont été pour quelque chose. On a traversé les années de la Terreur, cantonné chacun chez soi, le plus possible. On a passé ensuite, sans transition et sans trêve, sur les champs de bataille. Il restait, il faut en convenir, peu de temps pour s'aboucher et faire connaissance. Néanmoins la vraie cause de la circonspection est ailleurs.
Serait-elle dans la loi de Moïse, différente, en certains points, de la loi des chrétiens ? Pas précisément. « Debout au Sinaï, Moïse écoute et écrit: il écoute et il écrit une Loi dont trente-trois siècles n'ont pas retranché une syllabe, qu'Athènes a reçue, que Rome vénère, que la conscience reconnaît pour la sienne et que Jésus-Christ, venu de Dieu pour tout consommer, déclare être aussi sa loi. Moïse est au Sinaï ce qu'Adam est dans l'Eden (3). » Frères en Adam, les israélites et les chrétiens ne trouveront donc nulle peine à continuer cette fraternité à l'ombre du décalogue de Moïse.
Mais alors, qu'est-ce qui réussit à les maintenir éloignés les uns des autres ?
La haie des lois talmudiques !
De leur autorité privée, les rabbins ont ajouté et surajouté à la Loi de Moïse, et ces amas d'additions sont devenus des fatras inextricables: leur réunion compose le Talmud, rempli de décisions où l'Esprit de Dieu est absent, d'un pêle-mêle de choses encombrantes, et de ridicules et interminables subtilités. Les rabbins n'ont-ils pas décoré ces additions du nom de haie à la Loi, comme s'ils avaient reçu mission de la protéger ! Hélas ! jamais dénomination n'a été mieux trouvée, mais avec une signification lugubre. Les pauvres juifs ont été littéralement clôturés, emprisonnés par cette haie, eux qui avaient joui des grandes avenues de la Bible. Ah ! certes, le Talmud n'est pas un rempart d'aubépine en fleurs, mais bien plutôt une haie hérissée, impénétrable, favorable aux serpents, aux vols, aux rapines, et derrière laquelle des décisions dangereuses ont pu se prendre en haine du Christianisme. Si cela n'est pas, pourquoi les Papes et les Rois très chrétiens auraient-ils si souvent ordonné la destruction des exemplaires du Talmud ?
Or — pour en revenir à la circonspection persistante des chrétiens et des juifs malgré le décret libérateur et fraternel de 1791 — elle s'explique par le maintien de la détestable haie, les broussailles en étant toujours aussi inextricables et aussi dangereuses. Les gens qui vivent dans les broussailles, derrière les haies, sont exposés, presque malgré eux, à des métiers peu honorables, comme les bohémiens; ainsi en était-il des juifs derrière leur Talmud, même après l'émancipation de 1791; est-il étonnant que, de leur côté, les chrétiens ne se soient guère souciés d'avoir commerce avec des gens qui n'avaient rien répudié de leurs défiances et de leurs habitudes ? Voilà la vraie cause de la circonspection mutuelle (4). Des israélites, avides de lumière et d'un rapprochement, n'ont pas craint de l'avouer, à cette époque même, et de faire appel à un déblaiement. « En 1800, une association de juifs hollandais avait publié la résolution de ne reconnaître que la religion pure et consolante de Moïse, et de rejeter les institutions qui, jusque-là, étaient dénommées lois talmudiques. Cette association avait de nombreux adhérents. En 1801, un congrès général fut projeté, pour réunir à Lunéville les représentants de tous les juifs dispersés dans les divers Etats de l'Europe (5). »
Ce projet, auquel il ne fut pas donné suite, Bonaparte devait le reprendre. Une botte de soldat était, seule, capable de s'aventurer à travers ces broussailles; et il fallait une voix comme la sienne pour commander: Sortez de vos trous; sur les rangs ! qu'on vous voie !
Mais par quel enchaînement de circonstances Bonaparte fut-il amené à prendre cette initiative et à s'occuper du peuple juif ? Il importe de le connaître avant d'entrer dans l'étude de l'entreprise de transformation.
III
« Nous voilà dans l'obligation de faire de grandes choses ! » s'était écrié, sur le sol d'Egypte, Bonaparte, en apprenant que la flotte française venait d'être complètement détruite par Nelson à Aboukir, et qu'il était enfermé en Orient, à la suite de la perte de sa flotte.
Son départ de Toulon, au printemps, sous un ciel splendide, avec une rade couverte de spectateurs, avait été plein d'enthousiasme; mais à ce moment ses desseins étaient encore incertains. Cet Orient aux pensées infinies s'ouvrait devant lui. Semblable à l'aigle du Liban qui, du haut du Sannin, regarde le soleil, tourne sa tête vers différents points du ciel et quelque temps hésite sur la proie qu'atteindra son vol rapide, le jeune général en chef, du haut de son vaisseau s'était demandé s'il irait relever Athènes ou Sparte, attaquer Constantinople ou Le Caire, prendre Alep et de là menacer l'Inde. Sa belliqueuse imagination jouait avec les royaumes de l'Asie; il sentait en lui quelque chose comme la toute-puissance. Il aurait dit volontiers au vent: Pousse ma voile où tu voudras, et malheur aux nations qui résisteront à mon épée ! Bonaparte décida qu'on irait du côté des Pyramides. Il souhaitait, pour la grandeur future de sa taille, prendre mesure sur les colosses de granit d'Héliopolis ou de Thèbes (6).
La nouvelle de la destruction de sa flotte ne l'émut donc pas. Se retournant vers ses compagnons d'armes, il leur annonça l'obligation de faire de grandes choses. Il avait tous les enivrements de la jeunesse et de la force, avec la volonté arrêtée d'accomplir des prodiges. Il rêvait de recommencer les conquêtes d'Alexandre, facilitées par les moyens de la guerre moderne dans des contrées qui les ignoraient.
L'empire sur l'Orient se présenta réellement à sa pensée (7), et c'est alors qu'il fit attention pour la première fois aux israélites.
Les procédés dont il se servit à leur égard, sur ce sol qui leur était cher, ressemblent à ceux que sa politique et son déisme lui conseillèrent d'employer vis-à-vis des fils de l'Islam, tout en étant cependant plus discret. Les historiens ont raconté les avances qu'il fit en religion pour gagner la confiance des Arabes. S'occuper des mosquées et de leurs intérêts avec un soin et une partialité marqués; entourer d'honneurs et d'une considération extraordinaire les muftis et les imams; leur parler de Mahomet avec admiration; entrer dans les vues et sentiments de l'islamisme; assister à leurs fêtes, à la fête du Nil, à la fête du Prophète; veiller à la somptuosité d'un tapis couvert de sentences que les pèlerins musulmans devaient porter à la Mecque: tels furent les ménagements, pour ne pas dire les captations, du vainqueur des Pyramides; ménagements inconnus aux conquérants antérieurs. Aussi les vieux muftis l'écoutaient-ils avec ravissement. Leurs yeux étincelaient de rayons de bonheur quand il leur promettait le rétablissement de l'empire arabe, le retour des temps glorieux des Fatimites (8).
Semblables furent ses ménagements et ses avances auprès des israélites. Lorsque, maître de l'Egypte, il entreprend la conquête de la Syrie et de la Palestine, il recommande à ses soldats le respect des synagogues. Il caresse les vieilles barbes qui rappellent celle d'Aaron, en leur offrant l'espoir de relever le nom hébreu. Il lance une proclamation dans laquelle il invite « tous les juifs de l'Asie et de l'Afrique à venir se ranger sous ses drapeaux, pour rétablir Jérusalem dans son ancienne splendeur (9) ».
Mais Saint-Jean d'Acre l'arrête (10).
Il ne put que contempler la Palestine du sommet du Thabor, que les Arabes appellent Gbel-el-Nour, montagne de la lumière. Il lui resta, de cette vision, une impression ineffaçable (11).
Quelques jours après, il faisait voile vers l'Occident. Sur le pont du navire, il lisait la Bible (12), La terre orientale ne le vit pas s'éloigner sans regret (13). De son côté, il resta sous le charme « de ce berceau du monde et des grandes choses ». Il aimait à en parler à Sainte-Hélène (14). Le silence éternel des Pyramides que son canon avait interrompu, la considération de l'extraordinaire durée du peuple hébreu, dont Moïse était encore le législateur après avoir été son guide du Nil au Jourdain, les clefs de la Palestine qui lui avaient échappé à Saint-Jean d'Acre, tout cela avait laissé du grand dans son âme. Aussi, quand viendra le moment de régler les destinées des israélites, les réminiscences orientales lui feront prendre de haut la question.
Son gouvernement fut l'interprète de ce sentiment, lorsque, dans l'assemblée fameuse que nous rapportons plus loin, il donna à la question juive ce prologue qui ne manque pas de grandeur: « En s'occupant de l'organisation des divers cultes, le gouvernement n'a point perdu de vue la religion juive; elle doit participer comme les autres à la liberté décrétée par nos lois. Le gouvernement a cru devoir respecter l'éternité de ce peuple qui est parvenu jusqu'à nous à travers les révolutions et les débris des siècles, et qui, pour tout ce qui concerne son sacerdoce et son culte, regarde comme un de ses plus grands privilèges de n'avoir que Dieu même pour législateur (15) »
Ce fut donc en Orient que Bonaparte rencontra pour la première fois les fils d'Israël.
IV
La deuxième rencontre se fit en Allemagne, à la suite des armées, le soir des champs de bataille.
Quel contraste, alors, entre lui et eux: lui, dans tout l'éclat de ses qualités militaires, eux, dans la manifestation de leurs passions basses !
C'est la veille de la bataille d'Austerlitz.
Le terrain est favorable aux Russes et aux Autrichiens. Ils occupent un plateau assez élevé, autour duquel se déroulent leurs bataillons. Avec ce merveilleux instinct qui lui faisait tout deviner à la guerre, Napoléon montre le plateau à ses généraux, et dit: « Les Russes feront la faute de l'abandonner: je m'y établis, je coupe en deux leur armée, et ils sont perdus sans ressource. » Les Russes attaquent avant le jour. Une brume épaisse couvre l'immensité du champ de bataille. Vers huit heures le soleil paraît dans tout son éclat. Napoléon arrive au galop, joyeux, superbe comme l'aigle qui mesure sa proie. Il laisse l'ennemi engager une partie de ses forces, et ne lui offre que onze mille braves qui, durant six heures, restent impassibles. Tout à coup, avec ses réserves, Napoléon enlève les hauteurs d'où les Russes sont descendus, enfonce leur centre, les coupe en deux, et force un de leurs corps tout entier à s'aventurer sur des étangs glacés, bientôt entrouverts par les boulets.
C'était l'aigle !
Mais la bataille est finie, le soir est venu: de loin en loin, les derniers grondements du canon ! A la lueur des torches, on dépouille les morts; on estime rapidement et à voix basse tous ces effets déchirés, ensanglantés: à cette estimation, il y a des juifs.
Après le passage de l'aigle, les vautours !
Ce contraste est pénible, mais il est vrai; Napoléon lui-même s'est exprimé en ces termes amers: Ce sont de véritables nuées de corbeaux. On en voyait aux combats d'Ulm, qui étaient accourus de Strasbourg pour acheter des maraudeurs ce qu'ils avaient pillé (16). On sait qu'Ulm prépara Austerlitz. L'historien qui rapporte ces paroles de l'Empereur ajoute: « Napoléon avait de fortes préventions contre cette classe d'hommes (les juifs). Il les avait puisées aux armées, à la suite desquelles marchaient trop souvent des juifs avides de gain et prêts à trafiquer de tout (17). »
Mais, parce qu'il se souvient que dans leurs rangs avaient paru autrefois les Macchabées, l'aigle se dit: Pourquoi ne pas essayer de les transformer, et de les ramener à leur première nature ?
V
Troisième rencontre.
En revenant d'Austerlitz, l'Empereur s'est arrêté à Strasbourg. Aussitôt, de tous les points de l'Alsace, arrivent, aux pieds du souverain, des plaintes et des requêtes extrêmement vives contre l'usure des juifs, les populations sont affolées, ils sont la lèpre de cette malheureuse contrée.
Hideuse mais symbolique maladie, la lèpre, transportée dans le domaine moral, suffirait à prouver que les juifs ont commis, au cours de leur histoire, une grande faute que le ciel ne leur a pas encore pardonnée. Symbolique maladie, disons-nous: en effet, la doctrine chrétienne, signalant son existence dans le domaine moral, a justement nommé de cette appellation dégoûtante le péché et les mauvaises mœurs: la lèpre du péché, la lèpre de l'inconduite ! Oui, vraiment, ceux qui vivent dans l'inconduite, à quelque religion qu'ils appartiennent, sont, au regard très pur de la Divinité, d'horribles lépreux. Mais les fils d'Israël le sont devenus, hélas ! d'une autre manière: par une cupidité sordide et des procédés usuraires. Qu'ils nous permettent et qu'ils nous pardonnent la courte, mais nécessaire corrélation suivante.
Les peuples regardaient la lèpre comme un signe non équivoque de la vengeance céleste; son nom seul inspirait l'horreur. — N'en a-t-il pas été ainsi de l'avarice devenue le stigmate, l'écaille rougeâtre d'Israël, signe non équivoque de la vengeance céleste ? Judas, tu as vendu le Christ pour trente deniers: à cause de toi, tes malheureux frères sont devenus les usuriers, les lépreux du monde !
Dans la lèpre, les membres tombent en lambeaux; mais la plupart du temps, le malade survit. Il semble que cette maladie hideuse en veuille moins à l'existence de l'homme qu'à ses formes, et qu'elle fasse plus consister son triomphe à dégrader qu'à détruire. — Ainsi en est-il du peuple usurier: il est dégradé et ne peut pas mourir !
La lèpre, enfin, est contagieuse, elle s'étend et dévore: et aussi, l'usure ! Quand Napoléon s'arrêta à Strasbourg, l'Alsace parut devant lui dévorée, déchiquetée. Voici les rapports, ou plutôt les plaies, qui furent étalés sous ses yeux:
a) PRÉTS EXCESSIFS. — En général, les juifs exigent 1,50 F par mois pour l'intérêt de 24 francs, ce qui porte l'intérêt des sommes qu'ils prêtent à 75 pour 100 par an. Comme l'intérêt est joint au capital dans les effets qu'ils font souscrire, il est difficile d'obtenir la preuve juridique d'une usure aussi excessive. Il est rare que ceux qui sont réduits à la nécessité d'avoir recours aux juifs puissent se libérer aux époques convenues. A l'échéance, les juifs ne manquent pas d'obtenir des jugements de condamnation et ils forment opposition aux hypothèques. La masse des créances pour lesquelles ils ont obtenu des inscriptions est effrayante: on assure qu'elle dépasse trente millions. Ils ont grand soin de ne pas laisser accumuler les intérêts au-delà de ce que les biens de leurs débiteurs peuvent garantir. Lorsqu'ils croient ne devoir plus accorder de terme, ils poursuivent la vente des biens.
b) EXPROPRIATIONS FORCÉES. — Le produit des expropriations forcées est d'environ
1.500.000 francs par an dans chacun des départements des Haut et Bas-Rhin, et sur cette somme les juifs, d'après les relevés qu'on a faits, ont à peu près les 6/7.
c) CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES. — Le nombre de créances hypothécaires inscrites aux bureaux de conservation, au profit des juifs, depuis le commencement de l'an VII jusqu'au 1er janvier 1806, s'élève à la somme totale de 21.199.826 F, en sorte que, si depuis l'an VII aucune de ces inscriptions n'avait été purgée, les juifs du Haut-Rhin auraient en ce moment pour plus de 23.000.000 de créances hypothécaires sur les propriétaires de ce département.
d) CRÉANCES EXIGIBLES. — En outre de ces créances hypothécaires, il y a aux mains des juifs 10.000.000 de créances exigibles: obligations sous seing privé, lettres de change, billets au porteur. Il est à remarquer que les créances hypothécaires portent surtout sur les biens ruraux.
e) ACCAPAREMENT DES TERRES. — Par les prêts excessifs qu'ils ont faits aux cultivateurs, par les hypothèques qu'ils prennent comme garantie de ces prêts, les juifs se trouvent avoir comme en vasselage une grande partie des terres d'Alsace. La propriété leur est passée parfois plus directement encore entre les mains. — Une foule de cultivateurs ont été forcés en 1793 de quitter leurs foyers pour échapper à la mort. Les juifs ont acquis à vil prix tous ces héritages abandonnés, et, lorsque ceux qui les possédaient sont revenus, spéculant sur leurs affections et leurs misères, ils les leur ont vendus si chèrement que, faute d'un entier paiement ou à force d'intérêts accumulés, ils n'ont pas tardé à devenir une seconde fois propriétaires (18).
Mais parce que l'usure, comme la lèpre, est contagieuse, des domestiques et des journaliers sont venus apporter aux juifs le prix de leurs services ou de leurs journées pour qu'ils les fissent valoir comme leurs propres deniers; et des notaires séduits par eux emploient leur ministère à cacher leur honteux trafic (19).
Pense-t-on qu'en prenant connaissance de tous ces faits l'Empereur ait dû avoir des plis au front et des éclairs dans les yeux ? Mais il se maîtrise, il écoute, il sait écouter ! Aussi bien, que pourrait-il faire, sur l'heure ? Autrefois — et c'est la dernière ressemblance avec les lépreux qu'on isole en les séparant des populations — les juifs étaient isolés, parqués à l'écart dans leurs quartiers, véritables léproseries. Mais la Constituante les a jetés au milieu de la société; et, tout-puissant qu'il est, Napoléon n'oserait les faire rebrousser dans leurs ruelles, avec des lois d'exception (20). Au contraire, il veut les en arracher, et les façonner à la française.
Un autre abus vient grossir son courroux. On instruit Sa Majesté des supercheries qu'ils emploient pour échapper à la conscription. C'était piquer au vif Napoléon ! Chose aggravante: ces supercheries sont imitées: « Partout ce sont de fausses déclarations à l'état civil: les pères déclarent comme filles les garçons qui leur sont nés; et les maires tolèrent ces irrégularités, ils y coopèrent même au besoin en falsifiant les registres de l'état civil. Ce sont encore les juifs qui, les premiers, ont donné l'exemple de cette désobéissance aux lois de la conscription; sur soixante-six juifs qui, dans un laps de dix ans, devaient faire partie du contingent de la Moselle, aucun n'est entré dans les armées; et dans le département du Mont-Tonnerre, jusqu'en 1806, les juifs ont constamment éludé les lois de la conscription (21). » Leur habitude de n'avoir aucun nom patronymique et d'en changer sans cesse favorisait singulièrement ces supercheries.
C'est bien. La cause est entendue. Napoléon promet de faire justice. Il quitte Strasbourg.
VI
Napoléon est à Paris.
Son premier acte dans la question juive est un coup de sabre sur les créances des usuriers de l'Alsace. C'est la juste et pittoresque expression employée par un rabbin sincère. « Napoléon, qui ne plaisantait pas, comme disait Talleyrand déchargea un coup de sabre sur les créances judaïques (22). » Le coup fut porté du palais de Saint-Cloud :
AU PALAIS DE SAINT CLOUD, le 30 mai 1806.
« Sur le compte qui nous a été rendu... que certains juifs n'exerçant d'autre profession que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs dans un état de grande détresse,
Nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à ces fâcheuses extrémités. »
Et le décret ordonne un sursis d'un an à toute exécution de jugements ou contrats, consentis en faveur des juifs, par des cultivateurs non négociants de plusieurs départements septentrionaux de France.
Véritable coup de sabre ! avons-nous dit; néanmoins, l'affaire des Messieurs les juifs ne sera nullement sabrée, grossièrement expédiée: tant s'en faut ! Une des tactiques favorites de l'Empereur, dans les questions et affaires ardues, consistait à débuter par un coup de force, pour intimider, assouplir les oppositions, et mettre brusquement les chances de son côté; puis il procédait, avec sagacité et profondeur, à l'examen de l'affaire sous toutes ses faces.
En effet, quelques jours avant la mesure violente de Saint-Cloud, Napoléon avait saisi le Conseil d'Etat de la question juive, et des incidents très curieux s'y étaient produits. Nous ne rapportons que les principaux d'après le récit fidèle de témoins auriculaires.
M. Molé, jeune et nouvel auditeur, avait fait un rapport qui concluait, contre les juifs, à des mesures défavorables, sorte de retour à des lois d'exception;
M. Beugnot, nommé récemment conseiller, concluait à des mesures mieux en harmonie avec les idées libérales du Conseil d'Etat;
L'entente et la solution paraissent difficiles, l'archichancelier, M. Regnault de Saint-Jeand'Angély, annonça, de la part de l'Empereur, que la discussion se reprendrait devant Sa Majesté, un jour qu'elle présiderait le Conseil.
La séance se tint à Saint-Cloud:
M. Beugnot, qui parlait pour la première fois devant l'Empereur, fut emphatique, prétentieux, déclamateur, tout ce qu'il ne fallait pas être au Conseil d'Etat, où la discussion était une conversation de gens d'affaires, sans recherches, sans phrases, sans besoin d'effet. On voyait que l'Empereur était impatienté. Il y eut surtout une certaine phrase qui parut ridicule: M. Beugnot appelait une mesure qui serait prise par exception contre les juifs une bataille perdue dans les champs de la justice. Quand il eut fini, l'Empereur prit la parole, et avec une verve, une vivacité plus marquée qu'à l'ordinaire, il répliqua au discours de M. Beugnot, tantôt avec raillerie, tantôt avec calme; il parla contre les théories, contre les principes généraux et absolus, contre les hommes pour qui les faits n'étaient rien et qui sacrifiaient la réalité aux abstractions. Il releva avec amertume la malheureuse phrase de la bataille perdue; et, s'animant de plus en plus, il en vint à jurer, ce qui, à ma connaissance, ne lui est jamais arrivé au Conseil d'Etat; puis il termina en disant: « Je sais que l'auditeur qui a fait le premier rapport n'était pas de cet avis, je veux l'entendre. » M. Molé se leva et donna lecture de son rapport;
M. Regnault de Saint-Jean d'Angély prit assez courageusement la défense de l'opinion contraire et même de M. Beugnot; M. de Ségur risqua aussi quelques paroles: « Je ne vois pas, dit-il, ce qu'on pourrait faire. » L'Empereur s'était radouci (23)...
Trois séances furent consacrées, en présence de l'Empereur, à ces préliminaires de la question juive (24).
Dans la première (30 avril 1806), Napoléon prononça les terribles paroles rapportées plus haut: « Ce sont de véritables nuées de corbeaux. On en voyait au combat d'Ulm qui étaient accourus de Strasbourg pour acheter des maraudeurs ce qu'ils avaient pillé. »
Dans la deuxième (17 mai), il insiste sur leur rôle désastreux: « ...Je fais remarquer de nouveau qu'on ne se plaint point des protestants, ni des catholiques, comme on se plaint des juifs; c'est que le mal que font les juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple: ce sont des chenilles, des sauterelles qui ravagent la France. » Alors, un éclair de son génie transperçant cette constitution vicieuse, il s’écrie: « IL FAUT ASSEMBLER LES ETATS GÉNÉRAUX DES JUIFS; je veux qu’il y ait une synagogue générale des juifs à Paris. » La vision de sa gloire lui était revenue, vision calmante, transformatrice, parce qu'elle était encore vassale de Dieu; en effet, il ajoute: « Je suis loin de vouloir rien faire contre ma gloire et qui puisse être désapprouvé par la postérité... Il y aurait de la faiblesse à chasser les juifs; il y aura de la force à les corriger. »
Dans la troisième séance (21 mai), il décharge le fameux coup de sabre dont nous avons parlé: le sursis d'un an imposé aux créances judaïques; prologue véhément, avis aux Etats généraux juifs qui allaient être convoqués: que la docilité à l'Empereur devait se trouver inscrite, quelque part, dans leur Bible et dans leur Talmud ! Au reste, pour que les fils d'Israël n'eussent pas à se méprendre sur les dispositions à avoir, le même décret (30 mai) annonça conjointement et le coup de sabre et la convocation de ces Etats généraux.
VII
Avant de contempler la singulière réunion des dispersés des vieux siècles convoqués, comme dit le décret, dans la bonne ville de Paris, il est d'une grande importance, pour apprécier à leur juste valeur les paroles et les actes de cette réunion, de recomposer par la pensée le milieu historique dans lequel elle s'est tenue. La recomposition des milieux historiques nous est habituelle, le lecteur a dû le remarquer; elle est la condition essentielle d'une critique sincère.
Nous sommes en 1806. Cette année et la suivante, durant lesquelles les israélites convoqués de la France, de l'Italie, de la Hollande, vont se trouver à Paris, forment l'apogée de l'Empire. Entre 1806 et 1807, l'Empire présente un spectacle qui éblouit. Napoléon porte à son front l'auréole du sacre: Pie VII a consenti à couronner le guerrier qui s'était incliné devant le Christ. En dehors des frontières, des traînées de victoires, semblables à des voies lactées, aboutissent à Marengo et à Austerlitz. La France a une prépondérance qui n'a eu d'égale ni sous Richelieu, ni sous Henri IV, à peine au temps de Saint-Louis. Et, quant à son nouveau souverain, qui peut-on faire entrer en parallèle avec lui ? A lui seul, il a chassé l'étranger comme Charles VII, rétabli la religion comme Henri IV et conquis plus de puissance, plus de gloire qu'une longue suite d'aïeux et que l'élan d'un grand siècle n'en avaient donné à Louis
XIV. L'Irlande, la Pologne, le regardent de loin comme un libérateur. Les princes de la vieille Europe tremblent devant lui. A l'intérieur, une amnistie générale aux émigrés rehausse encore les exploits du grand capitaine, qui s'est révélé en même temps homme d'Etat consommé: législation, finances, administration, travaux publics, sécurité générale, tout, sous sa puissante main, vient de changer de face, et justifie l'enthousiasme universel. L'Empereur, simple et austère pour lui-même, s'est entouré d'un grand appareil et d'une cour brillante; ses maréchaux et ses ministres ont été récompensés par des principautés ou des duchés; ses frères entrent dans la famille des rois. A Paris, le Trésor, rempli par la guerre, offre toute sécurité et solde de grands travaux; le pont d'Austerlitz est jeté sur la Seine; les canaux se multiplient; Saint-Denis redevenu sépulture des souverains et Sainte-Geneviève rendue au culte reçoivent des développements importants; on élève la colonne Vendôme avec les canons enlevés à l'ennemi; on construit l'arc de triomphe du Carrousel, et Napoléon fait coïncider la fête donnée à la grande armée avec une exposition de l'industrie française, associant, suivant sa pensée favorite, la gloire civile à la gloire militaire.
C'est au moment de l'agglomération de toutes ces splendeurs que les juifs sont convoqués à Paris !
L'histoire a conservé la réponse du doge de Venise obligé de venir déposer, à Versailles, aux pieds de Louis XIV, les excuses de la république. On lui demandait ce qui avait le plus excité son étonnement au milieu de cette cour somptueuse, dans ce palais de Versailles avec son parc royal, ses allées grandioses et ses mille jets d'eau bouillonnants: « De m'y voir ! » répondit-il. A plus forte raison les juifs, parias humiliés, gênés dans leur contenance, éparpillés, mais convoqués, eux aussi, par le grand homme pour apprendre à devenir comme tout le monde, pourront-ils se dire, en mettant le pied dans ce fastueux Paris et en s'entreregardant: « Ce qui nous frappe le plus, c'est de nous y voir ! »
Après la constatation de l'apogée de l'Empire, il faut encore, pour achever de bien préciser le milieu historique, répondre à ces deux interrogations: quelle idée se fait-on de Napoléon en ces années 1806 et 1807; et quelle idée a-t-il lui-même, de sa mission dans le domaine religieux ?
La France est captivée, il y a de quoi ! Ses soldats, habitués à regarder, sous ses ordres, la victoire comme un article de foi, l'écoutent avec ivresse et n'écoutent pas d'autre enseignement. Dans le civil, l'homme qui distribue souverainement honneurs, titres, pensions, royaumes, est l'objet de telles flatteries, qu'elles peuvent dépasser jusqu'aux désirs du maître. Après Austerlitz, il avait traversé en triomphateur la foule des petits princes de l'Allemagne, et, revenu à Paris, il y a trouvé des honneurs inouïs. Les artistes le représentent tantôt en héros, tantôt en demi-dieu; les médailles reproduisent l'adulation dont Louis XIV avait été l'objet. Cette adulation se glisse jusque dans le catéchisme, qui impose l'amour de Napoléon en même temps que l'amour de Dieu et des parents. Et que devient la liberté, transportée dans l'aire des aigles ? Elle n'a plus d'ailes: l'effroi de cette compagnie la paralyse. Et la résistance des esprits ? Elle est nulle. Aussi le mot du poète Ducis, auquel l'Empereur offrait un siège au Sénat, est-il typique: Je suis un canard sauvage, de ceux qui sentent de loin l'odeur du fusil. Ne perdez pas votre temps: j'aime mieux porter les haillons que des chaînes.
Quand les timides et souples hébreux seront assemblés à Paris, comment se tireront-ils d'affaire ? Le spectacle sera curieux !
Mais quelle idée l'Empereur a-t-il de lui-même, et quelles sont, en réalité, ses convictions religieuses ?
Ne perdons point de vue que nous sommes en 1806, la plus brillante année de l'Empire. Napoléon n'est préoccupé que d'une pensée, d'un culte presque: sa gloire ! Toutefois, à cette date, la gloire de Napoléon se reconnaît encore vassale de Dieu. On a prétendu que, à l'apogée de son règne, il ne se crut plus un homme, mais le héros invincible et divin que proclamaient les poètes (25) » Cette assertion nous semble erronée. Jamais Napoléon n'a banni de son esprit l'idée de Dieu et d'une Providence (26). Quand il commettra la faute, et le crime, de s'attaquer au Pape pour essayer de le dominer, il se persuadera, dans son illusion, qu'il ne s'attaque pas à la religion, encore moins à la Divinité. Qu'était-il, au fond ? déiste: par politique autant que par sentiment religieux. Né pour organiser, pénétré de la pensée de l'ordre, il a compris l'importance du sentiment religieux dans la formation de son Empire, et il ne reviendra jamais de cette idée arrêtée. Le culte est, à ses yeux, le compagnon du sabre pour soumettre les hommes. Parce qu'il est né catholique, et parce que le système un et fort de l'Eglise catholique convient à son génie, il la préfère aux autres religions; mais il trouve les titres des autres religions respectables, et il commande qu'on les respecte. Ce qu'il entend, c'est que les religions dans leur expression publique, c'est-à-dire les cultes, relèvent de lui, comme bienfaiteur, comme organisateur, comme souverain. Il veut tenir les différents cultes dans sa main, ainsi qu'un conducteur de char tient les rênes de l'attelage. Voilà la physionomie religieuse de Napoléon en 1806.
La splendeur de l'Empire à cette date, l'admiration délirante que l'Empereur excite, le rôle de réparateur, d'arbitre et de souverain qu'il prétend exercer à l'égard et au-dessus des religions, n'ont jamais mieux été interprétés et exprimés qu'au sein de l'Assemblée juive qui allait se réunir. Un commissaire de l Empereur dira de son maître: « Si quelque personnage des siècles écoulés revenait à la lumière, et qu'un tel spectacle vînt à frapper ses regards, ne se croirait-il pas transporté dans les murs de la cité sainte, ou ne penserait-il pas qu'une révolution terrible a renouvelé les choses humaines jusque dans leurs fondements ? Il ne se tromperait pas, Messieurs: c'est au sortir d'une révolution qui menaçait d'engloutir les religions, les trônes et les empires que les autels et les trônes se relèvent de toutes parts pour protéger la terre. Une foule insensée avait tenté de tout détruire, un seul homme est venu et a tout réparé. Le monde entier et le passé depuis son origine ont été livrés à ses regards; il a vu répandus sur la surface du globe les restes épars d'une nation aussi célèbre par son abaissement qu'aucun peuple ne le fut jamais par sa grandeur. Il était juste qu'il s'occupât de son sort, et l’on devait s'attendre que ces mêmes juifs qui tiennent une si grande place dans les souvenirs des hommes, fixeraient l'attention d'un prince qui doit à jamais remplir leur mémoire (27). »
Que conclure de tout l'exposé de ce chapitre ? Ceci:
Que l’Empereur est loyal dans le dessein qu'il a conçu de corriger les mœurs des israélites, de les incorporer à son Empire, et de les réconcilier avec les peuples. Nous examinerons ultérieurement si son entreprise a été, de tous points politique et prudente: on doit reconnaître ici qu'elle est loyale. Ce n'est point par affection pour les juifs qu'il tente l’entreprise, il les a traités de « chenilles et de sauterelles »; ce n'est pas, non plus, pour nuire à la religion catholique; l’expression qu'il a employée: « Il faut assembler les Etats généraux des juifs », prouve qu'il exclut tout parallèle religieux; son entreprise n'a qu'un but, conforme à son génie de soldat: mettre les juifs au rang, leur faire emboîter le pas dans son Empire. Mme de Staël écrivait, à cette époque: Napoléon regarde une créature humaine comme un fait ou comme une chose, mais non comme un semblable. Il ne hait pas plus qu'il n'aime; il n'y a que lui pour lui; tout le reste des créatures sont des chiffres. Cette appréciation du grand homme ne manque pas d'une certaine justesse; elle peut s'étendre à sa conduite envers les religions: le judaïsme, pour lui, n'est qu'un chiffre, mais il trouve sa place dans ses calculs.
CHAPITRE II
PARLEMENT JUIF ET GRAND SANHÉDRIN CONVOQUÉS A PARIS (1806-1807). LEUR PHYSIONOMIE ET LA DIRECTION DE L’EMPEREUR. CHAMPAGNY ET MOLÉ.
I. Etonnement de Paris au spectacle d'assemblées hébraïques. L'Assemblée des Notables d'Israël, le 26 juillet 1806. Elle est suivie de la réunion du grand Sanhédrin, le 9 février 1807. Physionomie de ces deux assemblées. — II. Le but de l'Empereur dans cette double convocation; pourquoi d'abord une assemblée des Notables, et pourquoi, ensuite, le grand Sanhédrin ? — III. Composition savante du Sanhédrin: Napoléon y déploie toutes ses qualités d'homme politique. — IV. Direction qu'imprime l'Empereur, à la façon d'une campagne militaire; curieuse correspondance qu'il tient, au sujet de la marche de ces assemblées, avec
M. de Champagny. Rôle secret de ce ministre. — V. Les trois commissaires impériaux: Molé, Portalis, Pasquier. Sang juif dans les veines du jeune comte Molé: il prononce le discours d'ouverture; il oublie d’être bienveillant. — VI. Les présidents israélites. Furtado, au fauteuil de l'assemblée des Notables, Sinzheim, au fauteuil du grand Sanhédrin. Les partis et leurs disputes. — VII. Ivresse et excès dans les louanges juives décernées à Napoléon; l'Ecriture sainte détournée pour autoriser la flatterie; signalement d'un péril formidable pour Israël, dans l'avenir.
I
Après la signature du Concordat, l'Eglise catholique s'était relevée, à Paris, non plus souillée de sang et ne possédant plus que la croix de bois, mais dans un pompeux appareil et à l'ombre d'une épée puissante. Le jour de Pâques 1802, une salve d'artillerie avait salué la première fête chrétienne célébrée depuis 89; le peuple avait entendu avec enthousiasme le son des cloches si longtemps muettes; il était accouru en foule aux rites solennels et s'était nourri avec bonheur de la parole divine.
Un autre spectacle religieux surprit Paris, le 26 juillet 1806, et surtout le 9 février 1807. Des assemblées hébraïques venaient siéger dans la capitale. Après s'être entendu avec l'Eglise catholique, l'Empereur mandait auprès de lui la Synagogue, pour s'entendre avec elle.
Ces assemblées hébraïques allaient être de deux sortes.
La première, plus particulièrement laïque, réunirait les plus distingués d'entre les israélites de France et d'Italie et devait prendre le nom d'Assemblée des Notables; la seconde plus spécialement religieuse, contiendrait dans son sein les rabbins les plus éminents, et s'appellerait le Grand Sanhédrin.
Avant d'indiquer les motifs pour lesquels l'Empereur invitait ces deux sortes d'Assemblées à siéger successivement dans sa capitale et à se compléter l'une par l'autre, esquissons leur physionomie, qui eut le privilège d'intéresser grandement le public parisien, au point qu'on se demandait si la Seine n'était pas le Jourdain, et si la circoncision n'allait pas se rétablir.
L'Empereur cherchait l'effet. Le prestige de l'extraordinaire, qui frappe toujours les imaginations, était un des moyens de sa politique. Aussi l'Assemblée des Notables s'ouvre-telle avec un grand apparat. Cent onze israélites, représentant les départements de France et d'Italie, sont réunis (28). Le local de leurs séances est un bâtiment dépendant de l'Hôtel de Ville, l'ancienne chapelle Saint-Jean; le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine l'ont mise à leur disposition. Paris suit avec curiosité les séances. C'est un parlement juif.
Mais l'intérêt redouble, et aussi l'appareil théâtral, lorsque le grand Sanhédrin, succédant à l'Assemblée des Notables, vient siéger à son tour.
Qu’était-ce, d'abord, que le grand Sanhédrin ?
Il n’y avait rien de plus grand dans l'ancienne république des Hébreux que le Sanhédrin (29). Il formait le Conseil suprême de la nation. Il apparaît pour la première fois après le retour de la captivité à Babylone, vers l'époque machabéenne; sa date est entre l'an 170 et l'an 106 avant Jésus-Christ. Véritable assemblée souveraine, le Sanhédrin avait, dans les derniers temps de la nationalité juive, remplacé la monarchie: aussi son autorité était-elle considérable, tout à la fois doctrinale, judiciaire, administrative. Il interprétait la Loi. Il jugeait les causes majeures. Il exerçait sur l'administration des affaires une exacte surveillance (30). Quant à sa composition, elle était de soixante et onze membres, les présidents compris. Les soixante et onze représentaient les trois classes de la nation: les prêtres; les scribes ou docteurs et interprètes de la Loi; les anciens, pris parmi les chefs de tribu et de famille.
Cette assemblée fameuse ne s'était jamais réunie depuis la ruine de Jérusalem par Titus. Dix-huit cents ans s'étaient donc écoulés, et c'est elle qui vient se réunir à Paris, exhumée et mandée par Napoléon. Il ordonne que tous les usages antiques soient repris et scrupuleusement suivis.
Le lieu des séances est le même que pour l'Assemblée des Notables: l'ancienne chapelle Saint-Jean, contiguë à l'Hôtel de Ville; ses murs austères, qui ont abrité le culte catholique, et maintenant dépouillés de tout ornement, impressionnent.
Les sanhédrites sont au nombre de 71, comme à l'époque des séances à Jérusalem.
Ils portent un costume sévère et sombre, celui que portaient les membres du grand Sanhédrin de l'ancien temps. Le costume du chef ou président est une simarre de velours noir avec une grande ceinture, un large rabat et un bonnet de velours noir à deux cornes garni de fourrures; celui des assesseurs ou vice-présidents, une simarre de soie avec ceinture, une bonnet noir fourré et un large rabat; celui des rabbins consiste en un petit manteau et le rabat; et celui des simples députés est semblable, en moins le rabat, mais l’épée (31).
Là où le calque fidèle sur l'ancien temps excite l'intérêt au plus haut degré, c'est la dénomination des membres, ainsi que la disposition de la salle des séances:
Le président s'appelle Nasi, chef ou prince du Sanhédrin;
Il a deux assesseurs: le premier assesseur, assis à sa droite, est appelé Ab-beth-din, père du tribunal; le second assesseur, assis à gauche, porte le nom de Haham, sage (32).
La salle des séances est disposée, selon l'usage pratiqué dans l'antiquité, en demi-cercle. Le chef et ses deux assesseurs occupent au fond les sièges d'honneur; ils ont à leurs côtés tous leurs collègues assis sur une seule ligne, en demi-cercle, par rang d'âge, les rabbins d'abord et les laïques ensuite, les rabbins sont au nombre de quarante-six, et les laïques, trente-quatre. A chacune des deux extrémités de l'hémicycle est placé un scribe ou secrétaire (33).
Le spectacle de ces sanhédrites n'est pas sans grandeur. En entrant dans ce Conseil des Hébreux, on éprouve un sentiment de respect, presque d'admiration; « le public présent aux séances du grand Sanhédrin a été édifié », écrivent les commissaires impériaux à Napoléon (34).
Mais ceux qui se sentent pénétrés plus profondément que tous les autres, ce sont les membres eux-mêmes du Sanhédrin. L'enthousiasme est général dès la première séance. Il n'en avait pas été ainsi à l'ouverture de l'Assemblée des Notables; les députés s'étaient montrés assez réservés, et même craintifs: en effet, on ne savait pas encore où le tout-puissant maître qui convoquait voulait en venir (35). Au contraire, dans la réunion du Sanhédrin, dès la première séance, le pont de la défiance a été franchi, l'enthousiasme possède tous les esprits, et le chef s'en fait l'interprète dans le discours suivant:
« Docteurs de la loi et Notables d'Israël, glorifiez le Seigneur.
« L'Arche sainte, battue par des siècles de tempêtes, cesse enfin d'être agitée.
« L'élu du Seigneur a conjuré l'orage, l'Arche est dans le port.
« O Israël, sèche tes larmes, ton Dieu a jeté un regard sur toi. Touché de ta misère, il vient renouveler son alliance.
« Grâces soient rendues au libérateur du peuple de Dieu.
« Grâces soient rendues au Héros, à jamais célèbre, qui enchaîne les passions humaines, de même qu'il confond l'orgueil des nations.
« Il élève les humbles, il humilie les superbes: image sensible de la Divinité, qui se plaît à confondre la vanité des hommes.
« Ministre de la justice éternelle, tous les hommes sont égaux devant lui; leurs droits sont immuables.
« Docteurs et Notables d'Israël, c'est à ce principe sacré pour ce Grand Homme que vous devez le bonheur d'être réunis en assemblée pour discuter les intérêts d'Israël.
« En fixant mes regards sur ce Conseil suprême, mon imagination franchit des milliers de siècles. Je me transporte au temps de son institution, et mon cœur ne peut se défendre d'une certaine émotion que vous partagez sans doute avec moi (36). »
Grand Sanhédrin réuni à Paris, du 9 février au 9 mars 1807, par ordre de Napoléon. (Tableau composé d’après les noms conservés avec leur numéro de place dans la collection des procès-verbaux et décisions du grand Sanhédrin)
Demi-arc de cercle de gauche à droite (Plan des Commissaires de l’Empereur lorsqu’ils assistent aux séances) :
Blotz (scribe); G.L. Lorich; Cerf-Jacob Goudchaux; I. Rodrigues; Lypmann Cerf-Berr; Olry-Hayem Worms; Mayer Nathan; Lyon Marx; M. Formiggini; David Lévi; Israël Cohen; Berr Isaac-Berr; Aaron Latis; A. Montel fils; J. Brunswich; E.A. Lattis; E. Deutz; Graziadio Neppi; Bordi Zamonani; Moïse Milhau; J. Roccamartino; Lazare Wolf; I. Calmann; B. Gugenheim;
- M.P.
- Ariani; Sam. Wolf Levi; Ab. Andrade; Seligmann de Paris; Seligmann Durmenach; David Guntzbourg; Isaac Samuel; I. Ouri-Lévi; Seligmann Moïse; Elias Spire; Ventura Foa;
- M.
- Segré (Premier assesseur); David Sinzheim (Président du Sanhédrin); Abraham Cologna (second assesseur); I.R. Feuzi; J. Mayer; Moïse Kanstad; Wolf Eger; Sal. Delvecchio; Bonaventura Modena; J.E. Cracovia; Lazare Hirsch; Moïse Aaron; Judas Bloch; A. Worms; Jacquie Todros; A. Salomon; M. Cohen; Libermann-Samson; A. Roccamartino; Ab. Samuel; Nathan-Salomon; Ab. Mouskat; I. Carmi; S.M. Lévi; Saül Crémieux; Benoît Fanno; Ab. Cahen; S. Costantini; Aaron Schmol; A. Friedberg; Marq Foy; A. Furtado; S. Wittersheim; Baruch Cerf-Berr; Théodore Cerf-Berr; Rodrigues fils; Avigdor; Jonas Vallabrègue (scribe);
Suppléants rabbins :
Mendel Prague; Moïse Hertz Mosbach; Betsallel Milhau;
Suppléants laïques :
J. Emmanuel Ottolenghi; Sam. Ghediglia; Emilio Vita; J. Dreyfoss; Jérémie Hirsch; Felix Levi; Michel Beer (scribe rédacteur);
Mais pour quelles raisons l'Empereur faisait-il ainsi appel à deux sortes d'assemblées ?
II
L'usure avait été la cause occasionnelle qui avait suscité l'intervention de l'Empereur dans la question juive. Mais du moment que sa pensée avait été attirée sur ce sujet, Napoléon l'avait envisagée de ce point de vue supérieur et général qui donnait un caractère de grandeur inusitée aux actes de son gouvernement. Il ne lui suffit plus de chercher un remède contre l'usure, il veut faire disparaître les causes profondes de scission qui séparent les juifs de la masse de la nation, et dont l'usure elle-même était une conséquence.
Mais comment parvenir à ce résultat ?
Quelque immense et absolu que soit son pouvoir, l'Empereur a compris que, pour transformer un peuple tenace et immobilisé comme le sont les descendants d'Abraham, il aboutira à l'impuissance s'il s'en tient uniquement à l'emploi de forces modernes. Armé d'un coup d’œil sûr, il en appelle également aux forces juives elles-mêmes. « Aidez-vous », dit-il à ceux qu'il veut régénérer, « et Napoléon vous aidera ». Voilà pourquoi il convoquait successivement deux sortes d'Assemblées. En effet:
La première, celle de Notables, exprime la représentation nationale juive: c'est un appel au peuple. Le principe nouveau et révolutionnaire de la souveraineté du peuple est appliqué au judaïsme. L'Empereur s'en est expliqué lui-même dans une note secrète. Blâmant l'omnipotence religieuse de tel ou tel rabbin durant les siècles du Moyen Age, il dit: « Le droit de législation religieuse ne peut appartenir à un individu, il doit être exercé par une Assemblée générale des juifs légalement et librement réunis, et renfermant dans son sein des juifs espagnols, portugais, italiens, allemands et français, représentant les juifs de plus des trois quarts de l'Europe (37). » A cette assemblée de députés juifs, on posera des questions, on sollicitera leurs réponses, et, ces réponses données, on les fera sanctionner par une sorte de concile hébraïque.
Ce concile hébraïque ou le Sanhédrin est, dans la pensée de l'Empereur, le grand moteur de la régénération projetée. Les Notables, en effet, ou les députés, ne sont après tout que des particuliers, sans autre autorité que celle de leur mérite personnel. Or Napoléon veut se créer un point d'appui plus solide pour agir sur la masse de la population juive. Il le cherche dans une institution oubliée depuis les anciens temps, et qui doit donner aux décisions de l'Assemblée civile la consécration du pouvoir religieux (38).
C'était tout à la fois logique et hardi. Comment cette idée du grand Sanhédrin est-elle venue à Napoléon ? Vraisemblablement, quelque fils d'Israël la lui a suggérée (39).
« SA MAJESTÉ SE PROPOSE DE CONVOQUER LE GRAND SANHÉDRIN CE CORPS, TOMBÉ AVEC LE TEMPLE, VA REPARAITRE POUR ÉCLAIRER PAR TOUT LE MONDE LE PEUPLE QU’Il GOUVERNAIT (40). »
Quand cette annonce fut faite à l'improviste dans l'Assemblée des Notables, une émotion indescriptible s'empara de tous les membres. Il sembla à ces descendants des tribus, dont l'imagination toujours brûlante était subitement rafraîchie par cette surprise, que Jérusalem, la ville-morte, s'agitait déjà dans son linceul !
III
L'Assemblée des Notables exprime la représentation nationale juive, elle doit aider l'Empereur dans l'entreprise de régénération.
Le grand Sanhédrin sera la consécration de l'entreprise par la religion juive.
Voilà bien la pensée de l'Empereur, et aussi la gradation.
Mais Napoléon n'a pas laissé l'une et l'autre assemblée se composer au hasard, ni à leur gré; après avoir déterminé leur raison d'être et leur gradation, il a voulu être sûr de leurs éléments, c'est-à-dire s'assurer une majorité dévouée dans les deux Assemblées.
Le succès a été assez facile dans la composition de l'Assemblée des Notables. Au lieu de les faire nommer par tous les israélites de France et d'Italie, il les a fait désigner souverainement par les préfets. Or, comme bien on pense, ceux-ci n'ont pas commis la faute de choisir les israélites les plus hostiles aux volontés de l'Empereur.
Mais c'est dans la composition du grand Sanhédrin que Napoléon a particulièrement déployé ses qualités d'homme politique. Le ministre de l'Intérieur, qui était alors M. de Champagny, avait proposé à Sa Majesté de composer cette deuxième assemblée juive d'hommes entièrement nouveaux comme cela se pratique pour les deux Chambres d'un pays où les hommes de la Chambre haute ne sont pas ceux de la Chambre basse, et réciproquement. Cette proposition semblait assez rationnelle. L'Empereur ne l'a point goûtée: « Ce n'est pas une pensée heureuse (41) », a-t-il écrit à M. Champagny; et alors il a prouvé à son ministre que les membres déjà captivés de l'Assemblée des Notables devaient contribuer à faire des captures dans le grand Sanhédrin, exactement comme des oiseaux déjà privés contribuent à rendre captifs d'autres oiseaux encore sauvages. Quinze à dix-sept rabbins avaient trouvé rang dans l'Assemblée des Notables. Ils sont donc soigneusement conservés pour le Sanhédrin, ainsi que d'autres Notables laïques apprivoisés (42). Trente nouveaux rabbins, appelés des différentes parties de l'Empire, s'empressent d'accourir aux accents de l'appeau. La majorité est bien assurée à l'Empereur dans l'une et l'autre assemblée: lorsque les Notables auront dit amen aux propositions impériales, les Sanhédrites y ajouteront alléluia.
IV
Il ne suffit pas à Napoléon, toujours prévoyant, d'avoir composé les deux assemblées juives à sa guise, c'est lui encore qui les dirigera.
S'immiscer dans les affaires hébraïques est bien la dernière tentation qui soit jamais venue à un homme d'Etat. Outre que cette immixtion réclame d'ardues connaissances préalables, elle n'offre rien de gai et d'attrayant. Mais le grand capitaine ne doute de rien, il dirigera ces hébreux, à la façon d'un corps d'armée. Déjà il a prescrit qu'il y aurait deux étapes à parcourir: l'Assemblée des Notables, puis le Sanhédrin. Il a ensuite trié les meilleurs juifs des communautés juives comme on trie des soldats parmi les meilleures troupes. Il lui reste à commander ce qu'il y a à faire: il commandera.
La collection de toutes ces têtes dures ne se méprit nullement sur la direction militaire qui l'attendait, et elle se garda bien d'opposer de la résistance. On savait que celui qui avait dit, le 18 brumerai, au Conseil des Anciens: Songez que je marche accompagné du dieu de la fortune et du dieu de la guerre, voulait être obéi en législation, obéi comme l'avait été Moïse en descendant du Sinaï, et mieux que lui ! Les vieilles barbes d'Ephraïm et d'Issachar le comprirent sans peine. On avait dit de Bonaparte: « Ce n'est pas seulement en généralissime de l'armée qu'il débute, c'est en maître. Les vieux généraux frémissent devant le guerrier adolescent. Ils ne peuvent soutenir ces brèves paroles qui les interrogent, ce regard qui les perce, cette volonté qui les subjugue. Ils se sentent à la fois attirés et contenus. Ils se rangent, ils admirent, ils se taisent, ils obéissent, et le reste de l'armée avec eux. » A plus forte raison, nos timides et souples hébreux vont-ils se ranger, admirer, se taire, obéir !
Mais Napoléon a parfaitement compris la nécessité d'adoucir ses allures de rude guerrier. La question politique s'enchevêtre ici dans une question religieuse; et, de plus, le peuple Juif n’est pas aussi commode à mener que les autres peuples. C'est pourquoi, adroit à « couler » ses volontés, le César adopte deux manières de diriger ces assemblées hébraïques: l'une officielle, représentée par trois commissaires qui apporteront devant les députés l'expression de ses volontés; mais l'autre officieuse, qui préparera et adoucira la mission impérative des trois commissaires.
Cette direction dans l'ombre est confiée à M. de Champagny.
M. de Champagny, alors ministre de l'Intérieur, était aveuglément dévoué à Napoléon, qui, de son côté, l'avait en particulière estime pour ses rares qualités de sagacité, de patience d'abnégation. Futur négociateur du mariage de l'Empereur avec Marie-Louise, il allait donner ses preuves en négociant un accommodement entre le jeune César et la vieille Synagogue. Il fut donc choisi par Napoléon pour être, sous ses ordres, le stratégiste secret de la question juive, et préparer le succès de ses plans de régénération. Il lui adressa, à cet effet, des lettres et des notes explicatives, précieux documents qui, aujourd'hui publiés, prouvent que l'Empereur a mené la question hébraïque à la façon d'une campagne militaire. Pour ménager l'amourpropre de leurs nationaux, les historiens israélites ont raconté que l'Assemblée des Notables et le grand Sanhédrin avaient siégé dans la pleine possession de leurs lumières et de leur liberté. Il n'en fut rien. Ils ont subi les volontés impériales pour le fond et pour la forme, pour les grandes lignes et pour les détails, sauf sur l'article des mariages, comme nous le racontons plus loin. La correspondance entre Napoléon et M. de Champagny témoigne jusqu'à quel point l'Empereur avait mûri son plan de campagne. Il n'a rien laissé à l'imprévu, ni à la discrétion des juifs. Ils siégeront autant de journées que le leur permettra leur impérial régulateur. Ils répondront comme il prescrira de répondre. Le Souverain écrit en ces termes à
M. de Champagny:
Rambouillet 13 mars 1806.
Monsieur Champagny, je vous envoie des notes qui vous feront connaître la direction que je désire donner à l'assemblée des juifs, et ce que les commissaires près cette assemblée ont à faire en ce moment.
Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.
NAPOLÉON.
Ces notes peuvent se classer ainsi:
Instructions données par l'Empereur pour établir un pont entre l'Assemblée des Notables et le grand Sanhédrin (43);
Instructions pour s'assurer les suffrages des rabbins, et forcer à capituler ceux qui se montreraient revêches (44);
Instructions pour trouver dans la Loi de Moïse elle-même un principe illuminateur qui devra subjuguer tous les juifs du monde en leur persuadant qu'ils peuvent concilier leurs nouveaux devoirs de citoyens avec leurs antiques croyances (45). Ce fut le chef-d'œuvre de la stratégie. Napoléon fouille dans la Loi de Moïse et en extrait un principe qui force les juifs à se rendre prisonniers sur leur propre territoire biblique. Nous exposons cette stratégie dans le chapitre qui fait suite à celui-ci.
M. de Champagny est le confident de ces projets, il reçoit les notes, les instructions, les communique aux intéressés. Il est comme l'ingénieur chargé de disposer les mines qui vont faire sauter de vieilles habitudes. Il apporte aussi, tout bas, les leçons du maître pour qu'on les apprenne et qu'on se garde, en public, d’y changer un iota.
V
Les trois commissaires du gouvernement expriment, eux au contraire, la direction officielle de l'Empereur. Ce sont trois membres du Conseil d'Etat: MM. Molé, Portalis et Pasquier.
Suivant les recommandations expresses de Napoléon, les commissaires demandent « qu'il soit formé un comité de neuf membres choisis parmi les israélites les plus éclairés de l'Assemblée, avec lesquels ils puissent travailler et amener de grands résultats (46) ». Ce Comité des neuf d'une part, ces trois commissaires de l'autre, constituent en quelque sorte l'état-major à la tête duquel Napoléon va manœuvrer (47).
Promptitude à s'assurer toujours l'initiative, c'est une des qualités de son génie. Voilà pourquoi il nommait ici trois commissaires qui viendront faire connaître, au fur et à mesure, ses volontés. Par eux il exprimera, le premier, son avis comme une décision.
Il a, sur tout sujet, des connaissances et des idées ou s'en forme facilement: c'est une autre qualité de son génie. En cette question hébraïque qu'il n'a pas rencontrée dans les Vies de Plutarque, s'il lui manque quelque connaissance, il se la procure à l'instant auprès de ce Comité des Neuf, par l'entremise de ses commissaires.
Le choix des trois commissaires, fait avec une extrême habileté, concorde avec une mise en scène de sentiments que Napoléon déploie comme des ressources militaires. L'Empereur, en effet, excellait à séduire, comme aussi à intimider. Séduction et intimidation étaient deux moyens de réussite qu'il employait à merveille. Les commissaires dont il a fait choix expriment admirablement cette séduction et cette intimidation qui lui seront utiles auprès des juifs réunis.
L'un, en effet, est Portalis, chargé de l'administration des cultes, plein de tact et d'expérience. C'est lui qui a négocié le Concordat. En le faisant passer des pourparlers avec l'Eglise aux pourparlers avec la Synagogue, Napoléon montre le cas qu'il fait des hébreux (48). Portalis lui servira donc à les séduire (49).
Mais avec le jeune comte Molé, il les intimidera. Celui-ci n'a que vingt-six ans; il est fier, superbe. Par les qualités de son esprit et la distinction de sa personne, il a plu à l'Empereur auquel M. de Fontanes, grand-maître de l'Université, l'a présenté et il a été nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat. L'Empereur le juge propre au rôle d'intimidateur, il ne se trompe pas. Un autre motif, dit-on, l'aurait fait choisir: Molé a du sang d'Abraham dans les veines. « Ce n'était pas sans dessein que l'Empereur avait fait choix du jeune Molé, descendant du célèbre garde des sceaux, et dont un autre ancêtre, le premier président Mathieu Molé, avait épousé, le 22 septembre 1733, la fille du riche et célèbre banquier juif Samuel, comte de Coubert 23, » La présence de ce jeune et brillant personnage, issu de sang israélite, était un stimulant pour encourager les juifs de l'Assemblée à se fondre dans la nationalité française. D'autre part, il n'est guère douteux que le jeune comte eût préféré que cette particularité de ses origines fût tombée dans l'oubli. Car il se montra dur pour cette réunion d'israélites et leur commanda avec hauteur 24, Si Napoléon a songé à Moïse en donnant des lois à la Synagogue, Molé, dans la main de l'Empereur, a parfaitement rappelé sa verge.
Il fait, entouré des deux autres commissaires, l'ouverture de l'Assemblée des Notables en ces termes:
« Messieurs,
« Sa Majesté l'Empereur et Roi, après nous avoir nommés ses commissaires pour traiter des affaires qui vous concernent, nous envoie aujourd'hui pour vous faire connaître ses intentions. Appelés des extrémités de ce vaste Empire, aucun de vous cependant n'ignore l'objet pour lequel Sa Majesté a voulu vous réunir.
« Vous le savez, la conduite de plusieurs de ceux de votre religion a excité des plaintes qui sont parvenues au pied du Trône: ces plaintes étaient fondées, et pourtant l'Empereur s'est contenté de suspendre le progrès du mal, et il a voulu vous entendre sur les moyens de le guérir. Vous mériterez sans doute des ménagements si paternels et sentirez quelle haute mission vous est confiée. Loin de considérer le gouvernement sous lequel vous vivez comme une puissance de laquelle vous ayez à vous défendre, vous ne songerez qu'à l'éclairer, à coopérer avec lui au bien qu'il prépare; et ainsi, en montrant que vous avez su profiter de l'expérience de tous les Français, vous prouverez que vous ne vous isolez pas des autres hommes.
« Les lois qui ont été imposées aux individus de votre religion ont varié par toute la terre. L'intérêt du moment les a souvent dictées. Mais, de même que cette assemblée n'a point d'exemple dans les fastes du Christianisme, de même, pour la première fois, vous allez être jugés avec justice, et vous allez voir, par un prince chrétien, votre sort fixé. Sa Majesté veut que vous soyez Français; c'est à vous d'accepter un pareil titre, et de songer que ce serait y renoncer que de ne pas vous en rendre dignes.
« On va vous lire des questions qui vous sont adressées. Votre devoir est de faire connaître, sur chacune d'elles, la vérité tout entière. Nous vous le disons aujourd'hui, et nous vous le répéterons sans cesse: lorsqu'un monarque aussi ferme que juste, qui sait également tout connaître, tout récompenser et tout punir, interroge ses sujets, ceux-ci, en ne répondant pas avec franchise, se rendraient aussi coupables qu'ils se montreraient aveugles sur leurs véritables intérêts.
« Sa Majesté a voulu, Messieurs, que vous jouissiez de la plus grande liberté dans vos délibérations: à mesure que vos réponses seront rédigées, votre président nous les fera connaître.
« Quant à nous, notre vœu le plus ardent est de pouvoir apprendre à l'Empereur qu'il ne compte parmi ses sujets de la religion juive que des sujets fidèles, et décidés à se conformer en tout aux lois et à la morale que doivent suivre et pratiquer tous les Français (52). »
Les députés étaient donc avertis. Sous le vague calculé du langage du commissaire, perçait fort bien la volonté ferme et décidée du maître (53).
L'historien israélite Gratz dit du discours d'ouverture du jeune comte: « L'allocution que fit Molé était excessivement froide, et, en partie, blessante (54). »
VI
Nous connaissons maintenant la manœuvre du grand capitaine:
Des questions, tenues secrètes, vont être posées au judaïsme;
Deux assemblées juives ont été convoquées, l'une civile, pour discuter, ou plutôt, pour accepter ce que l'Empereur proposera dans ces questions; l'autre, religieuse, pour le consacrer doctrinalement.
Les préfets de l'Empire ont choisi, dans les départements, les notables les plus souples et les rabbins les moins revêches;
M. de Champagny fait connaître officieusement dans les groupes la pensée et les volontés de son maître;
Les trois commissaires du gouvernement, MM. Molé, Portalis et Pasquier, les expriment officiellement.
Voilà l'évolution de Napoléon et de son état-major;
Quelle est l'attitude correspondante des deux Assemblées ?
Ce qui doit arrêter, avant tout, nos regards, ce sont les deux personnages qui occupent le fauteuil de la présidence, l'un, dans l'Assemblée des Notables, l'autre dans le grand Sanhédrin.
Elus à la pluralité des voix, le président des Notables est Abraham Furtado, et celui du Sanhédrin, David Sitzheim.
Abraham Furtado descendait d'une de ces familles israélites du Portugal qui cachaient soigneusement le secret de leur croyance, pour pratiquer, dans la profondeur des plus obscurs souterrains, les principales cérémonies du culte de leurs ancêtres. Encore dans le sein de sa mère, qui habitait Lisbonne, il perdit son père dans la fameuse catastrophe du tremblement de terre de cette ville, en 1755. Sa mère se trouva ensevelie sous les décombres d'une maison et y resta une journée entière. Des soldats qui passaient par hasard la retirèrent de dessous les ruines; elle se rendit à Londres, et ce fut dans cette dernière ville qu'elle mit au monde Abraham. Ramené à Bordeaux, devenu grand et riche, Furtado s'était voué entièrement à l'étude. Malesherbes l'avait appelé dans son conseil, lorsque, sur l'ordre de Louis XVI la question de l'entrée des israélites dans la société avait été, pour la première fois, examinée. Et maintenant, c'est lui encore que Napoléon consulte de préférence, au moment de donner à cette âpre et difficile question sa solution définitive. Ses coreligionnaires, dans l'Assemblée des Notables, l'ont donc porté au fauteuil de la présidence. Il possédait avec une rare éloquence un tact exquis dans la gestion des affaires. La beauté de son organe, la noblesse de ses traits, la majesté de son port, ajoutaient encore à l'impression qu'il produisait (55).
David Sinzheim, élu président du grand Sanhédrin, était rabbin à Strasbourg. Tous ses coreligionnaires le vénéraient pour son âge, son caractère, sa grande douceur, son savoir, sa piété. A une physionomie patriarcale il joignait l'avantage d'être le beau-frère du célèbre Cerfberr; celui-ci était mort, mais le souvenir de son crédit auprès de Louis XVI, de ses luttes avec Strasbourg, de ses fatigues pour la cause d'Israël subsistait impérissable: il se traduisit dans les votes donnés à son parent. Le président du Sanhédrin passait également pour le talmudiste le plus fort de son époque. L'historien israélite Grätz émet cependant une réserve au milieu de ses louanges: « David Sinzheim était très versé dans la connaissance du Talmud, mais il était sans profondeur d’esprit (56). »
Autour de ces deux noms, Furtado et Sinzheim, brillent et gravitent d'autres illustrations:
Le premier assesseur au grand Sanhédrin est le rabbin Segré, de Verceil;
Le second assesseur est le rabbin Cologna, de Mantoue; Beer Isaac Berr, l'israélite de Nancy dont le rôle a été si remarquable devant l'Assemblée constituante, continue à faire ici grande figure: il a disputé le fauteuil de la présidence des Notables à l'éminent Furtado;
Avigdor et Michel Berr, chargés des procès-verbaux, écrivent avec talent.
Mais, entre ces pâles visages, entre ces vieux cerveaux si longtemps d'accord, s'accusent ouvertement, pour la première fois, des divergences. Suscitées par la philosophie du XVIIIe siècle, elles ne feront qu'augmenter et partageront Israël en deux camps; elles portent sur les coutumes talmudiques. Il y a le parti des pieux qui y reste cramponné. Il y a le parti des progressistes qui veut qu'on les sacrifie sur l'autel de la nouvelle patrie adoptive. Deux rites, également, sont en présence, qui ne se supportent pas, le rite portugais et le rite allemand, comme, autrefois, Jérusalem et Samarie. Enfin, l'élément laïque se dresse en face de l'élément rabbinique: perfide nouveauté, introduite en Israël par Napoléon. Parfois, les discussions menaceront d'être très vives dans l'intérieur des deux Chambres juives (57). Mais cette pensée: « On nous écoute aux portes, on nous regarde aux fenêtres », amènera une facile concentration des opinions. Le conseil donné jadis par Joseph à ses frères se rendant de l'Egypte dans la terre de Chanaan pour en amener leur vieux père: Ne vous disputez pas en chemin (58), a toujours plané sur les assemblées et conciliabules hébraïques. Au Sanhédrin de Paris, sorte de grand chemin où les israélites sont en marche pour entrer dans leur nouvelle patrie civile, ils se disputent; mais le lien de race, aidé de la recommandation de Joseph, fait que l'entente triomphe. Et puis, l'Empereur attend !...
VII
Cette redoutable personnalité était bien faite pour obliger à l'harmonie, en sa présence. L'unité dans l'obséquiosité et l’adulation a été complète au milieu de nos hébreux. Il n'est pas croyable combien ils ont flatté. Dans la suite, un de leurs historiens les plus complets mettra tous ses soins à dégager Israël de cette idolâtrie dégoûtante (59); mais il reste acquis qu'à cette époque, qui va des victoires de Marengo et d'Austerlitz à la paix de Tilsitt, Israël a été littéralement fasciné. Il est juste de reconnaître qu'on avait devant soi l'exemple de la moitié de l'Europe à genoux devant Napoléon, et le traitant de demi-dieu. Mais il y a cette particularité grave dans les adulations qui sortaient des Assemblées juives, qu'elles détournaient et appliquaient à Napoléon des expressions et des figures exclusivement réservées au Messie, et qu'elles abaissaient devant lui la majesté des Ecritures (60). Qu'on en juge:
L'Assemblée des Notables tenait ses séances. Arrive le jour anniversaire de la naissance de Napoléon (15 août). Une sorte d'ivresse s'empare de l'Assemblée. La Synagogue de Paris est transformée en temple païen (61), le portrait le l'Empereur y est suspendu, entouré de fleurs; et alors discours et odes se débitent, où l'encens remplace celui qui ne s'est plus brûlé depuis le départ de Jérusalem. Ombres des vieux Prophètes, vous avez dû frémir en entendant qu'on détournait les Ecritures pour autoriser la flatterie !
Le rabbin Segré, député du département de la Sésia, dit: A peine ce matin les premiers rayons de l'aurore venaient d'éclairer mes yeux, que déjà s'offraient en foule à ma pensée les victoires de Montenotte, les palmes et les lauriers de Marengo, les glorieux exploits et les triomphes d'Austerlitz.
Ce n'est donc point un songe, m'écriai-je ? il a paru véritablement sur la terre un Génie surnaturel, entouré d'une grandeur et d'une gloire infinies:
Et voici qu'avec les nuées du ciel, venait le Fils de l’homme: Et l'Ancien des jours lui donna la puissance, l’honneur et le royaume.
(DANIEL, VII, 13.)
Déjà renaît et resplendit ce jour de joie et d'allégresse universelle, marqué par les astres en caractères ineffaçables; jour, plus que les autres, pur et serein; jour à jamais heureux où le ciel donna à la terre le grand Napoléon (62).
C'est Daniel, prophétisant la majesté du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Messie, qui est ainsi plié à la louange de Napoléon.
Le rabbin Sinzheim, député de Strasbourg, dit:
Texte (ISAÏE, ch. XLII), Voici mon serviteur dont je prendrai la défense; voici mon élu dans lequel mon âme a mis toute son affection. Je répandrai mon esprit sur lui, et il rendra justice aux nations: il ne sera point triste ni précipité quand il exercera son jugement sur la terre, et les îles attendront sa loi. Je suis le Seigneur qui vous ai conservé, qui vous ai établi pour être le réconciliateur du peuple et la lumière des nations.
... Il a choisi Napoléon pour le placer sur le trône de la France et de l'Italie; on doit lui appliquer les paroles de mon texte: Je répandrai mon esprit sur lui.
Et en effet, considérez ses œuvres merveilleuses, ses premières campagnes d'Italie, ses exploits en Asie et en Afrique, ses secondes campagnes d'Italie, enfin ses campagnes étonnantes d'Allemagne, et cette bataille d'Austerlitz à jamais mémorable, dont la brillante paix de Presbourg fut le fruit. Pourrait-on après cela hésiter un moment d'appliquer à notre invincible Empereur le verset d'Isaïe ? De lui encore, ne faut-il pas dire: Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus: Je l'ai pris par la main pour lui assujettir les nations, pour mettre les rois en fuite, pour ouvrir devant lui toutes les portes, sans qu'aucune lui soit fermée. Je marcherai devant vous, j'aplanirai les montagnes et les collines, je romprai les portes d'airain. N'est-ce pas de la sorte que notre invincible Empereur a franchi ce mont réputé inaccessible, le Saint-Bernard, pour remporter la victoire immortelle de Marengo ? Le Seigneur aplanit tous les obstacles devant lui, et il pénètre dans les pays ennemis; il rompt les portes d'airain, cette forteresse d'Ulm, garnie de fortifications. Cette forteresse était occupée par une armée innombrable, mais dès que l'élu du Seigneur paraît, on voit s'accomplir ce que dit Isaïe (XLI, 11): Tous ceux qui vous combattront seront confondus; tous ceux qui s'opposeront à vous seront réduits au néant et périront.
Les îles lointaines attendent ses lois; en réunissant les nations. il les éclaire sur leurs véritables intérêts (63) !
C'est Isaïe, parlant également du Messie, qui, à son tour, est plié à la louange de Napoléon.
Le rabbin Abraham Cologna, député de Mantoue, lit une ode en hébreu; ces stances sont applaudies:
Vers d'immortelles pensées j'élèverai mon esprit; mes cantiques célébreront des faits d'inconcevable grandeur. Oh ! puissé-je, aux sources sacrées, trouver pour mes paroles de doux rayons de miel ! puissent-elles à la fois se revêtir d'agrément, d'éclat et de force !
C'est du plus grand des monarques que je chanterai les exploits, d'un mortel dont nul jusqu'ici n'égala la grandeur. Tous les princes devant lui me paraissent dépouillés de leur éclat; leur grandeur devant la sienne n'est plus, et s'évanouit dans le néant.
Par où commencerait-on à célébrer les actions de l'homme qui, dans le temple de la mémoire, a gravé tant de merveilles ! Qui pourrait raconter ses victoires, ses prodiges ! ou plutôt, qui pourrait fixer le nombre des étoiles du firmament, et qui, sans être ébloui, pourrait regarder l'astre du jour !
C'est dans le bonheur de gouverner avec équité qu'il a placé les délices de son cœur; jusqu'aux siècles reculés, le nom de père des peuples lui écherra en partage. Il a gravé leur bonheur perpétuel sur les tables de ses lois; la couronne de législateur, les lauriers triomphants, décorent son front d'une grâce égale (64).
Si ces stances expriment des idées justes, grands hommes de l'antiquité juive, Abraham, Moïse, David, et vous, Messie, annoncé par eux, rangez-vous tous au-dessous de Napoléon: c'est la place que vous adjuge le Parlement israélite de France !
Voilà pour la Chambre des Notables.
Au Sanhédrin, on ne sut pas garder plus de mesure. Du reste, les mêmes hommes, récompensés pour leurs louanges chez les Notables (65), reparaissent.
Le rabbin Cologna, devenu assesseur ou vice-président du Sanhédrin, dit dans le discours d'ouverture:
Il est donc vrai que le génie prodigieux de l'immortel Napoléon, émanation de l'esprit vivifiant de l'Eternelle Sagesse, rappelle à une nouvelle existence les membres desséchés et désunis des restes d'un peuple aussi célèbre par ses malheurs qu'il l'avait été par son ancienne gloire !
... Ce génie créateur, qui parmi les mortels est le mieux formé à l'image de Dieu, en suit les traces sublimes (65). »
La flatterie est-elle assez écœurante ?
Le rabbin Sinzheim, devenu président du grand Sanhédrin, dit dans le discours de clôture:
... L'Eternel a gardé sa promesse; il a dit du haut de sa demeure sainte: Quel est celui qui viendra au secours de mon peuple ?... Quel est celui qui le protégera contre ses oppresseurs ? Je l'ai nommé mon élu; ma volonté l'a choisi pour être le dominateur des nations et pour répondre ses bienfaits sur les hommes. Le héros dont les peuples de la terre rechercheront le salut et l'alliance sera le libérateur d'Israël; le héros qui renversera le trône des superbes et relèvera celui des humbles est le même que je destine à retirer de la poussière les descendants de l'antique Jacob. Je réserve à mon peuple un protecteur grand par sa sagesse, grand par ses hauts faits, grand par ses lumières, grand par ses vertus. Je l'ai appelé, je l'ai sanctifié; et toutes les nations reconnaîtront par ses œuvres que je n'ai point réprouvé mon peuple, et que je n'ai point retiré mes affections du milieu d'Israël (67).
Et encore:
... Et toi, Napoléon, toi le bien-aimé, toi l'idole de la France et de l'Italie, toi la terreur des superbes, le consolateur du genre humain, le soutien des affligés, le père de tous les peuples, l'élu du Seigneur, Israël t'élève un temple dans son cœur; toutes ses pensées se porteront sans cesse vers tout ce qui peut combler ta félicité.
Dispose, oui, dispose entièrement de la vie et des sentiments de ceux que tu viens de mettre au rang de tes enfants, en les faisant participer à toutes les prérogatives de tes sujets les plus fidèles (68).
Peut-on abaisser davantage la Divinité ?
Il est à remarquer que toutes ces louanges, détournées des Ecritures avec profanation, ont été décernées par des rabbins. Le président de l'Assemblée des Notables, M. Furtado, un laïque, se contenta de comparer Napoléon à un dieu de la Fable (69) !
Un grave enseignement doit être tiré de cet ensemble excessif de louanges et de cet encens profané:
L'éblouissante splendeur du règne de Napoléon à cette époque, la main secourable qu'il tendait aux juifs, le lustre dont il voulait même les envelopper par la résurrection du grand Sanhédrin, les traitant en peuple qui doit avoir, comme les autres, ses grandes assemblées; toutes ces nouveautés, tous ces bienfaits ont dû tourner quelque peu la tête aux députés de tant de synagogues jusqu'ici humiliées, et leur faire, par reconnaissance, dépasser les bornes de la louange; il fallait s'attendre à cette ivresse, et il y aurait injustice à lui refuser des circonstances atténuantes. Mais ce qui ne saurait être excusé, c'est l'attribution à Napoléon des grandes et saintes expressions dont la Bible se sert à l'égard du Messie. Aveugles et fils d'aveugles qui, pour avoir méconnu autrefois le Messie là où il était, s'excitaient une fois de plus, avec délire, à le chercher là où il ne sera jamais ! De doctes exégètes et de graves auteurs ont exprimé cette crainte, malheureusement fondée: que les juifs, avant de se tourner pour tout de bon vers le Dieu fait homme, Christ promis à leurs pères, se laisseront séduire une dernière fois par la personnalité formidable qui doit être l’Antéchrist. En effet, qu'un conquérant se présente avec le cortège de victoires qui fut celui de Napoléon; que ce conquérant protège les juifs, qu'il renouvelle pour eux les prévenances et séductions de l’Empereur, qu'il les dépasse: la fascination ne recommencera-t-elle pas, et les Ecritures ne seront-elles pas, de nouveau, profanées ? L'imagination populaire, dans ses visions craintives de l’Antéchrist, se le représente avec des cornes, et lui prodigue des laideurs: qu'on se détrompe, l'homme de mal aura toutes les séductions (70).
Israélites, vous n'avez pas su vous contenir à l'égard de Napoléon: vous contiendrez-vous mieux devant le formidable roi temporel, que vous rêvez toujours ?
CHAPITRE III
LES TRAVAUX DES DEUX ASSEMBLÉES SERVILITÉ, RÉSISTANCE, SINCÉRITÉ
I. Le questionnaire impérial: douze questions posées officiellement par le comte Molé aux Assemblées juives. — II. Leçon faite, la veille, aux députés par M. de Champagny pour leur intimer la manière de répondre. — III. Préambule solennel des réponses: l’Assemblée des Notables range la Loi de Moïse au-dessous du Code Napoléon; et le Sanhédrin scinde, sur l'ordre secret de l'Empereur, la Loi mosaïque en deux parts dont l'une est déclarée inapplicable et surannée. — IV. Réponses de l'Assemblée des Notables au questionnaire impérial; la leçon est docilement répétée; mais échec de l'Empereur sur la question des mariages mixtes. — V. Le grand Sanhédrin sanctionne les réponses des Notables et continue leur inflexibilité sur la question des mariages mixtes. Enumération des décisions doctrinales, enlevées au pas de course. — VI. Correspondance loyale au dessein de Napoléon. Sincérité des réponses israélites sur l'amour de la patrie, sur l'usure, sur le service militaire. Magnifique hommage de reconnaissance rendu par l'Assemblée des Notables à la Papauté et au Clergé catholique de tous les siècles. —VII. Satisfaction de l'Empereur de l’issue des séances.
I
Le jeune comte Molé, suivi des deux autres commissaires, Portalis et Pasquier, est entré dans l'Assemblée des Notables au début de la deuxième séance (29 juillet), un papier à la main.
C'est un questionnaire impérial.
Avant d'en faire la lecture, il commence, dans un discours d'ouverture que nous connaissons déjà (voir plus haut pages 50-52) par un avertissement qui présente le joug à l'Assemblée en feignant de croire à son indépendance. Rappelons-en ce Joli passage:
« On va vous lire les questions qui vous sont adressées; votre devoir est de faire connaître sur chacune d'elles la vérité tout entière. Nous vous le disons aujourd'hui, et nous le répéterons sans cesse: lorsqu'un monarque aussi ferme que juste, qui sait également tout connaître, tout récompenser et tout punir, interroge ses sujets, ceux-ci, en ne répondant pas avec franchise, se rendraient aussi coupables qu'ils se montreraient aveugles sur leurs véritables intérêts. Sa Majesté veut que vous jouissiez de la plus grande liberté dans vos délibérations. »
Que renferme le questionnaire ? Posées à l'Assemblée par l'Empereur et Roi, les questions étaient au nombre de douze: 1° Est-il licite aux juifs d'épouser plusieurs femmes ? 2° Le divorce est-il permis par la religion juive ?
Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux, et en vertu de lois
contradictoires à celles du Code français ? 3° Une juive peut-elle se marier avec un chrétien, et une chrétienne avec un juif ? Ou la loi juive veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux ?
4° Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères. ou sont-ils des étrangers ? 5° Qu'est-ce que la loi leur prescrit à l'égard des Français qui ne sont pas de leur religion ? 6° Les juifs français regardent-ils la France comme leur patrie ?
Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d'obéir aux lois, et de suivre les dispositions du Code civil ? 7° Qui nomme les rabbins ? 8° Quelles sont leurs fonctions ? 9° Leur autorité n'est-elle fondée que sur l'usage ? 10° Plusieurs professions sont-elles interdites aux juifs ? 11° L'usure est-elle permise légalement ? 12° L'usure est-elle permise à l'égard des étrangers (71) ?
Ces douze questions, si l'on y prend garde, se référaient à quatre groupes: Les trois premières traitaient de la polygamie, du divorce, et des mariages entre israélites et chrétiens;
Les trois suivantes s'occupaient des rapports autorisés par la loi hébraïque entre israélites et Français; Les questions 7, 8 et 9 concernaient l’organisation intérieure des israélites; Les dernières visaient plus particulièrement les choses relatives au commerce.
II
« Sa Majesté veut que vous jouissiez de la plus grande liberté dans vos délibérations », venait de dire, avec une pompeuse complaisance et un imperturbable sang-froid, le comte Molé.
Or, la veille et les jours précédents, M. de Champagny, ce préparateur ou appariteur secret de la question juive dont nous avons esquissé le rôle ci-dessus (p. 45-46), avait pris toutes ses mesures pour assurer le triomphe du programme qu'il avait reçu de son maître, dans des notes confidentielles.
Ces notes contenaient, outre le questionnaire dont venait donner lecture le comte Molé, les réponses que devront faire Messieurs les Juifs. Le contraste est piquant entre l'excitation à la liberté venant du commissaire du Gouvernement, et le résultat à obtenir impérativement tracé à M. de Champagny;
Les notes disent:
PREMIÈRE QUESTION. — Est-il licite aux juifs d’épouser plusieurs femmes ? (IL FAUT que la réponse négative soit positivement énoncée, et que l'Assemblée constituée en grand Sanhédrin défende en Europe la polygamie.)
DEUXIÈME QUESTION. — Le divorce est-il permis par la religion juive ? Le divorce est-il valable, sans qu'il soit prononcé par les tribunaux, et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français ? (IL FAUT que l'Assemblée défende le divorce, hors les cas permis par la loi civile dans le Code de Napoléon, et qu'il ne puisse avoir lieu qu'après avoir été prononcé par l'autorité civile.)
TROISIÈME QUESTION. — Une juive peut-elle se marier avec un chrétien, et une chrétienne avec un juif ? Ou la loi juive veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux. (IL FAUT que le grand Sanhédrin déclare que le mariage religieux ne peut avoir lieu qu'après avoir été prononcé par l'autorité civile, et que des juifs ou juives puissent épouser des Français ou Françaises. IL FAUT MÊME que les grands rabbins recommandent ces unions, comme moyens de protection et de convenance pour le peuple juif.)
SIXIÈME QUESTION. — Les juifs français regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre ? (IL FAUT que le Sanhédrin déclare que les juifs doivent défendre la France comme ils défendraient Jérusalem, etc.)
SEPTIÈME QUESTION. — Qui nomme les rabbins ? (IL FAUT que le Sanhédrin décide (72)... etc.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sont-ils assez reluisants, tous ces IL FAUT ? On dirait des canons, non d'Eglise, mais d'acier, placés en tête de chaque question du Concile hébraïque, et prêts à enfiler rabbins et députés !
« Sa Majesté veut que vous jouissiez de la plus grande liberté dans vos délibérations », venait de déclarer le comte Molé;
« Il faut... il faut... qu'on réponde de telle manière »! enjoignait Sa Majesté à M. de Champagny; et celui-ci a pris toutes ses mesures pour que la leçon, faite par lui, en particulier, aux différents groupes, soit bien retenue.
O liberté, née de la Révolution et élevée dans le palais de César, que tes deux fronts sont remarquables ! et que ton avenir promet !
III
Les mesures, avons-nous dit, sont bien prises. En effet voulant, avant tout, s'assurer d'un poste avantageux et d'un point d'opération fixe, l'Empereur a encore donné cet ordre dans ses notes secrètes, à M. de Champagny:
« Pour marcher d'une manière régulière, il faudrait déclarer qu'il y a dans les lois de Moïse des dispositions religieuses et des dispositions politiques; que les dispositions religieuses sont immuables, mais qu'il n'en est pas de même des dispositions politiques qui sont susceptibles de modifications... Après la déclaration de ce principe viendra l'application (73). »
Forcer les juifs à capituler sur leur propre territoire et à abandonner leurs vieux usages, en scindant la Loi de Moïse en deux portions, dont l'une sera déclarée inapplicable et surannée, ne sera-ce pas le chef-d'œuvre de la stratégie de Napoléon dans sa campagne hébraïque ? Il y a encore ce mot de lui, dans ses notes secrètes à M. de Champagny: « Il faut ôter des lois de Moïse tout ce qui est intolérant (74)... »
Nos hébreux vont-ils prêter le flanc à cette stratégie ?
Voici, d'abord, l'Assemblée des Notables. Elle tient sa troisième séance (4 août 1806). On va répondre au questionnaire impérial. Mais une déclaration solennelle précède les réponses. Que proclame cette déclaration ?
« L'Assemblée, vivement pénétrée des sentiments de reconnaissance, d'amour, de respect et d'admiration pour la personne sacrée de Sa Majesté Impériale et Royale, déclare, au nom des Français qui professent la religion de Moïse, que, pour se rendre dignes des bienfaits que Sa Majesté leur prépare, ils sont dans l'intention de se conformer à ses volontés paternelles; que leur religion leur ordonne de regarder comme loi suprême la loi du Prince en matière civile et politique; qu'ainsi, lors même que leur Code religieux ou les interprétations qu'on lui donne renfermeraient des dispositions civiles ou politiques qui ne seraient pas en harmonie avec le Code français, ces dispositions cesseraient dès lors de les régir, puisqu'ils doivent avant tout reconnaître la loi du Prince et lui obéir (75) »
Du coup, la Loi de Moïse était rangée au-dessous du Code Napoléon. Le Judaïsme se mettait à la discrétion de César. Cette soumission à la loi du Prince, exprimée avec tant d'ardeur, rappelle la réflexion de Bossuet: « Qu'as-tu fait ô peuple ingrat ?... Souviens-toi de cette parole de tes pères: Nous n'avons point d'autre roi que César. Le Messie ne sera pas ton roi; garde bien ce que tu as choisi: demeure l'esclave de César et des rois jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée, et qu'enfin tout Israël soit sauvé (76). »
Pénétrons maintenant, de l'Assemblée des Notables, dans le Sanhédrin:
Les 71 sont assis en demi-cercle, comme à Jérusalem. Ils vont faire précéder leurs décisions doctrinales d'un préambule: sera-t-il plus indépendant que la déclaration des Notables ?
Histoire, prête l'oreille, et enregistre:
PRÉAMBULE DES DÉCRETS
« Béni soit à jamais le Seigneur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France et du royaume d'Italie un Prince selon son cœur.
« Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob, et il a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde.
« Le Seigneur juge les pensées, lui seul commande aux consciences, et son Oint chéri a permis que chacun adorât le Seigneur selon sa croyance et sa foi.
« A l'ombre de son nom, la sécurité est entrée dans nos cœurs et dans nos demeures; et nous pouvons désormais bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'Etat, le servir et nous glorifier de ses nobles destinées.
« Sa haute sagesse a permis que cette Assemblée célèbre dans nos annales, et dont l'expérience et la vertu dictaient les décisions, reparût après quinze siècles et concourût à ses bienfaits sur Israël.
« Réunis aujourd'hui sous sa puissante protection dans sa bonne ville de Paris, au nombre de soixante et onze, docteurs de la loi et notables d'Israël, nous nous constituons en grand Sanhédrin, afin de trouver en nous le moyen et la force de rendre des ordonnances religieuses conformes aux principes de nos saintes lois, et qui servent de règle et d'exemple à tous les israélites.
« Ces ordonnances apprendront aux nations que nos dogmes se concilient avec les lois civiles sous lesquelles nous vivons. et ne nous séparent point de la société des hommes.
« EN CONSÉQUENCE, DÉCLARONS:
« Que la loi divine, ce précieux héritage de nos ancêtres, contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques;
« Que les dispositions religieuses sont, par leur nature, absolues et indépendantes des circonstances et des temps;
« Qu'il n'en est pas de même des dispositions politiques, c'est-à-dire de celles qui constituent le Gouvernement, et qui étaient destinées à régir le peuple d'Israël dans la Palestine lorsqu'il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats;
« Que ces dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis qu'il ne forme plus un corps de nation (77)... »
Sauf le ton un peu emphatique du préambule, c'est la répétition, mot à mot, de la leçon faite, la veille, par M. de Champagny d'après les instructions secrètes de l'Empereur, et scrupuleusement retenue par les 71.
La stratégie de l'Empereur a réussi, les juifs ont capitulé sur leur propre territoire, la Bible est scindée: le reste sera accordé à peu près sans résistance.
IV Un auteur a dit, avec une pointe d'ironie: « Les députés israélites savaient dans quel sens ils devaient répondre pour être agréables, et, comme c'étaient en grande majorité des hommes très distingués et élevés bien au-dessus des préjugés vulgaires, i1 est permis de penser que
leurs réponses, conformes aux désirs de Napoléon, étaient conformes aussi à leur conviction personnelle (78). » Les questions proposées étaient donc au nombre de douze. Nous ne reproduirons pas, de
crainte de fatiguer le lecteur, les longues dissertations qui sortirent de l'Assemblée des Notables: il suffira d'énumérer le précis des réponses pour constater que chaque notable avait bien retenu la leçon faite en particulier, et qu'aux reluisants Il faut, consignés dans les instructions secrètes à M. de Champagny, correspondaient, dans les rangs de l'Assemblée, des amen alignés et sonores comme des armes qu'on présente à un chef militaire !
L'Assemblée décida. comme conformes à la Loi française: La monogamie; La validité du divorce uniquement avec le consentement des tribunaux du pays; La faculté de contracter mariage avec les chrétiens: Les Français sont les frères des juifs français; Il n'existe pas de différence dans la manière de traiter des coreligionnaires ou des
compatriotes chrétiens; La France est notre patrie; Le mode d'élection des rabbins n'est pas déterminé; Leur influence est fondée sur l'usage; Ils ne jouissent d'aucune autorité; Nulle profession n'est interdite; L'usure est contraire à la Loi mosaïque; elle est honteuse.
Dans cette adhésion ponctuelle aux vues de l'Empereur, il y eut cependant une réserve, presqu'une résistance, qui fait honneur au sang d'Abraham: ce fut sur la question des mariages mixtes. Napoléon avait dit dans ses notes écrites à M. de Champagny: Il faut que des juifs ou juives puissent épouser des Français ou Françaises. Il faut même que les grands rabbins recommandent ces unions comme moyen de protection et de convenance pour le peuple juif (79). Or, quand vint, dans l'Assemblée des Notables, l'examen de cette troisième question, une irritation très vive s'empara d'un grand nombre de membres, surtout des rabbins, aux yeux desquels le cours du sang d'Abraham allait devenir trouble, comme un fleuve qui reçoit des affluents. Les rabbins voulaient donner, seuls, la décision, à l'exclusion des laïques, parce que « de même que lorsqu'il s'agit de décider de points astronomiques, on s'adresse uniquement à des astronomes, de même on doit laisser aux théologiens tout ce qui a trait à la Religion (80) »; et les rabbins allemands en particulier exigeaient que la décision fût d'une rigueur inexorable « parce qu'ils ressentaient de grandes inquiétudes de conscience sur cette question qui visait le judaïsme au cœur (81) ». On ne pouvait cependant dire carrément non au terrible César. On répondit: « Que la loi religieuse ne prohibait absolument le mariage qu'avec les sept nations chananéennes, Amon et Moab (dans le passé), et les idolâtres (dans le présent); que les nations modernes ne sont pas idolâtres, puisqu'elles adorent un Dieu unique; que plusieurs mariages mixtes s'étaient accomplis, à différentes époques, entre les juifs et les chrétiens en France, en Espagne et en Allemagne; mais que les rabbins ne seraient pas plus disposés à bénir le mariage d’une chrétienne avec un juif, ou d'une juive avec un chrétien, que les prêtres catholiques ne consentiraient à bénir de pareilles unions (82). »
La réponse ne manquait pas d'habileté.
L'Empereur, satisfait des réponses sur tout le reste, ne se montra nullement mécontent de l'échec sur les mariages mixtes: il se flattait de le réparer auprès du grand Sanhédrin.
V
Le rôle et la fonction du grand Sanhédrin, dans la pensée de Napoléon, devaient consister à traduire en décrets doctrinaux les décisions des Notables, couronnant ainsi le travail de la représentation nationale hébraïque par la sanction et le prestige de la religion.
Au point de vue purement humain, cette gradation dans l’entreprise présentait de l'habileté et de la grandeur, nous l’avons fait remarquer dans ce qui précède (page 41).
Le Sanhédrin s'apprêta à être docile, comme l'Assemblée des Notables, aux vues et leçons impériales; mais, chose remarquable et honorable ! les sanhédrites continuèrent l'inflexibilité des Notables dans la question des mariages mixtes. Cette inflexibilité sauva le sang d'Abraham. Elle était providentielle. Ce sang que la Providence avait protégé contre toutes les passions de l'homme et les invasions des peuples antiques dans les tentes d'Israël, afin d'en faire sortir le Messie, elle le protégeait encore contre les attentats de la Révolution et les visées d'un potentat superbe qui ne pensait qu'à mêler et fusionner. O César, tu as ton étoile, mais Israël a ses destinées: elles doivent le conduire jusqu'au dernier soir du monde, et il importe que son sang demeure sans mélange, afin qu'il puisse répondre: présent ! et être reconnu sans peine, quand le Dieu des batailles l'appellera comme suprême réserve ! Tout ce que Napoléon put obtenir du Sanhédrin se borna à éloigner l'anathème des mariages mixtes: ils ne seraient pas bénis par les rabbins, mais ils ne seraient pas, non plus, anathémisés par eux.
A part cet article essentiel, tout ce que l'Empereur exigeait fut voté et enlevé au pas de course. Napoléon avait coutume de ne pas laisser, à ceux qu'il voulait subjuguer, le temps de la réflexion. Huit séances furent consacrées à une législation nouvelle et impromptue qui remuait de fond en comble la loi de Moïse. Pour le seul Décalogue, le grand législateur des hébreux avait passé quarante jours sur le Sinaï: les nouveaux législateurs n'eurent, de par l'Empereur, que trente jours, durant lesquels se tinrent huit séances, du 9 février au 2 mars (1807)... Voici leurs décrets, présentés ici dans leurs conclusions substantielles.
DECISIONS DOCTRINALES
I. POLYGAMIE. — Il est défendu à tous les israélites de tous les Etats où la polygamie est prohibée par les lois civiles et, en particulier, à ceux de l'Empire de France et du Royaume d'Italie, d'épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu'un divorce avec celle-ci, prononcé conformément aux dispositions du Code civil et suivi du divorce religieux, ne les ait affranchis des liens du mariage.
II. RÉPUDIATION. — Il est expressément défendu à tout rabbin dans les deux Etats de France et du Royaume d'Italie de prêter son ministère dans aucun acte de répudiation ou de divorce, sans que le jugement civil qui le prononce lui ait été exhibé en bonne forme. Tout rabbin qui se permettrait d'enfreindre le présent statut religieux sera regardé comme indigne d'en exercer à l'avenir les fonctions.
III. MARIAGE. — Il est défendu à tout rabbin ou autre personne dans les deux Etats de France et d'Italie, de prêter leur ministère à l'acte religieux du mariage, sans qu'il leur ait apparu auparavant de l'acte des conjoints devant l'officier civil, conformément à la loi. — Les mariages entre israélites et chrétiens, contractés conformément aux lois du Code civil sont obligatoires et valables civilement; et, bien qu'ils né soient pas susceptibles d'être revêtus des formes religieuses ils n'entraîneront aucun anathème.
- IV.
- FRATERNITÉ. — Le grand Sanhédrin ordonne à tout israélite de l'Empire français et du Royaume d'Italie, et de tous autres lieux, de vivre avec les sujets de chacun des Etats dans lesquels ils habitent comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqu'ils reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, parce qu'ainsi le veut la lettre et l'esprit de la loi de Moïse.
- V.
- RAPPORTS MORAUX. — Le grand Sanhédrin prescrit à tous les israélites, comme devoirs essentiellement religieux et inhérents à leur croyance, la pratique habituelle et constante, envers tous les hommes reconnaissant Dieu créateur du ciel et de la terre, quelque religion qu'ils professent, des actes de justice et de charité dont les Livres saints leur prescrivent l'accomplissement.
VI. RAPPORTS CIVILS ET POLITIQUES. — Tout israélite né et élevé en France et dans le Royaume d'Italie et traité par les lois des deux Etats comme citoyen, est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d'obéir aux lois et de se conformer, dans toutes ses transactions, aux dispositions du Code civil. Tout israélite appelé au service militaire est dispensé par la loi, pendant la durée de ce service, de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui.
VII. PROFESSIONS UTILES. — Le grand Sanhédrin ordonne à tous les israélites, et en particulier à ceux de France et d'Italie, qui jouissent maintenant des droits civils et politiques, de rechercher et d'adopter les moyens les plus propres à inspirer à la jeunesse l'amour du travail, et à la diriger vers l'amour des arts et métiers, ainsi que des professions libérales, attendu que ce louable exercice est conforme à notre sainte religion, favorable aux bonnes mœurs, essentiellement utile à la patrie, qui ne saurait voir dans les hommes désœuvrés et sans état que de dangereux citoyens. Il les invite en outre d'acquérir des propriétés foncières, comme un moyen de s'attacher davantage à leur patrie, de renoncer à des occupations qui rendent les hommes odieux ou méprisables aux yeux de leurs concitoyens, et de faire tout ce qui dépendra de nous pour acquérir leur estime et leur bienveillance.
VIII. PRÊT ENTRE ISRAÉLITES. — Le grand Sanhédrin déclare et ordonne, comme devoir religieux, à tous les israélites de n'exiger aucun intérêt de leurs coreligionnaires, toutes les fois qu'il s'agira d'aider le père de famille dans le besoin, par un prêt officieux. Il statue, en outre, que le profit légitime du prêt entre coreligionnaires n'est religieusement permis que dans le cas de spéculations commerciales qui font courir un risque au prêteur, ou en cas de lucre cessant, selon le taux fixé par la loi de l'Etat.
IX. PRÊT ENTRE ISRAÉLITES ET NON ISRAÉLITES. — Le grand Sanhédrin déclare à tous les israélites, et particulièrement à ceux de France et d'Italie, que les dispositions prescrites par la décision précédente sur le prêt officieux ou à intérêt d'hébreu à hébreu, ainsi que les principes et les préceptes rappelés par le texte de l'Ecriture Sainte sur cette matière, s'étendent tant à nos compatriotes, sans distinction de religion, qu'à nos coreligionnaires; il leur ordonne à tous, comme préceptes religieux, de ne faire aucune distinction à l'avenir en matière de prêt entre concitoyens et coreligionnaires, le tout conformément au statut précédent. Quiconque transgressera la présente ordonnance violera un devoir religieux et péchera notoirement contre la loi de Dieu. Il déclare en outre, que toute usure est indistinctement défendue, non seulement d'hébreu à hébreu et d'hébreu à concitoyen d'une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur. Il ordonne enfin à tous les rabbins, dans leurs prédications et leurs instructions de ne rien négliger auprès de leurs coreligionnaires pour accréditer dans leur esprit les maximes contenues dans la présente décision.
Ces décisions doctrinales exprimaient exactement les vues de l'Empereur: elles étaient calquées sur les notes envoyées à M. de Champagny. Tous avaient fait leur devoir: Champagny, en avertissant en secret; les commissaires, en exigeant en public; les sanhédrites, en répondant comme ils le faisaient.
VI
Si Napoléon a été loyal dans l'entreprise qu'il avait conçue de fondre les israélites dans la société, bien qu'il l'ait conduite militairement, il est juste de reconnaître que, de leur côté, les israélites ont apporté une correspondance également loyale au dessein de l'Empereur. Cette loyauté est apparente non seulement dans leur docilité, mais dans certaines particularités qui se rattachent aux séances et dont quelques-unes sont restées célèbres.
Lorsque le comte Molé, avant de donner lecture du fameux questionnaire impérial, prononça le sévère discours d'ouverture qui froissa les Notables, parce qu'il émettait des doutes sur leur attachement à leurs nouveaux devoirs; et lorsque, au cours de la lecture du questionnaire, il arriva à la sixième question: Les juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens regardent-ils la France comme leur patrie et se croient-ils obligés de la défendre ? l'Assemblée, ne pouvant contenir son émotion, s'écria tout d'une voix: Oui, jusqu'à la mort (83).
L'usure fut également flétrie avec sincérité. On ne saurait nier que le Talmud n'admette l'usure exercée contre les chrétiens, si même il ne la prescrit. Ces sordides dispositions sont la quadruple conséquence: de la perversion du caractère national d'Israël depuis le crime du Golgotha; de la haine et de la jalousie inextinguibles entretenues contre les chrétiens; des représailles que ce peuple souvent spolié opposait à ses oppresseurs; et enfin des malheurs inhérents à sa longue dispersion. Quelles que soient les causes et les circonstances atténuantes, ces sordides dispositions n'en sont ni moins détestables ni moins antisociales. L'Assemblée juive de 1807 eut le mérite et la sincérité de le reconnaître. Si elle n'eut pas le courage de convenir que les mots usuriers et juifs sont devenus synonymes par une sorte de châtiment extraordinaire, elle dégagea l'antique et beau judaïsme de ce reproche, et elle flétrit hautement l'usure: Il était temps, s'écrie le président des Notables, que cette habitude si souvent reprochée aux israélites comme un effet de leur religion, reçut par un tribunal israélite essentiellement religieux la flétrissure ineffaçable qu'elle mérite (84).
Et voici cette flétrissure:
« Docteurs de la Loi et Notables,
« Nul d'entre vous ne saurait révoquer en doute que, si nous vivions encore sous les institutions civiles et politiques de nos ancêtres, si nous formions un Etat, si nous conservions les mœurs patriarcales du temps d'Abraham ou de Moïse, et qu'il existât dans Israël de ces hommes que l'opinion publique flétrit si justement sous le nom d'usuriers, nul d'entre vous, dis-je, ne doute qu'ils ne fussent ignominieusement chassés de son sein comme infracteurs des lois divines, et ne cessassent d'appartenir et à la société religieuse et à la société civile.
« Eh bien, ce qu'eussent fait les magistrats et les lois chez nos ancêtres, c'est à vous, ministres du culte, qu'il appartient aujourd'hui de le faire, à l'aide de l'influence religieuse et morale que vous donnera le ministère respectable que vous remplirez.
« Tonnez contre cette habitude déshonorante et antisociale (85) ! »
Et encore:
« Qu'on ne vienne pas nous objecter qu'un vice, que la Loi proscrit dans Israël, puisse être toléré envers les étrangers. Il n'y a dans la Loi ni deux poids ni deux mesures; elle est une et par conséquent obligatoire envers les étrangers.
« Il est donc indispensable, il est donc de notre devoir de censurer hautement ces excès destructeurs de toute morale publique; il est essentiel d'opposer une digue à ce torrent dévastateur. Que ceux qui se sont avilis, au point de méconnaître et d'altérer ainsi la pureté de la morale d'Israël, rentrent en eux-mêmes; qu'ils rougissent de leur ignorance; qu’ils s’empressent d'abandonner tous ces excès; qu'ils inspirent à leurs enfants des sentiments conformes aux lois divines et humaines; qu'ils reprennent, puisqu'ils en ont la liberté, l’agriculture, les arts et les métiers qui ont illustré nos ancêtres; alors , seulement alors, ils auront accompli la Loi, et se rendront agréables et au Dieu d'Israël et aux hommes (86) »
Là où la correspondance loyale des députés au dessein de l’Empereur n'a pas moins d'éclat, c'est dans leur adhésion complète à la conscription militaire. Les juifs l'avaient en horreur; ils la fuyaient, l'éludaient, nous l'avons dit plus haut (pages 20-21). Mais, pour plaire à Napoléon, il n'est aucune répugnance qu’ils ne soient prêts à surmonter. Les éloges qu'ils lui ont prodigués ont dépassé le but, ils ont été excessifs; mais l'effusion de leur reconnaissance n'a pas consisté seulement dans des paroles outrées, elle s'est manifestée par des actes où ils ont soulevé, en hommes forts, leur nature devenue lâche sous le poids séculaire des humiliations: ils ont accepté avec entrain le service des armes pour tous leurs coreligionnaires, entre les mains desquels ils ont rapporté l'épée des Macchabées. Le jour de la fête de l'Empereur, le rabbin Segré s'écriait: « Maintenant que notre sort est lié à celui de la patrie, notre cœur pour ainsi dire s'est déjà ennobli. Embrassons avec ardeur une félicité qui nous fut si longtemps inconnue; demandons des armes pour défendre de toute insulte cette patrie si chère (87). »
En conséquence de ce vœu, la Commission des Neuf inscrivait dans son projet d'organisation des synagogues de l'Empire:
L’ASSEMBLÉE DES ISRAÉLITES DE L’EMPIRE DE FRANCE ET DU ROYAUME D’ITALIE
... Considérant que c'est le devoir de tous les israélites de l'Empire français et du Royaume d'Italie, de verser leur sang dans les combats pour la cause de la France, avec ce même dévouement et cette même valeur que les ancêtres combattaient autrefois les nations ennemies de la Cité sainte, et de chercher les occasions de se rendre dignes des bienfaits qu'un grand prince daigne en ce moment répandre sur eux;
Arrête:
Que les Consistoires achèveront de détruire par leur intervention et leur zèle l'éloignement que pourrait avoir la jeunesse israélite pour le noble métier des armes (88).
Mais le plus éclatant témoignage de leur sincérité fut incontestablement, l'hommage spontané qui sortit de leurs rangs à l'adresse de la Papauté et du clergé catholique de tous les siècles. On était arrivé à la clôture de l'Assemblée des Notables; la protection de Napoléon le Grand remplissait d'ivresse, d'étonnement et de reconnaissance tous les représentants. Quelle différence, pensaient-ils, avec les humiliations du passé ! Néanmoins, derrière cette protection du grand capitaine, leur regard aperçut une autre protection qui, pacifique et ininterrompue, les avait couverts à toutes les sombres périodes de leur histoire: celle des Papes et du clergé catholique. Et alors, comme un nuage d'encens, leur reconnaissance monta de la sphère politique dans la sphère religieuse. Emouvant et magnifique fut cet hommage ! il présenta quelque analogie avec le cantique de Moïse après le passage de la mer Rouge. Le Législateur des hébreux avait remercié dans les plus beaux transports de la langue sainte, le Dieu tout-puissant d'avoir arraché son peuple à la servitude de l'Egypte; l'étonnant discours qu'on va lire, applaudi par toute l'Assemblée de 1806, frémissante et debout, vint remercier la Papauté d'avoir protégé Israël durant la servitude de dix-huit siècles au milieu des nations. C'est au député de Nice, M. Avigdor, que revient l'honneur d'avoir fait entendre, au nom des juifs rassemblées et dispersés, ces nobles et touchants accents:
Les plus célèbres moralistes chrétiens ont défendu les persécutions, professé la tolérance et prêché la charité fraternelle.
Saint Athanase (liv. Ier) dit: « C’est une exécrable hérésie de vouloir tirer par la force, par les coups, par les emprisonnements, ceux qu'on n'a pu convaincre par la raison. »
« Rien n est plus contraire à la religion, dit Justin martyr (liv. V), que la contrainte. » « Persécuterons-nous, dit saint Augustin, ceux que Dieu tolère ? » Lactance (liv. III) dit à ce sujet: « La religion forcée n'est plus religion; il faut persuader et non contraindre; la religion ne se
commande point. » Saint Bernard dit: « Conseillez, et ne forcez pas. » C’est par suite de ces principes sacrés de morale que, dans différents temps, les Pontifes
romains ont protégé et accueilli dans leurs Etats les juifs persécutés et expulsés de diverses parties de l'Europe; et que les ecclésiastiques de tous les pays les ont souvent défendus dans plusieurs Etats de cette partie du monde.
Vers le milieu du septième siècle, saint Grégoire défendit les juifs et les protégea dans tout le
monde chrétien. Au dixième siècle, les évêques d'Espagne opposèrent la plus grande énergie au peuple qui voulait les massacrer.
Le pontife Alexandre II écrivit à ces évêques une lettre pleine de félicitations pour la conduite
sage qu'ils avaient tenue à ce sujet. Dans le onzième siècle, les juifs, en très grand nombre dans les diocèses d'Uzès et de Clermont, furent puissamment protégés par les évêques.
Saint Bernard les défendit dans le douzième siècle de la fureur des croisés. Innocent II et Alexandre III les protégèrent également. Dans le treizième siècle, Grégoire IX les préserva, tant en France qu'en Angleterre et en
Espagne, des grands malheurs dont on les menaçait; il défendit, sous peine d'excommunication, de contraindre leur conscience et de troubler leurs fêtes.
Clément V fit plus que de les protéger il leur facilita encore les moyens d'instruction. Clément VI leur accorda un asile à Avignon, alors qu'on les persécutait dans tout le reste de l'Europe.
Vers le milieu du même siècle, l'évêque de Spire empêcha la libération que les débiteurs des juifs réclamaient de force, sous le faux prétexte d'usure si souvent renouvelé.
Dans les siècles suivants, Nicolas II écrivit à l'Inquisition, pour l'empêcher de contraindre les juifs à embrasser le christianisme.
Clément XIII calma l'inquiétude des pères de famille, alarmés sur le sort de leurs enfants qu'on arrachait souvent du sein de leur propre mère.
Il serait facile de citer une infinité d'autres actions charitables dont les israélites ont été à diverses époques l'objet, de la part des ecclésiastiques instruits des devoirs des hommes et de ceux de leur religion.
Le peuple d'Israël, toujours malheureux et presque toujours opprimé, n'a jamais eu le moyen ni l'occasion de manifester sa reconnaissance pour tant de bienfaits; reconnaissance d'autant plus douce à témoigner, qu'il la doit à des hommes désintéressés et doublement respectables.
Depuis dix-huit siècles, la circonstance où nous nous trouvons est la seule qui se soit présentée pour faire connaître les sentiments dont nos cœurs sont pénétrés.
Cette grande et heureuse circonstance, que nous devons à notre auguste et immortel Empereur, est aussi la plus convenable la plus belle comme la plus glorieuse, pour exprimer aux philanthropes de tous les pays, et notamment aux ecclésiastiques, notre entière gratitude envers eux et envers leurs prédécesseurs.
Empressons-nous, Messieurs, de profiter de cette époque mémorable, payons-leur ce juste tribut de reconnaissance que nous leur devons; faisons retentir dans cette enceinte l'expression de toute notre gratitude. Témoignons-leur avec solennité nos sincères remerciements pour les bienfaits successifs dont ils ont comblé les générations qui nous ont précédés.
Le procès-verbal termine ainsi:
« L'assemblée a applaudi au discours de M. Avigdor; elle en a délibéré l'insertion en entier dans le procès-verbal, ainsi que l'impression, et a adopté l'arrêté qui suit:
« Les députés de l'Empire de France et du Royaume d'Italie au synode hébraïque, décrété le 30 mai dernier, pénétrés de gratitude pour les bienfaits successifs du clergé chrétien, dans les siècles passés, en faveur des israélites des divers Etats de l'Europe;
« Pleins de reconnaissance pour l'accueil que divers Pontifes et plusieurs autres ecclésiastiques ont fait dans différents temps aux israélites de divers pays, alors que la barbarie, les préjugés et l'ignorance réunis persécutaient et expulsaient les juifs du sein des sociétés;
« Arrêtent que l'expression de ces sentiments sera consignée dans le procès-verbal de ce jour, pour qu'elle demeure à jamais comme un témoignage authentique de la gratitude des israélites de cette assemblée pour les bienfaits que les générations qui les ont précédés ont reçus des ecclésiastiques de divers pays de l'Europe;
« Arrêtent, en outre, que copie de ces sentiments sera envoyée à S. Exc. le Ministre des cultes (89). »
Jamais, ô peuple d'Israël, tu ne fus mieux inspiré depuis ton long exil: tous tes Talmuds ne valent pas cette effusion de ta reconnaissance et ce monument de ta sincérité.
VII
L'Empereur ne vit qu'une seule fois les juifs durant la tenue de leurs séances à Paris. Une députation composée de neuf membres (la Commission des Neuf) fut reçue en audience privée, et fit bonne impression sur le souverain. L'historien israélite Grätz, qui rapporte cette audience, exagère un peu, croyons-nous, l'impression pour et contre: « L'Empereur, qui s'était imaginé recevoir des marchands de bric-à-brac, des usuriers, des êtres rampants, pliés en deux, rusés, avides de gain, vit avec étonnement, dans ces membres de la Commission, des hommes d'un caractère solide et digne, ayant de l'intelligence, un maintien imposant, et dont quelques-uns auraient pu figurer avec avantage dans son Conseil d'Etat (90). »
Satisfait de son entrevue avec les personnes, l'Empereur ne le fut pas moins des résultats des séances. Comment ne l’eut-il pas été ? Il avait été loué, encensé, comparé au Messie; la loi de Moïse avait été rangée au-dessous du code Napoléon; sauf l'article des mariages, toutes ses volontés transmises par M. de Champagny et par les commissaires, avaient été accomplies de point en point; des conscrits israélites allaient augmenter l'effectif de ses bataillons; bref, l'antique obstination hébraïque était tombée à l'éclair de son sabre. La terre se tut devant Alexandre (91), avait-il lu dans la Bible des hébreux; lui qui aimait à se comparer à Alexandre fut satisfait de leur silence et de leur soumission. Entre les fumées de deux batailles, il trouva le temps de témoigner sa satisfaction. Le 9 mars 1807, le grand Sanhédrin avait tenu sa huitième et dernière séance; Napoléon, revenu de la sanglante bataille d'Eylau, était à Ostende; il écrivit en ces termes à M. de Champagny:
Ostende. 30 mars 1807.
Monsieur Champagny, j’ai reçu votre lettre du 18 mars avec le mémoire de mes commissaires près le grand Sanhédrin. Ils ont rempli le but que je me proposais, malgré les obstacles qu'ils ont eu à vaincre; témoignez-leur ma satisfaction.
NAPOLÉON (92).
L'Empereur était satisfait. Mais le peuple français avait-il lieu de l'être ?
Et le peuple juif lui-même partagea-t-il cette satisfaction ? Nous allons l'examiner.
CHAPITRE IV COMME QUOI L’ENTREPRISE IMPÉRIALE SERA VAINE CE QUE PRODUIRA LA FUSION DES FRANÇAIS ET DES ISRAÉLITES
I. Les obstacles à la réussite du coté des israélites. Attitude froide et hostile des synagogues étrangères: elles repoussent l'œuvre accomplie au Sanhédrin. D'autre part, les sanhédrites, malgré leurs intentions loyales, restent pénétrés de l'esprit judaïque, qui est un esprit de séparation et de domination. Leur habileté à faire reconnaître, par les commissaires impériaux, l’autorité du Talmud: maladresse énorme du gouvernement de l'Empereur. — II. Obstacles provenant du but: il dépasse le pouvoir de Napoléon. La réconciliation des juifs avec les autres peuples est réservée à un homme plus extraordinaire que lui, lequel ? — III. Obstacles provenant du grand Empereur. Le déisme transpire dans son entreprise. Il se substitue au Christ, unique pierre angulaire de toute réconciliation. — IV. Obstacles provenant de la convocation même du Sanhédrin: c'est le Sanhédrin qui avait prononcé la peine de mort contre Jésus-Christ. — V. Coup d’œil général sur l'incorporation des israélites à la France commencée par la Constituante et consommée par Napoléon. Froide analyse des avantages et des désavantages. — VI. La tunique de Nessus.
I
L’œil est attristé par le spectacle des ruines; il l'est peut-être davantage par la rencontre d'une construction inachevée et sans but: la faiblesse et l'impuissance humaines se trahissent plus amplement dans l'ouvrage commencé, demeuré debout, et inutile.
C'est ce sentiment pénible que l'on éprouve devant les résultats du grand Sanhédrin convoqué par Napoléon: entreprise hardie, sans précédent dans les siècles chrétiens, dont le but était l'amélioration des israélites et leur fusion avec les autres peuples, et demeurée à peu près stérile. Ce but avait été reconnu, consenti, acclamé en plein Sanhédrin. « Docteurs de la Loi et Notables, vous venez de terminer l'importante mission qui vous a été confiée par un Prince dont les bienfaits changent la destinée des restes d'Israël. Dans les fréquentes conférences que vous avez eues, vous n'avez pas eu une pensée, vous n'avez pas éprouvé un sentiment qui n'ait eu pour unique but l'amélioration civile et morale des enfants d'Israël, et l'ardent désir de seconder les desseins magnanimes de Sa Majesté en leur faveur (93). » Un siècle après, la réponse de l'histoire sera: stérilité.
Si un bras et un génie eussent été capables de faire réussir l'entreprise, n'étaient-ce pas, cependant, le génie et le bras de Napoléon ? L'Empereur n'avait rien négligé pour la réussite: à la représentation nationale des hébreux, exprimée par l'Assemblée des Notables, s'était ajoutée la consécration religieuse, exprimée par le Sanhédrin. Mais il y a des œuvres qui dépassent l'effort humain, et celle-là était du nombre.
Essayons de démontrer les côtés vulnérables, dès le début, de l'audacieuse entreprise.
Dès le début en effet, les israélites eux-mêmes — non ceux, assurément, qui étaient à portée du bras de Napoléon, mais tous les autres — n'ont point accordé la moindre confiance à ce qui s'était pompeusement élaboré et décidé à Paris. Dans une lettre indignée, adressée au Sanhédrin, un juif anglais se hâta de blâmer la conduite de cette assemblée: « Quels suffrages avez-vous obtenus des communautés juives étrangères à la France ? Nos frères de Constantinople, d'Alep, de Cochin, de Bagdad, et de toutes les contrées qui ne sont point soumises à la domination française, vous ont-ils envoyé des députés ? Ont-ils approuvé vos décisions ? En Angleterre, ils repoussent également votre doctrine religieuse et politique (94)... » Et plus tard, en 1844, un rabbin célèbre résumera d'une façon ironique l'opinion juive universelle: « Outre que les décisions du Sanhédrin sont peu connues du commun des juifs, ils ne les ont jamais prises au sérieux, sachant bien qu'elles avaient été dictées sous la pression de la crainte qu'inspirait la colérique volonté de fer du sabre de Marengo... Les exemplaires de ces décisions doctrinales sont devenus extrêmement rares. Les juifs ne se soucient pas de la publicité de cette mauvaise plaisanterie (95). »
« Mauvaise plaisanterie », voilà donc comment l'entreprise de Napoléon a été jugée dans la Synagogue.
Le sans-façon militaire avec lequel l'Empereur avait traité la Loi de Moïse, la rangeant au-dessous du code Napoléon; les réponses à son fameux questionnaire, dictées, mot pour mot, aux membres du concile juif comme à des enfants: tout cela, connu à l'étranger, avait fort mécontenté les vieilles barbes grises de Bagdad, de Cochin, d'Alep, de Constantinople. La lettre du juif anglais en est la preuve !
Un chanoine fort érudit, que nous rencontrions un jour, nous demandait spirituellement: « Au Sanhédrin de Paris, les rabbins n'ont-ils pas eu leurs articles organiques, comme nous, clergé catholique, nous avons eu les nôtres au Concordat ? » Le rapprochement est juste. Il n'est donc pas étonnant que le rabbinat, après la disparition du terrible précepteur, ait traité de mauvaise plaisanterie son œuvre du Sanhédrin.
Mais les membres du Sanhédrin eux-mêmes, tout en se persuadant qu'ils correspondaient loyalement aux desseins de l'Empereur, ont-ils eu, par devers eux, la conviction qu'Israël allait se fusionner et se réconcilier avec les autres peuples ?
Nous ne le croyons pas, nous pensons même le contraire.
En effet, à côté de leur intention sincère d'aimer et de servir leur nouvelle patrie et de se conduire en frères avec les Français, demeurait parallèlement, dans leur cœur, la persuasion héréditaire qu'Israël est une race à part, un peuple choisi, destiné à dominer tôt ou tard sur le monde. Cet esprit de séparatisme et de domination constitue le fond même du judaïsme dévoyé. Le Christ avait voulu joindre le judaïsme au fleuve magnifique qui, sorti de l'Evangile, a changé la face du monde; mais lui s'est circonscrit, avec dépit, en un lac fermé, aux exhalaisons malsaines. Or, nonobstant les déclarations loyales du Sanhédrin de 1807, cet esprit de séparatisme et de domination remettra fatalement tout en question entre gens de la Synagogue et les autres peuples. Les sanhédrites ont beau promettre avec transport qu'ils se montreront eux et leurs descendants, les bons frères des Français, cette promesse, sincère sur leurs lèvres et dans leur cœur, est contredite et comme annulée par leur faux judaïsme, devenu pestilentiel. Il y a, hâtons-nous d'en faire la remarque, un vrai judaïsme qui, avec les apôtres, tous d'origine juive, s'est fondu dans le christianisme; mais, pour le malheur d'Israël et de l'humanité, subsiste aussi un faux judaïsme qui n'a cessé d'être incommode, parce qu'il perpétue le détestable levain des pharisiens; et, par lui, les israélites les meilleurs demeurent prédisposés à la haine du nom chrétien, et, conséquemment, des patries chrétiennes. Hélas ! ce faux judaïsme les rend faux malgré eux, alors qu'ils possèdent de belles qualités morales. Que c'est malheureux ! Que c'est triste d'apercevoir des intentions loyales au-dessus d'une pente judaïque qui finit par entraîner en bas la loyauté ! Et qu'un tel dualisme est redoutable pour la société ! Les grands banquiers israélites seront en train d'absorber toutes les fortunes privées dans leur colossal agiotage, leur influence dans la presse sera en train de devenir l'écueil de toutes les institutions chrétiennes et patriotiques, qu'ils croiront encore accomplir les promesses de fraternité jurées entre les mains de Napoléon, parce qu'ils payent l'impôt et qu'ils s'acquittent du service militaire. On convient généralement qu'il ne se rencontre pas d'obstacle plus désespérant qu'un jugement faux, compliqué d'entêtement. Eh bien, le judaïsme dévoyé n'est rien moins qu'un jugement faux sur le Christ et la société chrétienne, avec le granit d'un endurcissement de dix-neuf siècles. C'est cependant ce jugement faux, fortifié d'endurcissement, que Napoléon, achevant l'entreprise sans prudence des législateurs de 89, introduisait plus avant, en 1807, dans la société française. L'amélioration des israélites n'étant qu'à la surface, la fusion et la réconciliation avec les autres peuples ne pourront exister aussi qu'à la surface.
L'Empereur lui-même, à ce que raconte l'histoire, n'aurait pas tardé à s'apercevoir de la stérilité de son œuvre. Quelques mois après, se trouvant en Pologne et voyant l'empressement des juifs à se rendre utiles à l'armée française, et à servir, moyennant salaire, de fournisseurs ou d'informateurs, il disait en riant: Voilà pourtant à quoi me sert le grand Sanhédrin (96) ! Réflexion enjouée qui trahissait l'impuissance d'autres résultats.
Quelque chose de plus grave s'est passé au Sanhédrin. La remarque n'en a jamais été faite.
Pour forcer les juifs à renoncer à leurs habitudes apportées de Palestine, Napoléon avait cru habile de scinder la loi de Moïse (voir plus haut page 69). Son œil perçant avait discerné dans la Bible une partie immuable, la doctrine, le culte, et une partie susceptible d'être discutée, les usages palestiniens et politiques. « Qu'on retienne l'un », avait-il signifié, « qu'on abandonne l'autre ! » C'est cette distinction qui avait tant irrité les synagogues étrangères, car, dans la loi juive, la connexion est intime entre ce qui est politique et ce qui est religieux.
Une trouée avait donc été pratiquée dans la Bible.
Ce n'est pas là qu'il eût fallu la faire; Napoléon s'est trompé.
C'est le Talmud qu'il fallait viser, trouer, raser, interdire détruire: le Talmud, livre de plomb sur l'intelligence et le cœur d'Israël, lourde masse aux fentes de vipères contre les nations, arsenal du diable !
Il fallait mitrailler le Talmud, et ne pas toucher à la Bible !
Or, par un mouvement tournant très faible, les juifs du Sanhédrin enveloppant Molé, commissaire impérial, de flatteries et d'adulations, lui avaient persuadé de s'appuyer sur le Talmud même, comme sur une autorité irrésistible, pour en imposer davantage aux israélites du monde entier, et se concilier plus sûrement leurs sympathies. Et Molé s'était laissé prendre. Avec sa fougue juvénile, il avait débuté ainsi au milieu de ces vieux retors:
« Sa Majesté, en échange de l'auguste protection qu'Elle vous accorde, exige une garantie religieuse de l'entière observation des principes énoncés dans vos réponses. Il faut que ces réponses... puissent être placées à côté du TALMUD, et acquièrent ainsi, aux yeux de tous les juifs de tous les pays et de tous les siècles, la plus grande autorité possible (97). »
A côté du Talmud ! jamais bévue et maladresse d'un gouvernement ne s'étalèrent plus énormes, et jamais les juifs ne pratiquèrent plus habile finauderie. Napoléon veut les faire renoncer à leurs vieilles habitudes antisociales, et eux font officiellement reconnaître et consacrer par son gouvernement le Talmud, aliment de leurs haines et de leurs roueries ! Aussi, il faut voir comme leurs réponses au questionnaire impérial se déroulent flanquées de deux redoutes, la Loi de Moïse et le Talmud.
Exemples:
TROISIÈME QUESTION
Une juive peut-elle se marier avec un chrétien, et une chrétienne avec un juif ?
La prohibition ne s'applique qu'aux peuples idolâtres; et le TALMUD déclare formellement que les nations modernes ne le sont pas, puisque, comme nous, elles adorent le Dieu du ciel et de la terre.
QUATRIÈME QUESTION
Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères, ou sont-ils des étrangers ?
RÉPONSE
Aux yeux des juifs, les Français sont leurs frères, et ne sont point étrangers. L'esprit des lois de Moïse est conforme à cette manière de considérer les Français... Et cette doctrine est professée PAR LE TALMUD.
CINQUIÈME QUESTION
Quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ?
RÉPONSE
Le TALMUD et l’usage nous prescrivent avec les Français qui ne sont pas de notre religion, les mêmes rapports que ceux qui existent entre un juif et un autre juif (98).
Et ainsi, avec l'agrément et, même, la connivence du gouvernement, le Talmud est solennellement reconnu comme Code religieux. Nous le répétons, nous insistons, il n'était pas possible de commettre une plus lourde faute, moralement et historiquement. Moralement: on annonce devant tout Paris devant toute l'Europe, qu'on va réformer les juifs, et on leur permet de faire partir cette réformation du Talmud, qui les a toujours pervertis: inquiétant cercle vicieux, qui sautait aux yeux et que, sans doute, le nouveau dogme de liberté de conscience empêcha d'apercevoir ou de briser. Si l'Empereur avait eu la prudence d'associer à ses commissaires, publiquement ou secrètement, quelques théologiens catholiques, ceux-ci n'eussent pas manqué de jeter le cri d'alarme contre cette entrée tout à la fois subreptice et officielle du Talmud. C'est là un cas, entre cent autres, où l'absence du clergé aura été à jamais regrettable. Si l'autorité ecclésiastique avait eu son rang, comme aux temps de Charlemagne et de saint Louis, dans une question aussi grave, les israélites du Sanhédrin n'eussent pas osé apporter des conclusions basées sur le Talmud. Elles eussent été arrêtées du premier coup. « La loi de Moïse, comme base de votre réformation », très bien ! « Le Talmud », jamais ! Napoléon, pour avoir voulu juger en maître compétent une question si ardue, laissa passer l'ennemi dans la place. Voilà comment, au point de vue moral, ce fut une lourde faute.
Historiquement, la faute n'était pas moins énorme. L'histoire ne disait-elle pas que les souverains Pontifes et les Rois très chrétiens n'avaient cessé de prendre des mesures énergiques contre ce livre assimilé à un ennemi dangereux et dissimulé. Dans ce Paris qui assistait au grand Sanhédrin sans y rien comprendre, vingt charretées de talmuds et de livres juifs avaient, un jour, traversé les rues pour être brûlés en place de Grève. C'était en l'année 1239. Et en 1807, ce maudit livre est déployé par le Sanhédrin comme un phénix qui renaîtrait de ses cendres; et Paris, qui ne sait plus sa propre histoire, laisse faire ! Les papes Grégoire IX, Innocent IV, Jules III, Paul IV ont écrit de leur propre main aux souverains de France, d'Angleterre, d'Aragon, de Castille, de Léon, de Portugal, d'Autriche, pour leur recommander de refouler dans les ténèbres ce livre que les ténèbres ont formé; rois et empereurs le traquèrent; et toi, César de la Révolution, en désaccord avec la prudence des siècles, tu approuves qu'il soit mis sur le chandelier !
Le comble sera que l'Imprimerie nationale soit chargée de la réimpression du Talmud, et en partie aux frais de l'Etat. Ce comble se verra en l'année 1876 (99).
II
Par le vieux levain pharisaïque qui demeure en eux, et aussi par le livre détestable qui continue de les régir, les israélites, malgré leurs efforts louables, sont donc rebelles au but que s'est proposé Napoléon. Mais ce but lui-même ne dépassait-il pas le pouvoir du puissant Empereur ?
Faire entrer les juifs, de gré ou de force, dans le concert de l'unité nationale, et, par là, dans la famille des peuples avec lesquels ils ne vivraient plus en ennemis, mais se réconcilieraient: tel était l'objectif de Napoléon.
La première partie de ce programme, l'entrée dans le concert de l'unité nationale, était réalisable jusqu'à un certain point, malgré ses dangers pour la nation hospitalière. Il suffisait, pour cela, que les nouveaux citoyens payassent l'impôt commun, fussent appelés au service militaire, eussent l'accès libre de toutes les carrières et des fonctions de l'Etat. Quant à la seconde partie du programme, la réconciliation avec les peuples, c'était autre chose ! Cent ans se sont presque écoulés depuis l'ordre d'entrer signifié par l'Empereur, et les revenants de Palestine, qui sont entrés dans la grande famille des peuples, circulent comme des fantômes ou s'imposent comme des maîtres, mais ne se sont guère fusionnés, et nullement réconciliés. A part quelques amitiés de passage ou de position, la défiance plane au-dessus des relations civiles et commerciales. Entre les citoyens autochtones et les citoyens d'acquisition, demeure un abîme que rien n'a pu combler.
L'échec était à prévoir.
Un abbé Emery qui eût été appelé au Conseil de l'Empereur, ou quelque autre théologien versé dans les Ecritures, eut ainsi parlé au Souverain: « Sire, Votre Majesté ne réussira pas.
« — Et pourquoi ? eût brusquement demandé César.
« — Sire, Votre Majesté est extraordinaire: ses œuvres éblouissent et terrassent. Mais cette œuvre de réconciliation est réservée à un homme plus extraordinaire encore que Napoléon; il a nom: le prophète Elie.
« C'est de lui qu'il est écrit au livre des oracles infaillibles:
« Elie rétablira toutes choses (100)... Il réunira les cœurs des pères avec leurs enfants, et les cœurs des enfants avec leurs pères (101).
« Sire, votre glaive est un éclair, et vos cavaliers font voler le feu. Mais ce prophète, lui aussi, a été enlevé par des chevaux de feu, et il doit revenir pour faire cesser l'endurcissement de ce peuple juif auquel Votre Majesté s'intéresse et pour le réconcilier avec les autres peuples.
« Sire, Votre Majesté peut préparer les voies à ce grand œuvre, mais en s'y prenant d'une autre manière. »
En effet, la fusion que rêvait Napoléon entre les israélites et les peuples de son empire, sur quoi l'appuyait-il principalement ? Il l'appuyait, après les rapports que créerait entre eux l'égalité devant la loi, sur la chair et le sang, au moyen des mariages mixtes. Le potentat regardait le mariage comme le principal et plus efficace moyen de fusion. Ne s'était-il pas attaché à mêler les hommes nouveaux aux races anciennes; sa cour offrait la plus étrange bigarrure d'hyménées. Il avait contracté, pour les siens, des alliances de famille avec les princes germaniques; une fille du roi de Bavière venait d'épouser le vice-roi d'Italie, Eugène, son fils adoptif; et lui-même songeait à vieillir ses origines dans un hymen avec une archiduchesse. Il se persuada qu'il mêlerait pareillement, au moyen des mariages, les juifs avec les chrétiens. Erreur ! Le Sanhédrin résista: le peuple juif ne se mêle pas (102) ! Lorsqu'aura sonné, à l'horloge des siècles, l'heure tardive de la réconciliation, la fusion s'accomplira, non au moyen de la chair et du sang, comme le voulait Napoléon, mais dans la vision de la vérité et dans la vertu de la parole du saint prophète.
Voilà pourquoi, ô César, tu n'atteindras pas ton but. Le prophète plus extraordinaire que toi est désigné, dans la Tradition catholique, sous un nom réjouissant, en rapport avec ce but: l'agrafe d'or d'Israël et des Nations. Vers le soir des siècles, dans un crépuscule magnifique, il réconciliera les cœurs, unissant, comme un nœud d'amour, Israël et les Nations sur le sein de l'Eglise !
Agrafe ton manteau de batailles, ô César, enfonce tes éperons dans les flancs de ton coursier, et pars: la réconciliation des juifs avec le genre humain n'est pas ton affaire.
Une objection, cependant.
Cette réconciliation dont Dieu s'est réservé le succès, Napoléon ne pouvait-il la préparer dans la vie civile, tout comme Charlemagne a préparé l'entrée dans la civilisation aux peuples du Nord ?
Assurément, Napoléon en eût été le pionnier, s'il avait apporté dans son entreprise les vues de foi de Charlemagne. Mais aux obstacles déjà constatés, qui provenaient soit des israélites soit du but lui-même, le grand Empereur en a encore ajouté d'autres, suscités par son impériale personne.
Continuant les errements de la Constituante qui avait répudié le Christ des fondements de la société moderne, Napoléon se substituait, d'une façon inconsciente sans doute, à Celui qui seul, ici-bas, exerce le rôle de pierre angulaire. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter les étonnantes paroles de flatterie que voici, prononcées en plein Sanhédrin: Cette conception philanthropique est digne de ce grand homme, qui ne PEUT EXCLUSIVEMENT APPARTENIR A AUCUNE CLASSE, A AUCUNE RELIGION, A AUCUN PEUPLE; de ce génie sublime qui est pour le genre humain un présent de la Providence, et dont l'influence bienfaisante doit être sentie par tous les hommes (103). Au Christ de Dieu, uniquement, a été données par le Ciel, la mission d'exercer l'universelle influence que rappelait la flatterie du Sanhédrin, et d'être la bienfaisante pierre de l'angle qui joindrait les extrêmes les plus éloignés, les plus opposés. Dans des proclamations superbes à ses armées, l'Empereur montrait sans doute des extrêmes à atteindre: Soldats, après avoir triomphé sur le Danube et sur la Vistule, vous avez traversé à marches forcées l'Allemagne et ensuite la France sans prendre un instant de repos. Soldats j'ai besoin de vous. Portons nos aigles triomphantes jusqu'aux colonnes d'Hercule... Le conquérant qui s’élançait d'une extrémité de l'Europe à l'autre, du Niémen aux colonnes d'Hercule, se flattait d'aller de même, en religion, du catholicisme au judaïsme, du Concordat au Sanhédrin, et d'y concilier les extrêmes. Mais cette conciliation religieuse, le Christ se l'est réservée. Il a cédé aux hommes toutes les autres gloires, sauf celle-là, retenue pour lui et pour son Eglise; une formule célèbre en est le cercle d'or: Un seul troupeau et un seul pasteur. Napoléon, pour réussir dans son œuvre de conciliation judéo-chrétienne, avait fait appel à tous les concours: l'Assemblée des Notables, le Sanhédrin, le Code civil, le Conseil d'Etat; à tous les concours, hormis celui sans lequel les autres ne servent de rien et qui dispense de tous les autres: l'unique bercail sous l'unique pasteur. Mais aussi, l'empire napoléonien ne préparait guère la divine bergerie, et le Corse au profil romain n'avait pas précisément la physionomie d'un roi-pasteur !
Doit-on inférer de là que Napoléon a voulu exclure la Divinité de son entreprise hébraïque ? Non, assurément, puisqu'il y convoquait la Loi de Moïse. Seulement, l'Empereur était déiste, nous l'avons déjà dit (page 29), et il s'illusionnait au point de croire qu'avec le déisme, forme vague de religiosité, il rapprocherait dans la vie civile, sinon les religions, du moins les hommes des différentes religions. Il s'en est ouvert lui-même avec de Las Cases, un soir à Sainte-Hélène: « Tout proclame l'existence d'un Dieu. C'est indubitable ! mais toutes nos religions sont évidemment les enfants des hommes... Nul doute que mon esprit d'incrédulité ne fut, en ma qualité d'empereur, un bienfait pour les peuples; et autrement, comment aurais-je pu favoriser également des sectes aussi contraires, si j'avais été dominé par une seule (104) ? » Aussi bien, au début de son étonnante fortune, alors qu'il mettait le pied sur la terre d'Egypte, il faisait du déisme et sa règle de conduite et celle de son armée: « Soldats les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans leur premier article de foi est celui-
ci: Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez pas; agissez avec eux comme nous avons agi avec les juifs, avec les Italiens. Ayez des égards pour leurs muphtis et leurs imans, comme vous en avez eu pour les rabbins et pour les évêques. Ayez pour les cérémonies que prescrit le Koran, pour les mosquées, la même tolérance que vous avez eue pour les couvents, pour les synagogues, pour la religion de Moïse et celle de Jésus-Christ. Les légions romaines protégeaient toutes les religions (105). » Le Sanhédrin de Paris fut donc, non moins que d'autres entreprises religieuses, l'expression du déisme impérial, dans le but de rapprocher les israélites des chrétiens. Or, Sa Majesté se trompait, le déisme n'a jamais rien rapproché. Outre que le Dieu de cette forme vague de religion est un Dieu glacé qui ne sait pas les chemins du cœur, être abstrait et solitaire, qui habite l'inaccessible région de l'infini et devant lequel l'homme passe sans avoir l'idée d'une prière ni la puissance d'une larme; outre ce vide, cette glace, le déisme, religiosité vague et paresseuse, sans révélation ni culte, était ici absolument impropre à rapprocher des croyants comme l’étaient les chrétiens et les israélites, dont les uns possèdent la Révélation totale, et les autres, une partie notable de la Révélation. Le chrétien est un croyant complet; l’israélite, un croyant incomplet, un homme en retard. Qui les veut rapprocher ne doit pas leur apporter l'absence de la Révélation, mais bien l'entente sur la Révélation. Le déiste couronné des Tuileries ne pouvait donc, nonobstant ses vues de philanthropie et l'envergure des ailes de ses aigles. devenir l’arbitre d'une pacification.
IV
Loin de là ! Le déisme l'a mal conseillé dans la convocation du Sanhédrin.
Il semble au premier abord qu'il y avait de la grandeur ou, tout au moins, de l'originalité dans la réapparition d'une assemblée qui ne s'était plus tenue depuis que Titus avait ruiné la Jérusalem de David et de Salomon. Que les historiens israélites aient applaudi, par la suite, à cette réapparition, il n'y a là rien qui surprenne. Mais le décret lui-même de convocation, émanant du souverain, laissait percer une orgueilleuse satisfaction de frapper ce grand coup.
M. Molé, commissaire du gouvernement, s'exprima dans ces termes, que nous avons déjà rapportés:
C'est le grand Sanhédrin que Sa Majesté se propose de convoquer. Ce corps, tombé avec le Temple, va reparaître pour éclairer par tout le monde le peuple qu'il gouvernait (107).
Ne vous en déplaise, monsieur le Commissaire du Gouvernement, l'Empereur a porté un défi et fait un affront à la France et à l'Europe chrétiennes, lorsqu'il ressuscitait ainsi en plein Paris une assemblée dont les précédents étaient horribles.
Quels précédents ?
C'est avec ce Conseil suprême de la nation juive que le Sauveur eut à lutter durant son ministère en Judée et à Jérusalem; c'est parmi ses membres qu'il rencontra d'implacables adversaires, les pharisiens hypocrites et dissolus, qui le poursuivirent sans relâche et réussirent enfin à le livrer au supplice;
C'est le Sanhédrin qui accepta l'infâme marché de Judas et qui lui compta les trente pièces d'argent pour que le Juste lui fût livré;
C'est devant le Sanhédrin que se déroula cet affreux et douloureux procès, où nous avons trouvé et compté VINGT-SEPT IRRÉGULARITÉS (108).
C'est dans l'intérieur du Sanhédrin que commença la Passion; que sortit, de son sein pourri, cette exclamation haineuse: Qu'avons-nous besoin de témoins ? il est digne de mort; et qu'aussitôt se passa cette scène d'outrages sans nom où le Fils de Dieu fut souffleté, couvert de crachats et d'insultes. Ces magistrats, donnant le signal des indignités, crachèrent les premiers au visage de Jésus, puis lui bandèrent les yeux, et lui donnèrent des coups de poing, disant après chaque coup: Christ, prophétise ! qui t'a frappé (109) ? Quand leur fureur se fut lassée, les sanhédrites livrèrent Jésus à leurs valets. La valetaille se chargea des outrages du reste de la nuit, et le Sanhédrin se retira;
C'est le Sanhédrin, enfin, qui reparut sur le Golgotha, pour se moquer et rire de l’HOMME DE DOULEURS, et exciter dans la foule le débordement d'injures (110).
Cette exécrable et maudite Assemblée ne s'était jamais relevée du coup de justice que lui avait donné Titus, et c'est l'Empereur des Français qui la ressuscitait à Paris (111) !
On a dit de Napoléon à propos de son sacre à Notre-Dame: « Un jour, les portes de cette basilique s'ouvrirent, un soldat parut sur le seuil, entouré de généraux et suivi de vingt victoires. Où va-t-il ? Il entre, il traverse lentement cette nef, il monte devant le sanctuaire; le voilà devant l'autel. Qu'y vient-il faire, lui, l'enfant d'une génération qui a ri du Christ ? Il vient se prosterner devant le Vicaire du Christ, et lui demander de bénir ses mains afin que le sceptre n'y soit pas trop pesant à côté de l'épée; il vient courber sa tête militaire devant le vieillard du Vatican, et confesser à tous que la gloire ne suffit pas, sans la religion, pour sacrer un empereur (112) »
Oui, elle fut glorieuse, la journée à Notre-Dame; mais à quelques pas de la noble basilique, j'aperçois le Sanhédrin, et j'entends ces inconcevables paroles sortir, au nom de l'Empereur, de la bouche de son représentant:
Ce corps, tombé avec le Temple, vient reparaître pour éclairer par tout le monde le peuple qu'il gouvernait !
Vous ne saviez donc pas ce que le Sanhédrin avait commis contre Jésus-Christ ! Et il ne s'est donc rencontré personne, ni dans votre entourage ni dans votre clergé, pour avertir Votre Majesté que les paroles de son commissaire avaient une odeur de Julien l'Apostat ! Julien a tenté de relever le Temple: Votre Majesté relève le Sanhédrin tombé avec le Temple. L'ignorance excuse Votre Majesté: mais, voilà posée, à la suite des Droits de l'homme, la deuxième assise de la prépondérance juive autrement colossale et redoutable qu'un temple de pierre !
Julien l'Apostat, évoqué et fêté dans les conciliabules maçonniques, a du ricaner dans l'ombre.
V
En définitive, qu'allait-il sortir de cette étrange assemblée ? L'énumération approfondie que nous avons faite des différents obstacles nous permet de porter un jugement.
Ce jugement a son importance, car c'est au Sanhédrin de 1807 que les israélites de France rattachent leur entrée réelle dans la société. Un de leurs plus savants jurisconsultes, M. Bédarride, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Montpellier sous le règne de Napoléon III, en parle ainsi:
C’est là l'œuvre immense accomplie par l'empereur Napoléon. C’est à proprement parler de la convocation du Sanhédrin que date la régénération complète des juifs, leur habilitation à l'exercice des droits de citoyen
La Révolution de 1789 avait donné légalement aux juifs les droits de citoyen, les réponses du Sanhédrin ont prouvé qu'ils étaient dignes de ce titre.
Le nom de Napoléon doit être inscrit en tête de l'ère nouvelle qui s’est ouverte pour les juifs (113).
C'est donc le Sanhédrin faisant suite à l'Assemblée constituante de 1791 qui introduisait, en 1807, les hébreux dans la société française.
Le but poursuivi par l'Empereur dans sa convocation était la fusion: fusionner les israélites avec les Français puis avec les autres peuples.
Quatre sortes de fusion étaient possibles:
Celle des cœurs;
Celle des esprits
Celle des intérêts matériels;
Celle des vices.
De ces quatre mélanges, combien allaient réussir, et valoir quelque chose ? Et pour qui les avantages, pour qui les désavantages ? Il faut répondre avec impartialité.
La fusion des cœurs s'obtiendra-t-elle ? Non, évidemment, puisque l'examen de la vérité en religion ou de la vraie religion ne faisait point partie du programme du Sanhédrin. Le mur de séparation subsistera, comme par le passé, entre chrétiens français et israélites français. Mêmes défiances réciproques, mêmes antipathies de races, se retrouveront après cent ans de vie commune sous le Code Napoléon, parce qu'il n'y a que l'entente en religion qui amène la fusion des cœurs.
La fusion des esprits, du moins, réussira-t-elle ? Assez heureusement, mais toute à l'avantage des israélites. En effet, dans le mélange des idées, l'esprit français n'acquerra absolument rien auprès de l'esprit israélite, vu que, depuis leur dispersion pénale, les juifs n'ont rien produit qui vaille pour le développement intellectuel, moral et artistique de l'humanité. Le coup de foudre qui n'a pas laissé pierre sur pierre de la construction du Temple, a lézardé en même temps l'intelligence du peuple de la Bible. Cette intelligence ressemble à celle d'un homme qui aurait eu une attaque. Les idées ne se suivent plus, ou sont mesquines et puériles. Les dix volumes in-folio du Talmud de Jérusalem ne renferment pas une seule idée neuve, importante, et par contre une foule de niaiseries. Des médecins, habiles praticiens, c'est tout ce qu'on accepte d'eux, et encore avec précaution, dans le grand courant des lettres, des sciences et des arts au Moyen Age (114). Par conséquent, sous le rapport de la fusion des esprits, les Français n'auront, hélas ! nul regain intellectuel à espérer dans toute l'étendue du champ hébraïque qui s'ouvre à eux en 1807.
Au contraire, les israélites auront le profit du mélange. Devenus citoyens français, ils pourront fréquenter les écoles, s'asseoir dans les académies, s'assimiler le trésor des connaissances acquises par les peuples chrétiens. Leur intelligence, ravivée et stimulée par le don de la liberté, retrouvera des énergies qu'elle ne connaissait plus depuis la punition du déicide. Les idées chrétiennes qui forment, nonobstant les débauches révolutionnaires, l'air ambiant des nations, pénétreront à leur insu les fils d'Israël, et plus d'un, visité par un rayon discret de la grâce de Dieu, s'acheminera, d'une école de l'Etat, vers le sanctuaire de l'Eglise. Les choses se sont ainsi passées pour l'heureux écrivain de ce livre et pour son frère: en étudiant le Discours sur l'histoire universelle de Bossuet dans un lycée, ils ont été amenés à étudier l'Evangile dans un séminaire.
La fusion des intérêts sera-t-elle, tout au moins, plus avantageuse aux Français que la précédente ?
On serait porté à espérer que, là, une compensation pourrait s'obtenir. En effet, le génie des affaires, que les israélites se flattent de posséder, ne deviendra-t-il pas un précieux élan pour les Français et une source de prospérité pour la France ?
Chimère qu'une telle espérance ! la fortune française n'aura rien à gagner dans sa fusion avec la fortune hébraïque.
D'abord, au point de vue de la conception des entreprises commerciales ou industrielles, une déception se prépare.
Dans toutes ses entreprises, la France avait coutume d'apporter de la grandeur, un luxe, presque, de sentiments magnanimes. Elle faisait grand en affaires comme en politique, sur les marchés comme sur les champs de bataille. Désormais, tout se rapetissera, avec l'esprit judaïque admis au Conseil de la nation. Le génie des affaires qu'on attribue à Israël n'est que celui des petites affaires, des petits artifices; ce génie est au véritable génie ce que la ruse est à l'habileté franche, ce que les renards du Cantique étaient au lion de Juda: celui-ci, majestueux, excitait à la grandeur, ceux-là démolissaient (115). Les Croisades qui, sous le rapport du commerce, ont formé une des plus utiles et des plus splendides entreprises de la France, seront remplacées, pour les Français, par les finauderies et les catastrophes de l'agiotage.
Si, de la conception des entreprises commerciales, nous passons à l'examen de leur honnêteté, quel péril attend la pauvre France ! Le Talmud est toujours là, non seulement toléré, mais entouré d'égards par le gouvernement de l'Empereur. Or le Talmud est l'échappatoire de l'honnêteté, comme l'Evangile en est le sceau. Si, au Moyen Age, les fortunes privées des chrétiens étaient anxieuses dans le voisinage dissimulé du Talmud, quelles craintes n'y a-t-il pas à concevoir, non seulement pour les fortunes privées, mais pour la fortune publique, au spectacle des juifs mêlés désormais à la gestion des affaires de l'Etat, et libres de consulter la morale de leur Talmud. Cette morale, la voici, dénoncée par un rabbin sincère, monté dans les rangs du catholicisme:
Les trois juifs les moins civilisés, les plus ignorants que l'on fait asseoir en juges, forment aussitôt un tribunal qui aux yeux de la synagogue a pleine autorité, nous gémissons d'avoir à le dire, de délier leurs coreligionnaires de leurs serments, d’annuler leurs promesses et leurs engagements les plus sacrés tant pour le passé que pour l'avenir !
Le juif qui sent sa conscience trop chargée de promesses et de serments fait asseoir trois de ses frères qui se constituent aussitôt en tribunal. Devant cette cour, il expose qu'il se repent de toutes les promesses et de tous les serments qu'il a jamais articulés, et qu'il les rétracte. « Ils sont si nombreux, dit-il en terminant sa protestation, que je ne saurais les spécifier. Qu'ils soient donc à vos yeux, je vous prie, ô Rabbis, comme si je les avais énumérés en détail. » Le tribunal, sans autre forme de procès, déclare les susdits serments et promesses nuls, de nul effet et non avenus.
Avant que le chantre entonne à la synagogue la première prière de la Fête des Expiations, trois hommes, réunis en tribunal et placés en tête de l'assistance, annulent de leur pleine autorité tous les vœux, les engagements et les serments de chacun de l'assemblée, tant ceux de l'année qui vient de s'écouler, que ceux de l'année où l'on est entré. On appelle cela Col nidrè.
Nous n'avons pas besoin de faire apprécier le funeste effet de ces deux cérémonies si opposées à tous les principes de la morale la plus simple (116).
Tout cela est inscrit dans le Talmud reconnu comme livre doctrinal des juifs par le gouvernement de Napoléon. De cette reconnaissance officielle, n'y a-t-il pas des craintes à concevoir et à conclure pour l'honnêteté des entreprises françaises dans l'avenir, puisque les juifs vont désormais y participer ?
Conception des entreprises; honnêteté des entreprises; et puis, résultats des entreprises:
Eh bien, au point de vue des résultats, que peut-on attendre de la fusion des intérêts entre Français et israélites ?
Hélas ! pas autre chose que l'englobement des intérêts français dans les intérêts israélites, ce qui équivaudra à leur suppression: l'histoire renouvelée des sept vaches maigres dévorant les sept vaches grasses (117) !
En effet, on aura beau dire qu'il y a des israélites honnêtes, des israélites magnanimes, des israélites charitables: nous ne le nions pas, et nous nous montrerions fils dénaturé en refusant de le reconnaître et de le proclamer. Il y en a beaucoup, c'est incontestable. Mais il est incontestable aussi que le peuple juif, dans son ensemble, comme peuple, est accapareur des biens de la terre, et que, demeurant irréductible dans la fusion des autres peuples, il pompera insensiblement leurs richesses: vaste éponge dont le gonflement sera favorisé par la protection des lois libérales.
Qu'on nous pardonne cette rigoureuse, mais nécessaire analyse de la fusion.
Reste celle des vices.
Nous voudrions pouvoir écrire: fusion des vertus aussi.
Mais les vertus ne germent qu'à la suite et à l'ombre des doctrines religieuses, et, les doctrines entre israélites et français demeurant opposées, il n'y aura que rencontre fortuite de vertus.
Hélas ! de toutes les fusions, celle des vices sera la plus réelle, acceptée et féconde des deux côtés.
Les Français communiqueront aux israélites l'esprit d'incrédulité et d'indifférence en matière de religion, né au XVIIIe siècle, et la dépravation des mœurs, devenue populaire depuis les désordres imités de Louis XIV et de Louis XV et les saturnales de la Révolution. L'antique foi israélite, qui en l'espace de dix-huit siècles n'avait eu à déplorer que les hardiesses de Spinoza, commencera à chanceler sous le souffle du rationalisme; et les familles patriarcales, dont les vertus s'étaient conservées au sein de la dispersion pénale, passeront par des dérangements qu'elles ne connaissaient pas. L'émancipation des israélites s'est effectuée dans un milieu détestable: celui du rationalisme et du voltairianisme. C'est une lourde responsabilité pour la France et les nations de l'Europe.
De leur côté, les israélites communiqueront aux Français leur soif effrénée de l'or, et, avec elle, la cohorte de toutes les défaillances et de toutes les jouissances honteuses. Excités à la convoitise et au lucre, les fils de la noble France qui ne savent rien faire à demi, envieront aux hébreux leur or, leurs expédients, leurs bassesses; ils les imiteront; et l'esprit français, se teignant du faux judaïsme, sera méconnaissable.
En cet état de choses, la prépondérance juive trouvera facilement à s’asseoir.
VI
Un des épisodes les plus dramatiques de la Fable est, incontestablement, celui d'Hercule se revêtant de la tunique de Nessus envoyée par Déjanire (118).
Sophocle le raconte ainsi, faisant parler Hyllos, fils d'Hercule et de Déjanire:
Moi-même j'ai vu les cruelles souffrances de mon père. Il s'était arrêté en Eubée, sur le cap Cénée battu des deux côtés par les flots. Il allait offrir un sacrifice à Jupiter, lorsqu'arriva le héraut Lichas, apportant ton présent, la tunique mortelle. Hercule la revêtit selon ton désir; il immole douze taureaux superbes, prémices de ses dépouilles. Et d'abord l'infortuné, le cœur joyeux, satisfait de sa nouvelle parure, adressait aux dieux ses prières; mais à peine la flamme du sacrifice s'élève-t-elle du bûcher pour consumer les victimes, que la sueur coule de son corps; la tunique s'attache à ses flancs et se colle sur sa chair; une douleur cuisante pénètre jusqu'à la mœlle de ses os, puis un venin mortel comme celui de l'hydre fatale dévore ses membres. Alors il appelle le malheureux Lichas, qui était innocent de ton crime, et lui demande par quelle trahison il lui a apporté cette tunique; l’infortuné, qui ne savait rien, répond que le présent venait de toi seule, qui l'avais chargé de l'apporter. En ce moment, une convulsion violente déchire les entrailles d'Hercule, il prend Lichas par le talon, et le lance contre un rocher battu par les flots; de sa tête entr'ouverte, la cervelle jaillit sur sa chevelure avec le sang. Tout le peuple jette un cri lamentable, à la vue de Lichas broyé et d'Hercule en délire, et personne n'osait l'approcher; il se roulait à terre, puis se relevait en poussant des cris aigus, qui faisaient retentir les rochers d'alentour, les montagnes escarpées des Locriens et les promontoires de l'Eubée. Enfin, épuisé, l’infortuné, tantôt retombant à terre, tantôt jetant des cris affreux, maudit le funeste hymen qui l'unit à toi, malheureuse, et puis, levant ses yeux hagards et troublés, il m'aperçoit dans la foule où je fondais en larmes, et m'appelle: « Viens, mon fils, ne me fuis pas dans mon malheur, dusses-tu expirer avec moi; enlève-moi de ces lieux, et surtout dépose-moi en un lieu où nul mortel ne puisse me voir... Tu connais le mont Œta, consacré à Jupiter; eh bien, c'est là que tes mains devront porter mon corps...
(119) »
Le prince de l'éloquence chrétienne, le père Lacordaire, a fait, de cette Fable, la plus heureuse application à l'ordre moral. Il eut, à Notre-Dame de Paris, ce beau mouvement à propos de la tyrannie des passions:
« Oh ! qui de vous, Messieurs, non seulement dans les ardeurs de la jeunesse, mais sous les glaces de l'âge, n'a ressenti douloureusement cet incroyable état de notre personnalité ? Qui de vous, s'il n'est abandonné tout à fait à l'abjection des sens, n'a pleuré des larmes mystérieuses sur lui-même et n'a levé vers le ciel des pensées incertaines et suppliantes ! Aucune force d'esprit, aucune élévation de fortune ne nous défend contre les atteintes de ce mal qu'on pourrait appeler le mal caduc de l'âme. Les anciens le savaient et ils nous l'ont dit dans une fable qui est demeurée célèbre entre toutes celles qui viennent de leur génie. Hercule, l'homme héroïque, avait vaincu les monstres et pacifié les empires; au comble de sa gloire, dans la maturité d'un âge qui ne lui annonçait plus que le repos d'une impérissable grandeur, il reçut des mains d'une femme une tunique précieuse qu'il se hâta de revêtir. L'infortuné ! à peine eut-il sur sa chair le tissu fragile, qu'il se sentit consumé d'un feu dévorant; il y porte les mains, il veut l'arracher de ses membres généreux: c'est vainement, le fil empoisonné est plus fort que cette main qui avait abattu les tyrans. Hercule, Hercule ! ne t'étonne pas; l'homme peut vaincre les monstres, il n'arrache pas de dessus sa chair la tunique de Déjanire (120). »
On a dit que, dans l'ordre social, cette Fable trouvait aussi son application: que l'incorporation de la race juive à la société moderne était une tunique empoisonnée. Qu'y a-t-il de vrai ? et surtout que faire ?
Sans avoir été, préalablement, régénérée par l'Eglise de Dieu, et sans avoir renoncé au Talmud et à ses perfidies, la race juive a été fusionnée dans la nation française; les membres de la Constituante, en 1791, puis Napoléon, au grand Sanhédrin de 1807, ont fait ce chef-d'œuvre; oui, voilà bien la tunique de Nessus, présentée au nom de la Révolution, nouvelle Déjanire !
La France s'est donc incorporé les juifs, avec insouciance, avec confiance...
Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Voici qu'un feu inconnu, étrange, a circulé dans ses veines; ce feu, les ardeurs de la soif de l'or, l'animosité contre la religion chrétienne, contre les ministres de Dieu, contre les vierges pures; ce feu, la haine du Christ ! Les gloires anciennes ont été mises en pièces; la fortune publique a disparu; la population est devenue anxieuse, famélique: c'est l'agonie du promontoire de l'Eubée...
Si l'on veut être juste, on doit reconnaître toutefois que le poison ne vient pas uniquement des juifs. Il s'en faut bien ! La Révolution, rusée et cruelle Déjanire, savait bien ce qu'elle faisait, lorsqu'aux passions plus coupables et plus haineuses des Rousseau, des Voltaire et des Loges maçonniques, elle ajoutait encore les passions et les haines talmudiques.
La pauvre France, quand elle s'est aperçue de la méprise, aurait voulu revenir sur la fatale incorporation. Mais comment se débarrasser des juifs ? L'inexorable logique dit: C’est impossible.
Impossible, puisque l'Assemblée constituante a voté l'égalité égalité devant la loi; égalité de tous les citoyens, sans distinction de cultes;
Impossible, puisque sous le régime du Code Napoléon les intérêts français se sont enveloppés des intérêts hébreux; ils se sont enlacés par des liens inextricables; sur la fortune et les destinées de la France s'est collée la tunique de Sem: on ne l'arracherait qu'en s'arrachant la chair ! N'y aura-t-il pas, tout à l'heure, cent ans que la compénétration s'est opérée ? Français et israélites ont vieilli ensemble dans le mélange de leurs vices et la communauté de leurs plaisirs; se disjoindre est devenu impossible.
Mais alors n'y aurait-il pas quelque remède ?
Oui, vraiment, il existe un remède
Sur la tunique envoyée par Déjanire il n'y avait que le sang d’un centaure; Sur la race juive, il y a le sang d'un Dieu: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ! Lorsque, des deux côtés, ce sang sera invoqué comme un miséricordieux et divin remède, tout
pourra s'apaiser et se guérir.
LIVRE DEUXIEME Les nations de l’Europe désorganisées et le peuple juif organisé par le même homme.
CHAPITRE PREMIER LE ROYAUME DE DIEU ET DES NATIONS
I. Comme quoi la religion chrétienne a proposé la félicité sous la forme d'un royaume de Dieu, non-seulement pour l'autre vie, mais dès cette vie. L'Eglise catholique est l'expression visible de ce royaume. — II. Superbe enchâssure des nations dans le royaume de Dieu; la place de chacune; saint-empire et république chrétienne — III. Tableau de leur félicité: floraison du règne de la justice au milieu d'elles. — IV. Contraste avec la misérable condition des juifs. — V. Réponse à une objection des juifs tirée des restes de barbarie qui assombrissaient les nations, malgré leur enchâssure dans le royaume de Dieu.
I
Le Christianisme, qui a eu en tout le mérite de l'originalité, est, des différentes religions, la seule qui ait représenté et proposé aux hommes la félicité sous la forme d'un royaume de Dieu.
Voici, en effet, la grande parole de l'Evangile qui a établi à jamais une alliance, une sorte d'équation, entre ce royaume et la félicité:
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît (121).
La région du bonheur, que tous les hommes cherchaient, après laquelle les générations avaient soupiré, la voilà donc enfin désignée, déterminée: et cette région, c'est un royaume de Dieu et la justice. Il n'y a qu'un Dieu qui, connaissant notre nature parce qu'il l'a faite, pouvait nous présenter la félicité sous une forme aussi précise et aussi heureuse que celle d'un royaume relevant de lui.
En effet, quelle idée nous faisons-nous du bonheur ? A quels signes jugeons-nous qu'il y a félicité quelque part ?
D'ordinaire, nous disons qu'il y a bonheur, quand les trois conditions suivantes se trouvent réunies:
Premièrement, quand il y a possession, abondance, plénitude, rassasiement;
Deuxièmement, lorsque dans la possession, dans l'abondance, il y a paix, ordre, harmonie, tranquillité;
Troisièmement, lorsque dans cette possession et dans cette paix, il y a durée. De fait, le bonheur nous apparaît comme un état stable. Une félicité où la durée n'entrerait pas ne serait pas une vraie félicité. Nous avons besoin, pour être heureux, de nous persuader que notre bonheur ne finira pas. Aussi, est-ce par là que les peuples, quelque effort qu'on fasse pour les démoraliser, seront toujours avertis de ne pas confondre le plaisir avec le bonheur. Nous goûtons le plaisir comme une situation transitoire, comme un acte passager, qui ne dure pas, tandis que nous entrevoyons le bonheur comme un état qui dure. Oui, le plaisir ne sera jamais qu'une situation transitoire; le bonheur, lui, est un état. On aura beau prodiguer aux peuples des plaisirs et encore des plaisirs, l'absence de durée leur fera toujours comprendre qu'ailleurs est le secret d'être heureux.
Ainsi: Abondance, possession, plénitude; Paix, tranquillité de l'ordre; Durée;
Tels sont les trois éléments qui concourent à la formation de la félicité.
Cela étant, le Christianisme pouvait-il proposer la félicité aux hommes sous une forme plus précise, plus juste que celle d'un royaume de Dieu ?
En effet,
a) La félicité consiste d'abord, avons-nous dit, dans la possession, dans l'abondance et la plénitude;
Or, quelle expression plus exacte de cette abondance, de cette plénitude, qu'un royaume de Dieu ?
Un royaume n'est-il pas réputé, parmi les hommes, un assemblage de tous les biens ? Quels ne seront pas alors les biens et les richesses d'un royaume où Dieu serait souverain ?
b) La félicité consiste, également. dans la paix, l'ordre, l'harmonie.
Or, quelle plus juste expression de l'ordre et de la paix qu'un royaume de Dieu ?
Un royaume, avec toutes ses forces organisées, pondérées, est déjà la plus belle représentation de l'ordre sur la terre. Mais que penser alors de l'ordre et de la paix dans un royaume qui porterait le nom de royaume de Dieu ?
c) Enfin, la félicité réclame la durée, un état stable.
Là encore, quelle plus juste expression de cette durée qu'un royaume de Dieu ?
Un royaume, parce qu'il est organisé pour durer, se nomme précisément un Etat.
Et que penser alors de la stabilité dans un royaume où Dieu demeure ?
Donc abondance, tranquillité de l'ordre, durée: un royaume de Dieu renferme tout cela.
La félicité pouvait-elle être proposée aux hommes sous une forme plus précise, plus neuve, plus attrayante ?
Mais ce royaume est-il réservé seulement à l'autre vie, ou bien s'étend-il également à cette vie, à la terre ?
Evidemment, le royaume de Dieu n'apparaîtra dans tout son éclat que dans la révélation des cieux. Néanmoins il commence et fleurit ici-bas.
Le royaume de Dieu est parvenu chez vous (122), disait formellement le Christ aux foules qui l'écoutaient. Les Pharisiens l'interrogent: Quand le royaume de Dieu doit-il venir ? Il répond: Il est au milieu de vous (123). Et, un jour qu'on lui présentait un petit enfant, il dit: Quiconque n'acceptera point le royaume de Dieu comme cet enfant n'y entrera point (124).
Le royaume de Dieu est donc là-haut, et il est également ici-bas: comment concilier cette apparente contradiction ? C'est bien simple.
Dans l'éternité, le royaume apparaîtra comme la fleur apparaît sur la tige, et le fruit sur la branche; mais, dans le temps, il commence, fleurit, et se développe.
Qu'on veuille bien prendre garde à ceci: le royaume de Dieu sur la terre est au royaume de Dieu dans les cieux ce que le germe et la floraison sont à l'épanouissement. Il est jetée en germe ici-bas, pour apparaître et s'épanouir là-haut; car la terre est le lieu de toute culture et de toute floraison; le ciel, le lieu de tout épanouissement et de toute plénitude. Mais c'est substantiellement le même royaume, le mode seul est différent.
Comme, avec cette doctrine, les paraboles du Christ sur le royaume de Dieu apparaissent simples et lumineuses !
Par exemple, la parabole du grain de sénevé: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme prend et sème en son champ... et qui devient un grand arbre.
L'épanouissement du royaume est montré du côté du ciel: le royaume des cieux... un grand arbre; mais ses prémices et sa floraison se font du côté de la terre: un grain de sénevé qu'un homme prend et sème en son champ.
Par exemple encore, la parabole du levain: Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend, et qu'elle mêle dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.
La pâte toute levée représente le côté céleste du royaume; mais le côté terrestre du même royaume est représenté par le travail du levain dans les trois mesures de farine.
Par exemple encore, la parabole de la perle: Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui est dans le trafic et qui cherche de belles perles; en ayant trouvé une de très grand prix, il va vendre tout ce qu'il avait et l'achète.
La possession de la perle, c'est le royaume possédé dans les cieux; mais c'est ici-bas que se fait le trafic et qu'il faut tout vendre pour se procurer la perle, c'est-à-dire l'entrée du royaume.
Ainsi donc, un seul royaume de Dieu, mais qui a deux phases: une phase d'épanouissement et de gloire, au ciel; une phase de formation et de progrès, sur la terre.
On demandera peut-être pourquoi la souveraine Sagesse a partagé ainsi son royaume en deux phases.
Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour le comprendre. La Sagesse a réglé qu'ici-bas toute chose commencerait à l'état de germe, pour atteindre ensuite son épanouissement:
La plante est bouton et fleur avant de devenir fruit;
L'homme est enfant avant de devenir homme fait;
La religion a été judaïsme avant d'être christianisme
L'Eglise est militante avant d'être triomphante;
La grâce aura été la foi avant de devenir la gloire.
La divine Sagesse ayant donc réglé que tout dans son œuvre serait soumis à une loi de floraison et de progrès, on ne voit pas pourquoi le royaume de Dieu lui-même n'aurait pas été soumis également à cette magnifique progression: et, de fait, avant que de s'épanouir dans les cieux, il a été établi qu'il fleurirait et progresserait sur la terre.
Un dernier trait à signaler: la liaison entre ce divin royaume et l'Eglise catholique.
Une chose, ici-bas, pour durer, ne doit-elle pas descendre, de la sphère idéale, dans une institution positive ? Le royaume de Dieu, jeté en germe et fleurissant sur terre, devait donc avoir aussi son institution, et c'est l'Eglise. Elle est organisée comme un royaume, et quelle autre société présente aux hommes, en luttant contre leurs passions et en les couvrant de bienfaits, plus de justice et plus de bonheur ?
Qu'on remarque, en outre, cette admirable progression: Le Messie qui a passé en faisant le bien, ayant été annoncé comme le Désiré des Nations, devait travailler, non plus seulement pour la petite Judée, mais pour l'univers. Avec lui, le bonheur, soit céleste soit terrestre, cesserait d'être le lot de quelques-uns, pour devenir la vocation de tous. Voilà pourquoi Jésus a substitué au peuple de Dieu, c'est-à-dire à la Synagogue, le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Eglise. Le peuple de Dieu s'est élargi en royaume de Dieu, et la Synagogue, en l'Eglise, pour que tout le monde pût y entrer et être heureux.
Un royaume embrasse l'espace; un royaume de Dieu devait embrasser tous les espaces: c'est bien le caractère de l'Eglise catholique ou universelle.
« Toute cette enchâssure est divine », pour employer le mot de Pascal.
II
Les nations ont été appelées dans cette enchâssure, mais avec la liberté d'en sortir.
Parlons d'abord de leur appel et de leur radieux effet dans l'enchâssure.
Il y avait la Gentilité avant le christianisme, c'est-à-dire les nations, rapidement entraînées par le paganisme dans un état de décomposition et de décrépitude. Le christianisme les a remaniées, pour les sauver et les harmoniser avec le royaume de Dieu où elles devaient entrer. Il les a remaniées, en respectant avec un tact divin, et en retenant soigneusement, ce qui se trouvait de bon en chacune d'elles. Il s'est servi aussi, comme d'un élément de régénération, du sang neuf des Barbares ou des nations germaines, gardées en réserve par la Providence. Ce sang neuf a été la partie passive de la régénération des nations. Le christianisme a soufflé, dans ces éléments conservés, un esprit nouveau, un ferment divin, toutes les beautés et toutes les ardeurs de l'idéal chrétien, du surnaturel. Alors les nations ont été dignes de l'enchâssure.
Elles y furent réparties avec le soin que met un artiste à distribuer et à ranger des pierres de grand prix dans un écrin. Le royaume de Dieu ou l'Eglise était l'écrin.
Ce qui frappe d'abord dans l'enchâssure, c'est la variété dans l'unité: bienfait que le royaume de Dieu ménageait aux nations rangées sous sa loi d'amour. Les petits Etats subsistent avec sécurité à côté des grands. Quelle magnifique floraison de principautés, de petites républiques, de duchés, de villes libres, fortes, glorieuses, souveraines comme des royaumes: Gênes, Pise, Venise, Florence ! La chrétienté fut l'expression de cette variété dans l'unité.
Ce qui frappe ensuite dans l'enchâssure, c'est le rôle providentiellement assigné, au sein du royaume de Dieu, à chaque nation en particulier: rôle merveilleusement adapté aux qualités naturelles et au génie propre de la nation. L'Italie remplira glorieusement cette fonction d'enseigner qui est la sienne aux onzième et douzième siècles, à l'époque de ses grands docteurs. La France sera le bras droit de la chrétienté et portera l'épée levée pour la défendre contre tous. L'Espagne et le Portugal, avec leurs flottes, iront au devant de ces nations attardées qui n'ont pas encore vu luire la lumière de la civilisation chrétienne. Voilà la destinée, le caractère de ces nationalités transformées par le travail intérieur du christianisme. Chacune d'elles a une mission sociale dans le royaume de Dieu.
Enfin, une dernière particularité charme et ravit dans l'enchâssure, c'est la protection que le royaume de Dieu vient demander aux royaumes, même aux petits Etats, qu'il enclave. Certes, le royaume de Dieu protège, le premier, ses chères nations, puisque c'est lui qui les a formées et qui les conserve. Néanmoins, en vertu de cette exquise subordination que se plaît à rechercher l'amour, le royaume de Dieu ou l'Eglise vient dire à chaque Etat protégé: Protège-moi !
Cette subordination mutuelle par révérence compose en grande partie l'éclat et le charme du Moyen Age. Elle a produit, dans les jeux de son amour, cette délicieuse antithèse historique: le saint-empire et la république chrétienne.
L'idéal et la réalité du saint-empire furent une grande chose: l'idéal, plus encore que la réalité. Cet empire, tel que Charlemagne le conçut, eut de l'Eglise le sacre, et la mission de réaliser le royaume de Dieu parmi les hommes, c'est pourquoi on l'appela le saint-empire. Il eut de Rome la tradition du gouvernement, et l'héritage des lois les plus sages qui furent jamais, c'est pourquoi on l'appela le saint-empire romain. Mais il garda des Barbares le génie belliqueux, un certain respect de l'indépendance personnelle, et la coutume de ne point faire de loi sans consulter la nation au moins dans l'assemblée de leurs chefs: voilà pourquoi on l’appela le saint-empire romain de la nation germanique. Quand l'Empereur, au jour de son couronnement, se montrait le diadème en tête, tenant d'une main le sceptre et de l'autre le globe du monde, faisant porter devant lui la croix, la lance et le glaive, entouré de la féodalité sous les armes et des députés des villes libres du Danube et du Rhin; en présence d'un si grand spectacle, la foule répétait cette acclamation solennelle: « Le Christ est vainqueur, le Christ règne, le Christ a l'empire ! Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ! » Ce grand dessein du saint-empire n'eut qu'un moment de réalité, quand Charlemagne, maître de la Gaule, de l'Italie, de la Germanie, reçut à la fois l'hommage du duc des Basques, du roi des Asturies, qui se déclarait son vassal, et des chefs de clans irlandais, qui le nommaient leur seigneur et leur maître, pendant que les empereurs byzantins traitaient avec lui de puissance à puissance, et que le calife Aaroun-al-Raschid lui envoyait les clefs du Saint-Sépulcre. Après ces courtes années, l'empire d'Occident se perd dans les partages de famille... Mais il ne fut pas si facile d'en finir avec un dessein auquel Charlemagne avait attaché son nom. Seulement Charlemagne, comme tant d'autres ouvriers de la Providence, fit autrement qu'il ne voulait, plus qu'il ne voulait. Il ne réussit pas à reconstruire une monarchie universelle, dont le règne eût été la ruine des nationalités, qui eût enrôlé pour ainsi dire tous les peuples au service du même pouvoir sous une même discipline. La liberté des nations résista: elles restèrent avec leur différence de vocations, de caractères, de génies. Mais le nom de l'empire servit à maintenir l'union des peuples occidentaux, à fonder parmi eux le droit international, à former cette famille puissante la latinité, qui fit les croisades, la chevalerie, la scolastique, toutes les grandes choses du Moyen Age. Ainsi l'empire ne tomba que pour laisser sortir de ses ruines ce qu'on appela la république chrétienne; et, si l'unité politique périt l'unité spirituelle fut constituée (125).
République chrétienne, venons-nous d'écrire. Chose remarquable, l'œuvre de Dieu ici-bas est un royaume, puisqu'on dit le royaume de Dieu; immuable, puisque rien n'en pourra jamais détruire ni changer la forme, et qu'à la fin des temps le Christ, comme il est annoncé, remettra le royaume à son Père (126); et cependant, durant une longue période de siècles. On voit se mouvoir à l'aise, dans ce royaume imperturbable. quoi ? la république chrétienne, c'est-à-dire le concert de tous les Etats de l'Europe, grands et petits, monarchies et républiques, qui, protégés de l'Eglise, se montrent à leur tour ses protecteurs. Ils sont dans l'Eglise qui les enclave ce qu'une variété de rubis, de saphirs et d'autres pierres précieuses, est dans une magnifique couronne d'or. Chaque pierre a son éclat, sa couleur. L'enchâssure les fait valoir; mais, en retour ? la couronne est rehaussée par leur réunion. Ainsi, protectrice des Etats, l'Eglise était fière et reconnaissante de la réciprocité de leur protection; et les souverains Pontifes perpétuèrent à jamais la gratitude du royaume de Dieu en appelant la France la fille aînée de l'Eglise, l'Espagne la nation très catholique, le Portugal le royaume très fidèle, l'Autriche-Hongrie le royaume apostolique.
III
Assemblage, éclat extérieur des nations enchâssées dans le royaume de Dieu: c'est ce qu'on vient de lire. Un complément est nécessaire: l'influence interne du divin royaume sur chacune des heureuses enchâssées.
Dans le tableau de cette félicité des nations, nous n'indiquons que les grandes lignes, et encore, celles seulement qui ramènent une comparaison avec le peuple juif.
Le Christ avait présenté la justice comme inséparable du royaume de Dieu, Cherchez le royaume de Dieu et la justice. La justice devait donc être le principal caractère de la félicité des nations. En quoi consiste-t-elle ? Voici:
Reconnaître le droit d'autrui, le vouloir comme notre propre droit, le maintenir contre l'égoïsme, c'est aimer le prochain comme soi-même, c'est la justice ! C'est la justice, non pas abstraite, mais pratiquée. De cette justice réelle, vivante, concrète, naquit l'honneur: l'honneur qui fut un regard élevé du chrétien sur lui-même, une pensée de sa noblesse, et, aussi, de celle du prochain. Or, durant les siècles de leur enchâssure au royaume de Dieu, les nations fleurirent de cette justice mêlée d'honneur. Constater cette belle floraison dans la chevalerie, dans le château, serait un éloge suranné: il suffira de la reconnaître auprès du peuple, dans la commune.
République obscure, mais respectée, la commune eut la charte de ses droits, possédant son conseil, ses chefs, sa milice et son drapeau. Sous cette protection sérieuse qui liait l'honneur des classes plus faibles à celui des classes plus fortes, se forma dans la société chrétienne, non pas seulement par les arts libéraux, mais encore par le commerce et l'industrie, si méprisés des anciens, une arrière-garde de savoir et de probité qui prit rang dans les destinées de l'Europe, et se prépara pour elle-même un avènement plus complet à la vie publique. Ce qui restait de l'esclavage légué par le monde ancien au monde nouveau tendit chaque jour à s'adoucir puis à disparaître. L'ouvrier fut libre, et, averti par l'exemple de l'Eglise, de la noblesse et de la bourgeoisie, que tout homme isolé est un homme perdu, il s'associa pour être respecté. S'il eut encore des maîtres, il eut aussi des droits; il ne fut plus seul en présence de la richesse, ni seul non plus en présence du malheur. Ainsi, du prince au pauvre, du souverain pontife à l'artisan, s'établit dans la chrétienté politique une hiérarchie où chacun avait sa place, son pouvoir et son honneur, et où, nul n'étant seul, tout le monde était quelque chose: vaste assemblée d'hommes divisés par nations et où se réalisait, malgré les vestiges subsistants des mœurs barbares, cette forme de gouvernement, composé de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, qu'Aristote estimait la meilleure, et dont saint Thomas d'Aquin donnait après lui cette description: « Le gouvernement est parfait dans une ville ou dans un peuple lorsqu'un seul y préside à tous selon la vertu, qu'il a sous lui des grands qui partagent son autorité selon la vertu, et qu'enfin l'un et l'autre principat est la chose de tous, soit parce que tous peuvent élire, soit parce que tous peuvent être élus (127). »
Les nations alors n'étaient-elles pas heureuses ? La justice élève une nation (128): n'étaientelles pas élevées, grandes, magnifiques ? Le Christ s'est servi de cette comparaison: Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénevé qu'un homme prend et jette dans son jardin, et qui croît jusqu'à devenir un grand arbre; de sorte que les oiseaux du ciel se reposent sur ses branches (129). Cette riante comparaison a passé, ce semble, de l'Evangile dans l'histoire des nations chrétiennes, y devenant une réalité consolante. L'arbre a fleuri au Moyen Age. L'histoire de France ne présente-t-elle pas saint Louis assis sous le chêne de Vincennes, rendant la justice, et les populations empressées autour du meilleur des monarques ? Ces paysans qui s'en revenaient joyeux, bénissant Dieu et le roi, n'étaient-ce pas les oiseaux du ciel qui chantaient sur les branches, et à l'entour ?
Que vous avez été belles, ô nations ! Le Prophète royal inspiré par la vision de votre prospérité dans le royaume de Dieu, vous avait consacré ses chants d'avenir les plus enthousiastes. Vous les avez réalisés. Nations, louez toutes le Seigneur; louez-le tous, peuples de la terre. Vous l'avez loué et vous aussi, vous étiez dignes d'éloges !
IV
Cette beauté et cette prospérité s'augmentaient d'un contraste avec la misérable condition des juifs.
Eux, également, étaient les tributaires du règne de la justice, mais sous un aspect fort différent: tributaires de la justice comme punition. Ils expiaient au milieu des nations une double grande faute, celle que toute la terre connaît, le déicide, et une autre moins connue, leur conduite coupable à l'égard des nations. A quelle époque et de quelle manière avaient-ils donc commencé à être coupables à l'égard des nations ? Ainsi qu'il suit:
Le peuple de Judée avait été choisi comme peuple de Dieu, et à ce titre comblé de faveurs: choisi toutefois, non pour se replier éternellement sur lui-même et savourer avec avarice ses privilèges, mais pour s'épanouir comme la plante et présenter son fruit, le Messie, aux autres nations qui l'attendaient. Le rôle d'Israël devait donc consister à passer un jour du particulier à l'universel. Peuple de Dieu, il devait, à l'époque de la venue du Messie, se transformer, s'agrandir en accueillant toutes les nations, et former avec elles, dans une sublime synthèse, le royaume de Dieu.
Or, quand vint le moment de passer ainsi du particulier à l'universel et de s'unir aux nations, le peuple juif sentit une jalousie immense monter dans son âme. Cette idée de l'égalité spirituelle
— n'être plus tout seul à l'avenir le peuple de Dieu, mais former avec les autres nations le royaume de Dieu; n'avoir plus de privilèges, ne posséder plus en propre la Loi, le Temple, mais former désormais une seule Eglise avec les Gentils, avec le reste du monde, — en un mot. l'égalité spirituelle: cette perspective lui fut insupportable ! Le crime du Calvaire fut décidé, et, de plus, le peuple juif fit l'impossible, comme le rapporte le livre des Actes, l’impossible, pour empêcher l'Evangile d'être prêché aux Gentils. Il employa tout pour entraver la religion universelle. Même les juifs qui croyaient fermement en Jésus-Christ s’opposèrent un instant, par amour pour la Synagogue, à cet appel fait aux nations. Ce fut l'hérésie des Judaïsants, la première et la plus délicate de toutes les hérésies. En un mot, le judaïsme. aveugle, égoïste et jaloux, se mit en travers de la porte du royaume de Dieu, pour empêcher les nations de passer et d’entrer. On sait le châtiment. Le peuple juif fut balayé dans l'universel, c'est-à-dire à travers toutes les nations.
C'est donc au milieu d'elles que les juifs expiaient leur double faute. Le châtiment était, du reste, adapté, comme il convenait, à leur égoïsme et à leur jalousie.
D'abord tous leurs privilèges d'ancien peuple de Dieu avaient passé aux nations, en tant qu'elles faisaient partie du royaume de Dieu. Ils avaient possédé l’adoption des enfants; elles la possédaient, puisque, par le baptême, les enfants de Dieu se faisaient chez elles. — Ils avaient possédé la présence glorieuse de Dieu: elles la possédaient, puisque le tabernacle renfermant la Présence réelle, était établi et universalisé chez elles. — Ils avaient possédé l’alliance: elles la possédaient. puisque les divins sacrements qui unissent Dieu et l'homme. étaient administrés chez elles. — Ils avaient possédé la Loi: elles la possédaient, puisque le Décalogue et l'Evangile étaient enseignés et observés chez elles. — Ils avaient possédé le culte: elles le possédaient, puisque le sacerdoce se recrutait chez elles, que les églises nombreuses comme les étoiles du ciel se bâtissaient chez elles, et que toutes les fêtes, avec leurs pompes, leurs parfums et leurs réjouissances, se célébraient chez elles. — Ils avaient possédé les promesses: elles les possédaient, puisque toutes les douceurs de la familiarité divine, grâces, dons, consolations, extases, suavités, apparitions, en un mot tout ce que le Ciel avait promis de bon était prodigué chez elles.
Et ainsi, dans ce transfert aux nations de ses antiques privilèges, il y avait, pour le peuple juif, une éclatante première punition de son égoïsme et de sa jalousie.
La seconde n'était pas moins bien infligée: une misérable condition pour lui, en face de la prospérité et de la félicité des nations. Tandis qu'elles ressemblaient, comme nous l'avons dépeint plus haut, à des pierres précieuses enchâssées dans le royaume de Dieu, eux ressemblaient à des grains de blé ballottés dans un crible, et le crible était ces nations qu'ils détestaient. Un de leurs prophètes leur avait annoncé, au nom du Seigneur, un pareil châtiment: Je n'exterminerai pas entièrement la maison de Jacob; mais je les disperserai dans toutes les nations, par une agitation semblable à celle que l'on donne au blé quand on le secoue dans un crible: pas un seul grain ne tombera à terre, mais sera poussé au loin par l'ébranlement général (130). Toutes les nations ont exécuté cet ordre. Toutes se sont opposées à ce que les juifs fussent un peuple homogène, et ce peuple, dispersé dans tous les autres, ressemblait parfaitement aux grains de blé qu'une violente agitation sépare, en les poussant en divers endroits du crible. Secoués en France, secoués en Espagne, ils montaient en Angleterre; secoués en Angleterre, ils descendaient au Maroc; secoués au Maroc, ils passaient à Constantinople; ils ne rencontraient nulle part stabilité et sécurité.
En opposition avec cette condition misérable, les nations fleurissaient, tranquilles et heureuses.
V
Il y a, toutefois, une objection des grains de blé contre les pierres précieuses.
L'ère messianique, disent les juifs, doit concorder avec l'établissement de la justice et de la paix dans le monde entier. Ses signes seront ceux-ci: la transformation des armes de guerre en instruments de labour; le respect du faible par le fort, de l'agneau par le loup; la réconciliation des frères divisés, d'Ephraïm avec Juda; la reconnaissance et l'amour d'un seul Père suprême; la réunion de tous les hommes troupeau unique conduit par un seul Pasteur; le concours universel des peuples sur la montagne de l'Eternel; et enfin, suivant une ambitieuse espérance, le monde entier devenu la Terre Sainte.
Or, peut-on dire que ses signes providentiels de l'époque bénie se soient déjà réalisés ?
Loin de là, ajoutent les juifs: et alors ils citent à l'appui les désordres de toute espèce, les guerres, les épisodes sauvages qui n’ont cessé d'assombrir ou de défigurer les nations nonobstant leur enchâssure au soi-disant royaume de Dieu.
Ils en tirent cette conclusion: que le Messie n'est point venu.
La réfutation est aisée.
Considérons d'abord les signes providentiels de l'époque bénie. — N’ont-ils pas commencé à se réaliser d'une façon éclatante avec l'Evangile de Jésus de Nazareth, livre unique de justice et de paix ? Or, leur réalisation n'a pas cessé depuis. L’Eglise, qui applique l'Evangile, n'estelle pas le royaume de la justice et de la paix ? N'est-elle pas la montagne où les nations sont montées ensemble ? N'est-elle pas l’asile du faible contre le fort et de l'agneau contre le loup ? N'est-elle pas le bercail où le Pasteur unique ouvre ses bras à tous les hommes, à tous les peuples ? Seulement, tous ces signes providentiels accumulés dans l'Eglise se développent au fur et à mesure des générations, afin que sa mission de justice et de paix soit successive avec les siècles. C'est très heureux pour chaque siècle. Si un seul siècle avait concentré en lui-même les signes du Messie venu, que serait-il resté à faire, pour les autres ? Au contraire, chaque siècle présente, avec le sceau de l'Emmanuel, le témoignage qu'il appartient par ses progrès, à l’ère messianique, à l'époque bénie. C'est ainsi que l'un apporte au compte commun le défrichement de l'Europe; un autre, l'institution des écoles et des législations; un autre, les cathédrales; un autres la trêve de Dieu; celui-ci, la scolastique et la Somme de Thomas d'Aquin; celui-là, la chevalerie; cet autre, les croisades; cet autre, la découverte du Nouveau Monde; cet autre, les œuvres de saint Vincent de Paul. De la sorte, le royaume de Dieu, qui date de l'ère messianique, soumis, comme tout ce qui est terrestre, à la loi de la floraison et de la croissance, aura présenté, dans la succession des siècles, l'aspect d'une moisson toujours mûrissante, toujours grandissante; et l'on comprend ainsi que la consommation des siècles soit ce qu'annonce l'Evangile: la plénitude de la maturité et le recueillement dans les greniers célestes.
Des signes providentiels passons aux restes de barbarie chez les nations. — Oui, sans doute, les nations, nonobstant leur appel dans le royaume de Dieu, ont présenté, par leurs vices, leurs écarts et leurs guerres, des contradictions avec ce royaume et avec la venue du Messie. Mais il ne faut pas oublier en quel état elles se trouvaient quand ce divin royaume les a acceptées à votre place, infidèles enfants d'Israël ! Elles sortaient de l'état de gentilité, état de nature et de barbarie: vous étiez vous-mêmes pleins de mépris pour cet état.
L'Eglise, chargée du royaume de Dieu, a entrepris leur éducation. A cause de la liberté humaine et aussi à cause de la ténacité de tout ce qui est nature, s'il faut des années pour corriger les défauts dans un individu, il faut des siècles pour les corriger dans une nation. Et l'Eglise qui, comme Dieu, est patiente parce qu'elle est éternelle, l'Eglise a employé des siècles à corriger les défauts des nations. Ah ! s'il n'eût tenu qu'à elle d'assurer et de fixer le bonheur, il y a longtemps que le monde eût vu réalisées et la prophétie des épées transformées en socs de charrue, et l'ambitieuse espérance de la terre entière devenue la Terre Sainte. Mais, éducatrice pleine de mesure, l'Eglise savait qu'elle avait à combattre les restes de l'état de nature, et elle se gardait d'exiger des nations encore à l'âge d'enfance les qualités que l'on admire dans l'homme robuste et parfait. Néanmoins, à ses leçons aussi respectueuses que tendres, les nations corrigeaient lentement mais sûrement les défauts de leurs natures respectives. L'Italie s'est corrigée, la France s'est corrigée, l'Espagne s'est corrigée, elles se sont toutes corrigées. Aussi, de même qu'à leur arrivée et dans leur réunion au sein de l'Eglise, les nations avaient cessé d'être la gentilité pour devenir la chrétienté, de même leurs progrès furent désignés par un nom nouveau dans le monde, la civilisation: de barbares qu'elles étaient au temps où les juifs attendaient le Messie dans la Palestine, elles devinrent civilisées quand le Messie eut passé.
Pauvres grains de blé secoués dans le crible de la justice en vérité êtes-vous bien venus à tirer conclusion contre le Christ des scories des pierres précieuses ? Si dans les défauts des nations, vous cherchez des arguments contre le royaume de Dieu, quels terribles arguments n'aurait-on pas trouvé dans vos défauts à vous, quand vous portiez le titre de peuple de Dieu ! On vous le reconnaissait, cependant.
Achevons la réfutation de l'objection par un regard sur les vicissitudes du royaume de Dieu.
— Ces vicissitudes, qui consistent dans des alternatives d'éclat et d'obscurité, de puissance et de faiblesse, constituent une des plus belles preuves de la venue du Messie: en ce sens qu'elles dénotent une harmonie parfaite entre le règne messianique et la personne du Messie, entre le roi et le royaume.
N'est-ce pas un principe de philosophie que l'effet doit toujours refléter les attributs de la cause ? Ainsi: dans la création s'aperçoivent les vestiges du Créateur, écoulements de sa beauté, de sa puissance et de sa bonté.
Si donc le Messie a déjà passé, il a dû nécessairement déposer dans son œuvre, et pour toute la durée de son œuvre, des reflets de sa personne; en d'autres termes, une harmonie parfaite a dû s'établir entre la personne messianique et le règne messianique, de telle sorte que les caractères de l'un soient aussi les caractères de l'autre.
Or, dans la physionomie de Jésus, quels ont été les traits saillants ? Ce sont les contrastes. Il s'est reproduit en lui quelque chose de la fameuse colonne de nuée et de feu qui guida Israël au désert: Jésus fut à la fois lumineux et obscur. Il naît dans une étable, entre deux animaux: mais une armée angélique apparaît dans les airs pour célébrer sa naissance; il est ignoré à Bethléem, mais un étoile merveilleuse lui amène les Mages, du fond de l'Orient. Et de même pour sa vie publique et pour sa mort, où les contrastes de lumière et d'ombres, les alternatives de puissance et de faiblesse s'appellent sans se heurter, et se soutiennent en commandant le respect, l'étonnement et l'amour. Ces contrastes ont frappé toutes les intelligences d'élite, depuis saint Augustin jusqu'à Pascal. Ce dernier a dit: « Quel homme eut jamais plus d'éclat ? Le peuple juif tout entier le prédit, avant sa venue. Le peuple gentil l'adore, après sa venue. Les deux peuples gentil et juif le regardent comme leur centre. Et cependant, quel homme jouit jamais moins de tout cet éclat ? De trente trois ans, il en vit trente sans paraître. Jamais homme n'a eu tant d'éclat; jamais homme n'a eu plus d'ignominie. » Et ce grand géomètre de la pensée exacte donne la raison de ces contrastes: « On n'entend rien, dit-il, aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il a voulu aveugler les uns et éclairer les autres (131). »
Regardons maintenant l'Eglise, royaume de Jésus. Il s'y continue les mêmes contrastes: la fondation ressemble au fondateur. En elle comme en lui, alternatives de puissance et de faiblesse, non moins étonnantes, non moins harmonieuses non moins soutenues, non moins triomphantes. Lumière et ombres dans sa catholicité: des peuples la quittent, d'autres lui viennent; son étendue est perpétuellement modifiée, sans être dépassée, cependant, par les religions rivales. — Lumière et ombres dans sa sainteté: à côté des meilleures lois, des abus se produisent, et au milieu des légions d'anges, des scandales paraissent; mais sa sainteté n'en est pas atteinte. « Qui jamais jugea de l'Océan par l'écume qu'il rejette sur ses bords, ou par les tempêtes qui agitent ses flots ? L'Océan n'est pas dans les impurs débris de ses rives ni dans l'inclémence de ses orages: il est dans la profondeur et l'étendue de ses eaux, dans les chemins qu'il ouvre au commerce de toutes les races, dans la solennité de son repos, dans la magnificence de ses émotions, dans l'abîme de ses bruits comme dans l'abîme de son silence; et, lorsque le matelot, porté sur ses voûtes tranquilles, les voit tout à coup trembler et gronder, il n'accuse pas le Dieu qui a fait cette immensité sublime, il n'accuse que sa faiblesse, et le front par terre, sur la planche de son navire, il implore l'étoile qui conduit tout, et qui pacifie tout (132). » - Lumière et ombres dans les dispositions de ses propres sujets: tantôt le royaume de Dieu est favorisé et soutenu, tantôt il est restreint et combattu. La jalousie des princes est aussi célèbre que leur dévouement; et la vie de l'Eglise, dans les hommages et les tribulations qui lui viennent des pouvoirs civils, rappelle ces deux journées de la vie du Christ: les foules veulent le faire roi parce qu'il a nourri cinq mille hommes au désert; et les habitants de Nazareth le chassent hors de leur ville, le mènent jusque sur la pointe de la montagne sur laquelle elle était bâtie, pour le précipiter: mais, dit l'Evangile, il passa au milieu d'eux, et il allait (133); et son règne, aussi, passe au milieu des difficultés, et il va toujours.
Et voilà la parfaite et magnifique harmonie qui existe entre les caractères de la personne messianique et les caractères du règne messianique, entre les qualités du Christ et les qualités de l'Eglise. Et voilà comment la cause resplendit dans l'effet, comment l'effet reflète les propriétés de la cause; admirable parenté, qui convainc que le doigt de Dieu est là, et qui arrache cette exclamation: Hosanna au roi, hosanna au règne ! Qui médite le Christ peut dire ce que doit être son règne; et qui médite son règne peut dire ce qu'a dû être le Christ. C'est là un des côtés les plus grandioses, les plus inattaquables du christianisme, qui a terrassé et ravi mon intelligence, contre lesquels on ne peut invoquer ni le hasard ni rien d'humain. Si jusqu'à ce jour mes ancêtres ne l'ont pas aperçu, c'est que, dans la nuit terrible du tribunal de Caïphe on a, entre autres outrages, couvert d'un voile le visage adorable du Christ, et que, par une conséquence pénale, le voile a passé, du visage, sur le règne. Ou plutôt, ni le visage ni le règne ne l'ont plus, mais il demeure, hélas ! en épais bandeau, sur des yeux aveuglés et des fronts endurcis (134).
Que la miséricorde daigne l'en faire tomber !
CHAPITRE II CE QUI RESTAIT DE LA BELLE ORGANISATION DES NATIONS A LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION ET DE L’EMPIRE.
I. Beaux restes, mais attristants. Une partie des nations est à peu près sortie de l'enchâssure du royaume de Dieu, par le protestantisme. — II. Missions civilisatrices le l'Europe interrompues au loin, ou considérablement amoindries. — III. L'autorité royale s'est gravement compromise: la caverne de la pythonisse d'Endor reparue dans l'histoire des monarchies. — IV. Cependant le XVIIIe siècle présente encore ce consolant spectacle: le royaume de Dieu lié aux royaumes de la terre. Mélancolie du royaume de Dieu à l'approche de la rupture — V. La Révolution de 1789, comme un tonnerre d'orgueil, annonce la cessation de cet antique état de choses, et elle lègue au siècle suivant la réalisation de cet affligeant programme. Le royaume de Dieu sans les royaumes de la terre, et les royaumes de la terre sans le royaume de Dieu. Les juifs, seuls, gagneront à la séparation.
I
Plaçons-nous à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution et du règne de Napoléon. Les nations, dont l’efflorescence s'est vigoureusement élancée avec Charlemagne (l'an 800), ont rempli une brillante carrière de mille années. Qu'en demeure-t-il, au seuil des temps nouveaux ? Qu'aperçoit-on de leur brillante carrière et de leur superbe organisation ?
De beaux restes, mais des restes !
D'abord plusieurs d'entre elles sont à peu près sorties de l'enchâssure du royaume de Dieu.
« Vous n'êtes plus des enfants », avait murmuré aux oreilles des nations la voix du démon de la suffisance par la bouche du moine apostat Luther; et les nations du nord de l'Europe avaient, malheureusement, répété: Nous ne sommes plus des enfants ! Comme si, au regard de l'Eglise pleine de tact et de révérence, il n'y a pas gloire et profit à demeurer toujours son enfant. Elles avaient ajouté: Rompons son joug et jetons-le par-dessus nos têtes ! Et s'encourageant et s'entraînant, elles avaient abandonné le sein de l'Eglise.
C'est ainsi que l'Allemagne, la Prusse, la Suisse, l'Angleterre et les contrées scandinaves étaient à peu près sorties de l'enchâssure du royaume de Dieu.
Nous disons: à peu près sorties.
Si elles se sont retirées du royaume, elles conservent cependant une certaine apparence de fidélité au roi. Enfants rebelles, elles n'aiment plus leur sainte mère l'Eglise, mais elles prétendent aimer toujours Jésus qui est leur père. Bien plus, elles vivent de ce qu'elles ont emporté dans leur fuite. Car, selon une très juste comparaison qui a été employée: « Même dans les branches ostensiblement séparées de leur tige primordiale, l'Eglise entretient une sève régénératrice et produit des effets dont l'honneur lui appartient. C'est elle qui est encore le lien du schisme, le ciment tel quel de l'hérésie; ce qui y reste de substance et de cohésion vient du sang qu'elle y a répandu et qui n'est pas encore desséché, comme on voit des rameaux tombés à terre sous le tronc qui les porta conserver encore une végétation sensible à la lumière et à la rosée. La mort ne se fait pas en un jour au sein des esprits que la vérité illumina. Ils en gardent longtemps des reflets qui les éclairent, des impulsions qui les animent (135). »
Ce sont ces beaux restes qui ont maintenu, à travers les siècles du schisme, la vitalité des nations protestantes, en particulier de l'Angleterre. Magnifique navire, c'est dans les chantiers de l'Eglise qu'il s'est construit; mais, hélas ! son pavillon ne porte plus les couleurs de sa mère !
II
Autres restes.
La vocation des nations acquises à Jésus-Christ et à son Eglise était superbe. Elle ne consistait plus à étendre ses propres frontières, au préjudice de ses voisins. Telle avait été la gloire des peuples païens, particulièrement du peuple romain, le plus grand de tous: mais qu'était-ce que cette gloire ? des larmes et du sang. Cela était bon pour des races que le christianisme n'avait point encore touchées de son doigt. Bien supérieure était la vocation des races chrétiennes ayant pour objet de répandre la vérité, d'éclairer les nations moins avancées vers Dieu, et de leur porter, au prix du travail et au hasard de la mort, les biens éternels, la foi, la justice, la civilisation.
Mais, depuis l'apparition du protestantisme, cette mission civilisatrice s'est trouvée considérablement diminuée, amoindrie. Baissez la tête, nations chrétiennes: si la barbarie se trouve encore à vos portes, si l'islamisme conserve ses campements dans l'une des situations les plus belles de l'Europe, si l'Asie garde son immobilité, son despotisme et sa polygamie, si les côtes de la Palestine et la pauvre Afrique sont devant vous dans un état de dégradation qui forme avec les grands souvenirs de l'histoire un douloureux contraste, si l'Amérique éprouve de sanglants déchirements; baissez la tête, la cause en est dans votre inobservation du mandat de Dieu ! La sublime religion chrétienne, qui vous avait été donnée comme la bannière de l'avenir, de la conquête et de la civilisation, est devenue entre vos mains un drapeau de discorde. Les ressources et le génie, accumulés dans votre continent pour la régénération du reste de l'univers, ont été dévorés dans des guerres fratricides. Après que l'Europe eut été couverte de sang et de deuil, le scandale fut transporté devant les peuples du Nouveau Monde; et ces peuples sont demeurés frappés de stupéfaction au spectacle des misères, de la haine et de l'esprit de vengeance qui régnaient parmi ces hommes dont ils avaient fait d'abord des demi-dieux ! C'est la réflexion, l'accusation d'un fils de la catholique Espagne, Jacques Balmès; elle est terrible, mais elle est vraie. Il accuse justement le schisme de Luther d'avoir contrarié l'élan universel de la civilisation, et d'avoir ruiné en partie les missions bienfaisantes de l'Europe au loin (136).
Cependant, dans le brisement du concert européen, de beaux restes demeuraient encore de ces missions civilisatrices, à la fin du XVIIIe siècle. Si l'Etat n'est plus lui-même missionnaire, il protège les missionnaires. L'apôtre catholique, qui va arroser de ses sueurs et de son sang les forêts indienne ou américaine, peut compter sur l'assistance de la nation à laquelle il appartient; et, transporté presque toujours par les vaisseaux de l'Etat, il sent la fierté patriotique se mêler à la flamme apostolique. Le royaume de Dieu, plein de révérence et de ménagements pour les nations, a tourné la difficulté: n'étant plus conduit, ou protégé officiellement par les Puissances, il s'est confié aux missionnaires et aux ordres religieux sortis de ces Puissances. Il s'est dit, dans son embarras, mais aussi avec une délicatesse miséricordieuse: puisque les cèdres ne veulent plus me protéger et servir à mon avancement, les roseaux et les joncs me fourniront des barques !
Et les roseaux venaient de France, d'Italie, d'Espagne, nations toujours chères !
III
Si la diminution a entamé le nombre des nations fidèles, et si l'amoindrissement s'est fait sentir dans leur mission civilisatrice, une institution, sans doute, sera restée intacte dans leur sein: l'autorité royale ?
Hélas ! non.
Bossuet avait dit: « Les rois, non plus que le soleil, n'ont pas reçu en vain l'éclat qui les environne. » A partir du XVIIIe siècle, cet éclat a diminué, parce que les rois l'ont reçu en vain. Eux-mêmes ont compromis l'autorité.
Si l'on veut se rendre compte de cette éclipse, il importe de considérer successivement et la place qui avait été offerte aux monarques dans le royaume de Dieu, et celle qu'ils sont allés, tout à coup, prendre ailleurs.
Leur place réservée, dans le royaume de Dieu, a été décrite sous un brillant symbole. Un jour, un prophète d'Israël eut une vision qu'il raconte ainsi:
« L'ange du Seigneur me fit voir un chandelier d'or, et sept lampes brûlaient sur les branches de ce chandelier.
« Et je vis aussi deux oliviers qui s'élevaient, l'un à la droite du chandelier d'or et l'autre à sa gauche.
« Et je dis à l'ange: Mon seigneur, qu'est-ce que ceci ? Que signifient ces deux oliviers qui sont autour du chandelier, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche ?
« Et l'ange me répondit: Ces deux oliviers, ce sont les deux fils de l'huile sainte qui assistent et veillent devant le Dominateur de toute la terre (137). »
Or, voici, sur cette mystérieuse vision, une des plus belles explications données par les interprètes sacrés:
Le chandelier d'or c'est l'Eglise catholique, patrie de la lumière, de la vérité, et royaume de Dieu.
Les deux fils de l'huile sainte, veillant autour du chandelier, ce sont le sacerdoce et la royauté, le Pontife et le Prince. Tous deux, en effet, sont fils de l'huile sainte. Car le saint chrême fait les pontifes, et le sacre faisait les rois. Et tous deux étaient gardiens ensemble autour de l'Eglise catholique, comme les deux oliviers autour du chandelier d'or. Le sacerdoce veillait à droite, la royauté veillait à gauche. Le Pontife gardait l'alliance avec l'encensoir, le Roi la gardait avec le glaive. Le Pontife enseignait la vérité, et le Prince faisait observer la justice !... Ah ! qu'on se représente ce mystique chandelier d'or portant des flammes à toutes ses branches, c'est-à-dire l'Eglise catholique par un beau temps de lumière, de paix, de sérénité. Puis, qu'on se représente les flammes vives du chandelier répandant leurs lueurs: à droite, sur la tiare des pontifes, à gauche, sur la couronne des princes; à droite, sur des visages comme ceux de saint Pierre, de saint Grégoire, de saint Léon, et toute la chaîne des pontifes; à gauche, sur des visages comme ceux de Constantin, de Charlemagne, de saint Louis, et toute la chaîne des rois chrétiens. Qu'on se représente tout cela, ce chandelier d'or, ces flammes vives, ces nobles visages, ces grands noms, cette paix, cette sérénité, et l'on aura, dans cet ensemble, une image de ces temps fortunés où pour faire avancer le royaume de Dieu, il y avait union entre le Pontife et le Prince, entre le sacerdoce et la royauté !
Mais, tout à coup, les rois ont quitté leur place et l'ont changée contre une autre. Où donc sont-ils allés ?
Dans une caverne souterraine.
On conspirait dans cette caverne contre le royaume de Dieu, et les rois étaient là, complices de la conspiration. Nous n'avons qu'à choisir dans les nombreux documents des Sociétés secrètes:
...En Allemagne, la franc-maçonnerie avait attiré les princes à ses mystères. Après Frédéric de Prusse et la plupart des princes protestants, les princes catholiques eux-mêmes s'étaient laissé séduire. François de Lorraine, l'époux de Marie-Thérèse, avait été initié en 1731, à la Haye, dans une loge sous la présidence du comte Chesterfield. Grâce à cette protection secrète, malgré les bulles de Clément XII et de Benoît XIV, malgré l'édit de l'empereur Charles VI (1738), la maçonnerie se propagea sourdement dans l'Empire...
...Affilié dès sa jeunesse aux loges, Joseph II se livra complètement à des conseillers francs-maçons avancés. La destruction des ordres religieux, la confiscation dés biens de l'Eglise, la séparation des évêques d'avec le Pape, l'éducation civile donnée aux séminaristes, telle fut la tâche maçonnique que le malheureux empereur accomplit avec une ardeur voisine de la manie et qu'encourageait un concert d'adulations, où la dérision se mêlait amèrement chez ses perfides conseillers...
...L'impulsion donnée par Joseph II se propagea dans tout l’Empire (138).
En France, la franc-maçonnerie n'était pas encore montée sur le trône, mais elle en occupait les marches.
Le nouvel Ordre du Temple eut pour grand maître successivement le duc du Maine, le comte de Clermont, le prince de Conti, puis le duc de Cossé-Brissac qui, au moment de la Révolution, en avait le titre...
...Pour que la franc-maçonnerie passât de la propagande doctrinale et de l'influence morale à l'action politique, un travail de concentration et d'organisation était nécessaire. En 1779, elle se partageait en un grand nombre de rites. Or, il est très remarquable de constater que tout le travail de concentration des loges eut pour pivot le duc de Chartres, plus tard Philippe Egalité (139).
Il ressort de ces documents (l'histoire n'en fournit que trop d'autres) que les souverains ont ébranlé eux-mêmes la base de leur autorité. La plupart, placés entre le devoir royal et les suggestions des sectes, favorisaient en secret ce qu'ils condamnaient en public. La constitution chrétienne de leurs peuples, les habitudes vertueuses des populations, les traditions antiques des foyers, les obligeaient à désavouer les mœurs des souterrains, mais à la dérobée, en personnes ou par leurs émissaires, ils y participaient. Ils ont préparé eux-mêmes leur arrêt de mort. Cela nous rappelle la fin du premier roi chez la nation juive, car rien n'est nouveau sous le soleil:
Saül qui, pour accomplir la loi de Moïse, avait chassé, au début de son règne, les magiciens et les devins des terres d'Israël, revient à eux, lorsqu'il s'est mis à mal agir. Il va consulter en secret la pythonisse d'Endor. Cette consultation se fait la veille de sa chute et de sa mort. C'est là, dans une sombre caverne, qu'il apprend le sort qui lui est réservé; la page des Ecritures est saisissante:
« Ses serviteurs viennent lui dire: Il y a à Endor une femme qui a l'esprit de python.
« Saül se déguise, prend d'autres habits, et s'en va accompagné de deux hommes seulement. Il vient la nuit chez cette femme, et lui dit: Consulte pour moi l'esprit de python, et invoque-moi celui que je te dirai.
« Cette femme lui répond: Tu sais tout ce qu'a fait Saül, et de quelle manière il a exterminé les magiciens et les devins de toutes ses terres. Pourquoi donc me dresses-tu un piège pour me faire perdre la vie ?
« Saül lui jure par le Seigneur, et lui dit: Vive le Seigneur ! il ne t'arrivera de ceci aucun mal.
« La femme lui dit: Qui veux-tu que je te fasse venir ? Il lui répond: Fais-moi venir Samuel.
« La femme, ayant vu paraître Samuel, jette un grand cri, et dit à Saül: Pourquoi m'as-tu trompée ? car tu es Saül.
« Le roi lui dit: Ne crains point; qu'as-tu vu ? — La femme dit à Saül: J'ai vu un Dieu qui sortait de la terre.
« Saül lui dit: Comment est-il fait ? — C'est, dit-elle, un vieillard couvert d'un manteau. Saül reconnaît que c'est Samuel, et lui fait une profonde révérence, en se baissant jusqu'à terre.
« Samuel dit à Saül: Pourquoi as-tu troublé mon repos, en me faisant évoquer ? Le Seigneur te traitera comme je te l'ai dit de sa part. Il déchirera ton royaume (140)... »
Cette sombre et saisissante soirée de Saül chez la magicienne s'est renouvelée dans l'histoire des monarchies au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne. Les princes ont des alliances avec les souterrains. Et c'est de là que part leur arrêt de mort (141).
IV
Nonobstant la division de l'Europe en deux camps, nations protestantes et nations catholiques; nonobstant la paralysie de sa mission civilisatrice au loin; nonobstant l'infidélité des rois; nonobstant l'universelle et lamentable altération des mœurs, dont nous ne disons rien parce qu'on a tout dit sur ce triste sujet: nonobstant la brèche considérable causée à la foi et à la raison par le jansénisme et le philosophisme: le XVIIIe siècle présentait encore le consolant spectacle du royaume de Dieu lié aux royaumes de la terre, surtout en France ! Depuis Tolbiac, jamais l'erreur ou l'hérésie n'avait approché l'âme d'un roi de France, et le seul qui en avait été atteint loin des marches du trône n'avait pu y monter qu'en recevant à Saint-Denis, par une abjuration nécessaire, l'onction, sans tache encore, de la royauté française. Le moment est devenu solennel. On sent que deux sangs coulent à la fois dans les veines partagées des nations: le sang fécond de l'antiquité chrétienne et le sang énervé d'un scepticisme corrupteur.
L'attitude du royaume de Dieu, à ce moment, fait songer aux ailes étendues d'une façon si touchante dont parle l'Evangile, alors que le Christ voulait rassembler sous leur tendresse les enfants ingrats de Jérusalem: l'Eglise voudrait, elle aussi. vers la fin de ce XVIIIe siècle, retenir les nations dans son sein, sous ses ailes, mais elles se préparent à les quitter.
Oui, il y a vraiment une mélancolie de l'Eglise à cette époque poignante. Aussi bien, les alarmes des Souverains Pontifes, les avertissements des Evêques, les gémissements des âmes pieuses, en sont demeurés l'expression attristée et navrante. L'Evangile avait dit, à l'aurore joyeuse de la gentilité appelée: Le royaume de Dieu est proche... Il est parvenu chez vous; des signes funèbres disaient à présent: le royaume de Dieu s'en va, les nations n'en veulent plus. Il y aurait, toutefois, erreur à penser que le royaume de Dieu puisse s'en aller; il demeure, mais les nations qui ne demeurent plus avec lui s'en vont et s'écoulent: et c'est ce qui causait la mélancolie de l'Eglise. Elle était Jérémie sur des ruines qu'elle ne prophétisait pas — une mère ferme les yeux devant l'avenir ! — mais qu'elle pressentait. Une page d'une tristesse touchante aidera à notre description de cette mélancolie, et nous dirons, après, pourquoi nous y insistons:
« La perte d'une nationalité est un des malheurs de la race humaine qui appelle le plus la sympathie. Il y a dans la patrie quelque chose de si sacré, que quand nous arrivons en lisant l'histoire à l'un de ces moments où Dieu, par un jugement impénétrable, retire la vie à une nation, nous sommes saisis pour cette patrie défaillante, déjà disparue dans le lointain des âges, d'un amour qui voudrait la ressusciter comme si c'était la nôtre. Nous désirons combattre avec ses défenseurs malheureux, nous envions le sort qui les coucha par terre, et cette gloire mélancolique que les peuples finis laissent sur leur tombe à leurs héros derniers. Les siècles ont passé; l’herbe a crû sur l'humble tertre de Philopœmen et d'Arminius; jamais la ligue Achéenne et les tribus de la Germanie ne s’éveilleront autour pour y pleurer encore une fois: mais Dieu, qui est grand dans sa justice, l'est aussi dans sa miséricorde, et il a fait du cœur de l'homme une immortelle patrie à tous ceux qui ont perdu la leur en demeurant par leur courage dignes d'en avoir une. C'est donc un spectacle à arroser de larmes que la fin d'un grand peuple; les vainqueurs mêmes n'y sont pas insensibles: Scipion pleura en voyant tomber Carthage enflammée, et comme on s'en étonnait, il répondit: Je songe au jour de Rome ! La religion tout habituée qu'elle est à voir mourir les nations comme les hommes, a aussi de secrets et tendres pleurs pour ces immenses infortunes qui attestent la caducité de tout (142)... »
Cette page est très touchante. Eh bien, de secrets et tendres pleurs tombaient des yeux de l'Eglise à la fin du XVIIIe siècle: car d'immenses infortunes se préparaient !
On nous pardonnera d'avoir insisté sur cette mélancolie de l’Eglise en songeant que c'est un fils d'Israël qui tient la plume. Admis dans la grande famille catholique, il comprend mieux que personne, par le sort de Jérusalem devenue ville morte, ce qu'il doit y avoir de crainte et de tristesse dans le cœur de l'Eglise par rapport à ses chères nations (143). Bossuet, rappelant le châtiment du peuple juif et l'avertissement que saint Paul en avait tiré pour les nations, a dit: « Qui ne tremblera en entendant les paroles de l'Apôtre (144) ? Pouvons-nous ne pas être épouvantés de la vengeance qui éclate depuis tant de siècles si terriblement sur les juifs, puisque saint Paul nous avertit de la part de Dieu que notre ingratitude nous attirera un pareil traitement (145) ? » Plût à Dieu que Bossuet, n'eût pas été contraint d'écrire, déjà de son temps: notre ingratitude nous attirera un pareil traitement !
C'en est fait, l'ère des ruines pour les nationalités et les patries va s'ouvrir. Au moyen du protestantisme, le génie du mal et des dévastations avait commencé la sinistre brèche: mais la France avait été longtemps le mur de résistance. Le mur, cette fois, va céder, et l'antique organisation des royaumes sera pulvérisée: Magna cadavera Nationum !
V
L'ouragan se déchaîne, c'est 1793.
« Alors, sur les débris de l'autel et du trône, sur les ossements du prêtre et du souverain, commença le règne de la force, le règne de la haine et de la terreur; effroyable accomplissement de cette prophétie: Un peuple entier se ruera, homme contre homme, voisin contre voisin, et, avec un grand tumulte, l’enfant se lèvera contre le vieillard, la populace contre les grands; parce qu'ils ont opposé leur langue et leurs inventions contre Dieu (146). » Pour peindre cette scène épouvantable de désordres et de forfaits, de dissolution et de carnage, cette orgie de doctrines, ce choc confus de tous les intérêts et de toutes les passions, ce mélange de proscriptions et de fêtes impures, ces cris de blasphème, ces chants sinistres, ce bruit sourd et continu du marteau qui démolit, de la hache qui frappe les victimes; ces détonations terribles et ces rugissements de joie, lugubre annonce d'un vaste massacre; ces cités veuves, ces rivières encombrées de cadavres, ces temples et ces villes en cendre, et le meurtre, et la volupté, et les pleurs, et le sang; il faudrait emprunter à l'enfer sa langue, comme quelques monstres lui empruntèrent ses fureurs. « Si le monde, avait dit Voltaire, était gouverné par des athées, il vaudrait autant être sous l'empire immédiat de ces êtres infernaux qu'on nous peint acharnés contre leurs victimes. » Des athées gouvernèrent la France, et, dans l'espace de quelques mois, ils y accumulèrent plus de ruines qu'une armée de Tartares n'en aurait pu laisser en Europe pendant dix années d'invasion. Jamais, depuis l'origine du monde, une telle puissance de destruction n'avait été donnée à l'homme (147). »
Tout cela ne fut que le premier acte du drame de la Révolution, mais quel premier acte, grand Dieu ! Il donnait clairement à entendre que la chrétienne organisation des nations avait pris fin. C'était un tonnerre d'orgueil qui annonçait, non à la manière d'un Isaïe: cieux nouveaux, terre nouvelle, mais terre nouvelle sans cieux. Et pour qu'on ne se méprît pas sur le sens du programme révolutionnaire, il s'y trouva intercalé, mêlé aux ruines, un fait sans précédent: l'introduction des juifs dans la législation et la société, alors que le Christ en était éliminé. Du même coup les Droits de l'homme ont fait entrer des ennemis, et congédié l'Ami qui aime les Francs.
Tout cela, encore une fois, n'était que le premier acte, la première partie du programme, et déjà il faut logiquement en déduire la préparation de la prépondérance juive. Nous l'avons largement exposé au cours de cet ouvrage. Mais nous demandons au lecteur la permission de le lui rappeler dans un raisonnement rapide et saisissant, pour servir de liaison avec ce qui doit suivre.
Voici un principe indéniable, et admirablement formulé:
« Le Christianisme est la loi même de la vie:
« Nulle société n'a péri, nulle race royale ne s'est éteinte, nulle puissance n'a passé que pour avoir violé la loi de la vie contenue dans le christianisme.
« Comme aussi nulle société ne s'est fondée, nulle race royale n'a fleuri, nulle puissance n'a persévéré que par l'observation de la loi de la vie contenue dans le christianisme. »
Les nations chrétiennes, en prenant naissance et en se développant avec ce luxe d'épanouissement qui a été le leur pendant quinze siècles, avaient obéi à cette loi de la vie contenue dans le christianisme. Aussi prévalaient-elles sur le peuple juif, de toute la distance qu'il y a entre la grâce unie à la nature et la nature laissée à ses propres forces, entre le secours divin soutenant l'effort humain et l'effort humain agissant solitairement. Les nations chrétiennes présentaient l'incomparable spectacle de la grâce unie à la nature, du secours divin soutenant l'effort humain. Les juifs, eux au contraire, étaient la nature laborieuse, mais solitaire, l'effort humain orgueilleusement seul. Aussi les nations l'emportaient-elles de mille coudées sur le peuple juif: elles étaient splendides, lui était chétif à côté d'elles.
Mais du jour où les nations ont superbement rejeté le christianisme, les choses ont dû changer de face.
Rejeter le christianisme, c'était, pour elles, violer la loi de la vie qui les avait faites ce qu'elles étaient, c'était se passer du secours de Dieu et se flatter néanmoins de pouvoir vivre et avoir abondance de vie par les seules forces de la nature, comme faisaient les juifs. Eh bien, les nations se sont sottement méprises. Oui, avec l'aide du christianisme, elles ont été de beaucoup supérieures au peuple juif. Abstraction faite du christianisme, elles s'exposaient à lui être inférieures.
En effet, dès lors que la lutte et la concurrence vont s'établir au point de vue des seules forces de la nature, les nations lutteront difficilement avec le peuple juif. Il est autrement organisé, pour vaincre, que chacune d'elles. Comment ! voilà une race qui, sortie des flancs robustes d'Abraham, traverse l'ensemble des siècles, défiant tous les climats, apte à tous les emplois, habile à toutes les ruses, rompue à tous les expédients, indomptable, unie dans tous ses membres, indestructible: une race que vous, nations, malgré l'immense supériorité qui vous venait de la foi chrétienne, avez dû refouler sans cesse pour l'empêcher de monter, que vous avez dû entourer de mille entraves pour l'empêcher de s'échapper et de vous dominer; et voilà qu'au moment où, dans votre délire de 1789, vous accordez toute liberté à cette race, vous vous débarrassez vous-mêmes de votre égide, vous rejetez la foi chrétienne ! Mille fois folie, aveuglement, sottise !
Aussi, ce sera pitié de voir la belle France devenir languissante, la fière Allemagne se ruiner, la riante Italie se flétrir, la froide Angleterre se livrer à l'inquiétude, en face des fils de la race juive qui relèveront partout la tête et monteront !... Nations, pourquoi avez-vous cessé d'être chrétiennes ? Ce sont moins les juifs qu'il faudra accuser que vous-mêmes: ils n'ont pas changé, mais vous-mêmes avez changé: vous vous êtes abaissées et livrées à eux. Pourquoi avez-vous proclamé que la Vérité chrétienne n'aurait plus de privilèges, plus de droits ? Vous avez, de vos mains, fait tomber vos palissades, et les juifs sont entrés pour vous conquérir.
A ces redoutables et lamentables prémisses fut employée la fin du siècle dernier. Pour un laps de onze années, beaucoup de méchante besogne avait été faite.
Mais la Révolution a une seconde étape à parcourir, un second acte de son drame à jouer. Après avoir congédié le Christ, il reste à congédier son Eglise. Après avoir déposé le roi, il s'agit de détruire et de déraciner le royaume. Ce sera plus long. La Révolution lègue donc au siècle suivant cette seconde partie du programme à remplir: le royaume de Dieu sans les royaumes de la terre, et les royaumes de la terre sans le royaume de Dieu. De la séparation devra résulter la ruine réciproque. Aussi bien, le programme des Loges l'annonce: employer tous les moyens pour isoler l'Eglise, employer tous les moyens pour isoler les royaumes, et les détruire dans leur isolement respectif. Les manuels maçonniques étaient, avec les éclats de rire de Voltaire, les espérances de cette double destruction. Vont-elles se réaliser ?
Le royaume de Dieu ira toujours son chemin. Il bénit la coopération des royaumes, ses auxiliaires, mais il peut s'en passer. Quel que soit dans l'avenir le mode d'être des Etats et des peuples, ce mode d'être trouvera l'Eglise secourable, mais indépendante et confiante en ses propres destinées immortelles. Habituée aux défections, elle est sûre aussi des compensations. Sa catholicité majestueuse ressemble aux fleuves géants, ces chemins qui marchent, comme les appelle Pascal, ces puissants travailleurs qui entraînent dans leur courant des masses énormes de terrain, des pans de forêts tout entiers avec leurs draperies de lianes verdoyantes et leurs arbres séculaires: arrivés à leurs embouchures, ils y forment ces fameux deltas, ces prolongements inattendus de territoire, où ensuite des villes entières se sont bâties comme par enchantement. Le royaume de Dieu, pareillement et mieux encore, dévorant comme ces géants des eaux par la parole de ses missionnaires, les sueurs de ses ouvriers de toutes sortes et le sang de ses martyrs, le royaume de Dieu, ce travailleur infatigable, entraîne, emporte les peuples et les races: il arracherait des continents plutôt que de manquer à sa catholicité ! Il ira donc toujours son chemin, que la Révolution le veuille ou ne le veuille pas, que les royaumes de la terre demeurent ses affluents ou s'isolent de lui.
Semblable sécurité d'avenir n'attend pas les royaumes de la terre isolés du royaume de Dieu.
Reprenons à leur égard la comparaison de l'enchâssure:
Désenchâssés du royaume de Dieu, que peuvent-ils devenir ? Hélas ! ce que deviennent les pierres désenchâssées d'un diadème. Perles, rubis, diamants, tombent dans le domaine du vulgaire. Elles s'égarent, elles circulent sans honneur public; on finit par perdre leur trace.
Ne sera-ce pas le sort des royaumes et des princes ? Les uns deviendront errants avec quelque éclat, les autres disparaîtront. Là encore, par une sorte de dérision, reparaîtront les juifs. Grands acquéreurs de pierres précieuses dans le passé, ils se préparent à l'être, de domaines royaux, dans l’avenir.
CHAPITRE III DÉSORGANISATION DES NATIONS PAR NAPOLÉON PREPARATOIRE A LA PRÉPONDÉRANCE JUIVE
I. Le Chariot de la gloire de Dieu dans la Bible et le char de gloire monté par l'Empereur. Contradiction entre le puissant organisateur et son œuvre de désorganisation: comment elle s'explique. — II. Le Concordat donné à la France, mais la religion vassale: désorganisation religieuse. — III. L'ambition d'être un nouveau Charlemagne au milieu des nations latines, mais la convoitise babylonienne; le duel avec l'Angleterre, mais le blocus continental, le pêlemêle des peuples et de leurs intérêts: désorganisation politique. — IV La promulgation tutélaire du Code Napoléon, mais l'émiettement des fortunes et des familles: désorganisation domestique et sociale. — V. La personne humaine couverte de gloire, mais elle est traitée comme un moyen, et entraînée dans la passion effrénée de parvenir : désorganisation morale.
— VI. Or, religion vassale, pêle-mêle des peuples, émiettement des fortunes, passion effrénée de parvenir, favoriseront l'avènement de la prépondérance juive.
I
Napoléon est l'homme qui va faire voler en éclats l'ancienne enchâssure.
La Révolution a deviné ce génie et son faible, qui est la passion de la gloire. Profitant de lui comme il profitera d'elle maîtresse et esclave, elle entreprend d'exploiter cette passion. Ce n'est plus seulement avec des flots de sang, comme en 93 qu'elle va continuer son œuvre: elle leur joindra des flots de gloire.
Napoléon, à son tour, s'empare des forces vives de la Révolution, qui, lasses de bouillonner au fond de leur cratère et de retomber sur elles-mêmes, cherchaient précisément à se répandre au-dehors et débordaient vers la conquête.
Quel va être leur mutuel objectif ? A elle, faire le tour du monde; à lui, reculer les limites de la gloire. Les deux buts, les deux enthousiasmes se confondront souvent.
Lorsqu'on cherche dans la Bible quelque chose qui aide à expliquer le passage de ce brillant et sanglant météore, on trouve le « chariot de la gloire de Dieu ». On dirait que la Révolution, usurpatrice de la souveraineté divine, se soit appliquée à fournir à celui de ses fils qui promettait de lui rendre les plus éclatants services, un char semblable à celui qui est resté célèbre dans les fastes bibliques. Le prophète en fait cette description:
Il y avait une personne sous la figure d'un homme, au milieu d'un grand éclat, assise sur un trône de saphir, qui lui-même reposait sur une voûte semblable au firmament. Cette voûte était portée par quatre animaux extraordinaires, à coté desquels se mouvaient quatre roues. Ils ressemblaient, par leur ardeur, à des charbons de feu brûlants. Ils allaient et revenaient comme la foudre étincelante. Ils avaient des ailes et, pour que leur impétuosité fut mieux servie, leurs pieds étaient ainsi faits qu'à un ordre donné ils n'avaient nul besoin de se tourner, mais partaient avec rapidité droit devant eux, dans n'importe quelle direction. Les quatre roues étaient pleines d'yeux. Animaux et roues, lorsqu'ils marchaient, produisaient un bruit comme le bruit d'une grande armée, le bruit d'un camp.
Ainsi était fait le chariot de la gloire de Dieu, contemplé par le prophète (148).
La Révolution a inspiré à son César de monter sur un char pareil:
Sur le char de sa gloire, Napoléon est seul; il ne tolère aucune figure à côté de la sienne. Il tient le tonnerre. Ses armées le portent, avec des mouvements rapides, au cœur et aux confins de tous les royaumes. Il sillonne l'Europe. Ses yeux sont partout. Aucune affaire n'échappe aux éclairs de son génie; aucun peuple ne peut se dérober au broiement des roues, s'il résiste, à l'éclat de son triomphe, s'il se soumet.
Char d'orgueil, où espères-tu aboutir ?
Ce César, qui tient de l'ouragan, présente un contraste étrange: il est l'homme de l'ordre, et son œuvre est le désordre; il est le puissant organisateur, et le résultat est la désorganisation. « Après avoir assiégé les forts de Cadix, après avoir eu dans ses mains les clefs de Lisbonne et de Madrid, de Vienne et de Berlin, de Naples et de Rome, après avoir fait trembler les pavés de Moscou sous le roulement de ses canons, il laissera la France moins grande qu'il ne l'a prise, toute saignante de ses blessures, démantelée, ouverte appauvrie et humiliée (149). »
L'explication de cette antithèse, qui s'accuse d'un bout à l'autre de l'œuvre impériale, est bien simple:
Lui est l'ordre, sous la forme d'Empire, mais la Révolution, sa coopératrice, est le désordre. Il est architecte, mais elle nivelle. Il est l'épée, mais elle est le marteau. Il est conquérant, mais elle est cyclone. Il a un but, mais elle le lui fait dépasser.
Et ce n'est pas seulement au dehors, dans les entreprises impériales, que l'opposition est éclatante: l'Empereur la porte au dedans, lui-même est un champ de bataille. La Révolution, qui lui fait respirer constamment son souffle, annule les affirmations de l'Empereur qui, à son tour, voudrait refouler les négations de la Révolution. Il se sent les qualités d'un fondateur, et elle lui donne les gestes d'un destructeur. Ses défauts sont grandis par elle, jusqu'à l'extrême: c'est qu'elle est une sève diabolique qui fait éclore et déborder tous les défauts.
Malheur au génie qui s'est greffé sur elle ! Elle dégrade Napoléon. Elle ne lui permet pas de rester déiste, il devient persécuteur. Il est né lion, elle en fait un tigre dans les fossés de Vincennes. Elle l'entraîne toujours plus loin que son but.
Aussi, nonobstant la puissance de son génie et de son bras appliqués à la direction du char de gloire, il ne sera pas maître des coursiers. C'est qu'à l'attelage il y a ces coursiers noirs dont parlait Platon, les passions ! De ces coursiers noirs, auxquels la Révolution a ôté le mors, nul n'a jamais été maître. Ils emportent l'Empereur et le char de gloire sur toutes les routes de l'Europe et dans toutes les affaires du monde, et aussi à travers tous les excès.
Les peuples ont vu passer ce char de gloire et d'orgueil, avec admiration et terreur.
Pénétré de ces deux sentiments, nous nous sommes baissé sur les traces de son passage, pour nous rendre bien compte des sillons creusés et du but atteint. Organisation apparente et désorganisation profonde, voilà ce qu'on y découvre; et le long des brillantes ornières marchent les fils d'Israël attentifs à profiter de la désorganisation.
Baissons-nous semble, cher lecteur: l'étude en vaut la peine.
II
Lorsque Bonaparte, premier consul, comprit la nécessité d'en finir avec le désordre, et jugea qu'il fallait relever la religion et, pour cela, restaurer le catholicisme, antique croyance de la France, à laquelle appartenait encore la majorité de la nation, il dut lutter contre une infinité de préjugés révolutionnaires; il lutta, et jamais son génie ne l'inspira mieux. Il avait une faculté merveilleuse, celle de concevoir le grandiose, de le saisir, et de déterminer la mesure possible de sa réalisation. C'était même là le secret de la fascination extraordinaire qu'il exerçait. Son esprit mobile et ardent se passionna donc pour la restauration du catholicisme avec une sincérité passagère peut-être, mais courageuse au moment de sa manifestation.
Le Concordat fut le résultat de cette sincérité.
Ce fut le jour de Pâques, 18 avril 1802, que Paris et la France apprirent cette sorte de résurrection. Laissons parler l'historien de ce grand moment:
« Le matin de Pâques, le Concordat fut publié dans tous les quartiers de Paris, avec grand appareil, et par les principales autorités. Tandis que cette publication se faisait dans les rues de la capitale, le Premier Consul, qui voulait solenniser dans la même journée tout ce qu'il y avait d'heureux pour la France, échangeait aux Tuileries les ratifications du traité d'Amiens. Cette importante formalité accomplie, il partit pour Notre-Dame, suivi des premiers corps de l'Etat et d'un grand nombre de fonctionnaires de tout ordre, d'un brillant état-major, d'une foule de femmes du plus haut rang. Une longue suite de voitures composait ce magnifique cortège. Les troupes de la première division militaire, réunies à Paris, bordaient la haie depuis les Tuileries jusqu'à la métropole. L'archevêque de Paris vint processionnellement recevoir le Premier Consul à la porte de l'église, et lui présenter l'eau bénite. Le nouveau chef de l'Etat fut conduit sous le dais, à la place qui lui était réservée. Le Sénat, le Corps législatif, le Tribunat étaient rangés des deux côtés de l'autel. Derrière le Premier Consul se trouvaient, debout, les généraux en grand uniforme, plus obéissants que convertis, quelques-uns même affectant une contenance peu décente. Quant à lui, revêtu de l'habit rouge des Consuls, immobile, le visage sévère, il ne montrait ni la distraction des uns, ni le recueillement des autres. Il était calme, grave, dans l'attitude d'un chef d'Empire qui fait un grand acte de volonté, et qui commande de son regard la soumission à tout le monde.
« Pour compléter l'effet que le Premier Consul avait voulu produire, dans ce même jour, M. de Fontanes rendait compte, dans le Moniteur, d'un livre nouveau qui faisait grand bruit en ce moment: le Génie du Christianisme (150).» Un ouvrage littéraire a rarement le bonheur d'une telle mise en scène C'est qu'entre les deux œuvres il y eut vraiment une connexion providentielle: à cette époque de haines demeurées sourdes contre la religion, le Concordat fut un acte courageux en politique, et le Génie du Christianisme, un acte non moins courageux en littérature.
On a rapproché également le Concordat de Napoléon du célèbre édit de Milan, par lequel Constantin mit fin au régime de persécution et donna la paix à l'Eglise. Là, le rapprochement est moins heureux qu'avec le Génie du Christianisme. En effet:
Dans des circonstances plus difficiles encore, avec une opposition plus redoutable, Constantin fut à la fois plus courageux et plus juste que Bonaparte. Au lieu de consacrer la spoliation, le premier empereur chrétien fit restituer à l'Eglise tous ses biens confisqués et lui assura en même temps la liberté la plus entière et la plus complète. Le Concordat, au contraire, sanctionnait la confiscation des biens ecclésiastiques et posait le principe de la restriction de la liberté de l'Eglise. Avec Constantin, ce fut le christianisme qui arriva à la vie, à l'épanouissement, dans une société nouvelle que sa vertu fit sortir du vieux monde païen; avec Bonaparte, c'était l'Eglise obligée d'accepter un compromis pour vivre au milieu du monde troublé plutôt que nouveau, de la Révolution.
La différence est donc grande entre l'édit de 313 et le traité de 1801. Néanmoins le Concordat accepté par le Saint Siège permettait à l'Eglise de vivre, de se défendre, de se perpétuer, et l'Eglise en a toujours été reconnaissante.
Hélas ! pourquoi faut-il que la sincérité de Bonaparte éclatant avec l’alléluia du jour de Pâques, n'ait duré que jusqu'au dimanche in albis, jour où les nouveaux catéchumènes déposaient leur habit blanc ? Dépouillement de la sincérité, où entraînes-tu Bonaparte ? A rien moins qu'à prendre les moyens de faire de l'Eglise une vassale. Dans le plan encore en ébauche, d'un empire universel, la religion aura place d'honneur: mais non la première, ni égale à celle de l'Empereur, ni même indépendante. Napoléon ne songe pas à diminuer l'éclat du royaume de Dieu, encore moins à le supprimer, mais il entend l'enclaver dans l'éclat de son Empire à lui. « Que l'Eglise soit grande, pense-t-il, mais pas au-dessus de moi, ni même à côté de moi ! » Une Eglise vassale, voilà le rêve, le plan. Il s'ensuit que presque au lendemain de Pâques, l'homme secourable en Napoléon fut supplanté par le despote.
A l'audacieuse entreprise de vassalité se réfèrent ces étapes rapides dans la voie de l'impiété et de l'outrage:
Les tentatives de falsification des articles du Concordat;
L'adjonction subreptice des articles organiques;
La tyrannie de l'Empereur exigeant que la Papauté ait les mêmes amis et les mêmes ennemis que la France;
Ses démêlés avec Pie VII, véritable acharnement de l'aigle contre la colombe;
Enfin l'enlèvement du Pape par le colonel de gendarmerie Radet, son internement à Savone, puis à Fontainebleau. Mais, avant de quitter le Quirinal, la colombe outragée en avait appelé au Dieu Tout-Puissant contre l'aigle ravisseur, et l'excommunication était tombée sur le front qui avait reçu le sacre.
Quel contraste avec le beau dimanche de Pâques où le Concordat fut promulgué !
Conséquences, dans la suite:
Attendu que les fautes des souverains ne demeurent pas solitaires et que les peuples y boivent comme à une coupe de famille, la France et les nations désapprendront le respect du Pape et de la religion. Par les articles organiques, le clergé deviendra, bon gré mal gré, partie du fonctionnarisme d'Etat et n'aura plus la même indépendance. Par les outrages envers le Souverain Pontife, on a enseigné à oublier en lui le représentant du Christ, pour ne considérer qu'un roseau de roi qu'il faut faire plier. Par l'entrée d'un colonel de gendarmerie dans les appartements du Pape, la brèche est ouverte à tous les brigandages contre la Papauté. La foi des peuples a reçu une atteinte profonde, et la désorganisation religieuse, quoique lente dans son cours, où se reflétera longtemps un simulacre d'organisation, paraît irrémédiable, si Dieu n'intervient.
III
Une autre désorganisation, mais celle-là, menée rondement, au pas de charge, allait s'appeler: barrières arrachées, villes saccagées, peuples broyés, royaumes amalgamés.
Par une sorte d'ironie, que nous avons déjà signalée comme familière à la Révolution qui aime les contrastes, cette désorganisation violente se rattachera au plus noble et vaste projet d'organisation qui ait été conçu depuis bien longtemps: Napoléon veut refaire, au milieu des peuples de race latine, l'œuvre de Charlemagne.
L'Empereur a, lui-même, exposé plus tard, à Sainte-Hélène. sa noble ambition, son rêve.
« Une de mes plus grandes pensées avait été l'agglomération, la concentration des mêmes peuples géographiques, qu'ont dissous, morcelés, les révolutions et la politique. Ainsi l'on compte en Europe, bien qu'épars, plus de trente millions de Français, quinze millions d'Espagnols, quinze millions d'Italiens, trente millions d'Allemands. J'eusse voulu faire de ces divers peuples un seul et même corps de nation. C'est avec un tel cortège qu'il eût été beau de s'avancer dans la postérité et la bénédiction des siècles ! Je me sentais digne de cette gloire (151). »
Lorsque, puissant organisateur, il entreprend cette œuvre de concentration, il n'hésite pas à dire qui il est; il écrit au cardinal Fesch, son négociateur à Rome: Dites-leur que je suis Charlemagne, leur Empereur, que je dois être traité de même.
Il a souvent répété cette parole-ci: Le grand système que la Providence Nous a destiné à fonder... Le souvenir de Charlemagne le poursuivait. Aux oreilles de leur empereur passant au galop devant leur front de bataille, les soldats d'Austerlitz et d'Iéna faisaient arriver le nom d'Empereur d'Occident.
Il est équitable de comprendre, dans l'œuvre un instant radieuse du nouveau Charlemagne, sa lutte contre l'Angleterre considérée dans son exode légitime et libérateur. L'Angleterre avait toujours été l'âme et le nœud des ligues et des discordes sur le continent. Napoléon regarda en face l'adversaire de toute félicité publique, et un duel immense devint son idée fixe. La lutte gigantesque durera douze ans: lutte à décharge dans le procès fait à l'Empereur. Si la France a bien des reproches à lui faire, il est une chose qu'elle ne doit jamais oublier: c'est qu'il s'est mesuré en géant avec la Grande-Bretagne, et que, de ses bras nerveux, de ses muscles de lion, il a voulu la clouer morte sur son île, pour assurer à sa chère France la première place incontestée, à côté de sa propre gloire.
A cette fin, tant qu'il se tient dans la voie de la raison ou dans l'idéal chevaleresque, il prend des moyens audacieux peut-être, mais loyaux. Il signifie qu'il veut faire de la Méditerranée un lac français, il réclame l'Egypte, il songe à coloniser la fertile vallée du Nil. L'Angleterre est menacée aux Indes. Jusque-là, tout est légitime, de bonne guerre.
Qu'est-ce donc qui détermine et amène la déviation ? Qu'est-ce qui produit l'écart, tant dans la reconstruction de l'empire de Charlemagne que dans la lutte contre l'Angleterre ? Toujours le malheureux emportement révolutionnaire: et l'écart est tel, que non seulement l'honneur, la morale mais la simple justice et la saine politique sont lacérées et comme foulées aux pieds des chevaux.
Déviation dans l'œuvre reprise de Charlemagne:
A sa place, c'est la convoitise babylonienne qui apparaît. Elle est célèbre, cette convoitise ! « Nabuchodonosor, roi des Assyriens, ayant défait dans une grande bataille son puissant voisin le roi des Mèdes, sentit son cœur s'élever en lui-même. Il convoqua donc ses conseillers et ses généraux et tint dans son palais ce que l'Ecriture a si bien nommé le mystère de son conseil: habuit cum eis mysterium consilii sui. — Quel était le mystère de ce conseil ? Un projet d'orgueil autant que d'ineptie: Il leur dit que sa pensée était d'assujettir à son empire toute la terre (152). » Jamais, peut-être, depuis le cabinet de Babylone, pareille convoitise n'a reparu plus âpre, plus effrénée que dans le cerveau du soldat couronné de la Révolution, à l'heure des emportements de son orgueil. Une idée fixe s'empare de lui, celle de faire la loi à l'Europe pour lui imposer sa dynastie (153); et il ne croit y parvenir (il le dit en propres termes) qu'en étonnant le monde et en reculant pour les Français les limites de la gloire. M. de Metternich écrira, de lui, à l'empereur d'Autriche, son maître: « L'aspiration à la domination universelle est dans sa nature même; elle peut être modifiée, contenue; mais on ne parviendra jamais à l'étouffer. » — « Mon appréciation sur le fond des projets et des plans de Napoléon n'a jamais varié. Ce but monstrueux, qui consiste dans l'asservissement du continent sous la domination d'un seul, a été, est encore le sien (154). » But monstrueux ! le mot est juste. A quoi sert d'être le plus grand homme de guerre, si l'on n'est qu'un grand homme de proie ? L'œuvre reprise de Charlemagne n'est plus qu'un plagiat funèbre.
Déviation, forcément, de la lutte contre l'Angleterre: Elle se traduit par le blocus continental. « Il a fermé aux Anglais tous les ports de son empire: cela le conduit à leur fermer tous les ports du continent, à instituer contre eux une croisade européenne, à ne pas souffrir des souverains neutres comme le pape, des subalternes tièdes comme son frère Louis, des collaborateurs douteux ou insuffisants comme les Bragances de Portugal et les Bourbons d'Espagne, partant, à s'emparer du Portugal et de l'Espagne, des Etats pontificaux et de la Hollande, puis des villes hanséatiques et du duché d'Oldenbourg, à allonger sur le littoral entier, depuis les bouches de Cattaro et Trieste jusqu'à Hambourg et Dantzig son cordon de commandants militaires, de préfets et de douaniers, sorte de lacet qu'il serre tous les jours davantage, jusqu'à étrangler chez lui, non seulement le consommateur mais encore le producteur et le marchand (155). »
Et ainsi,
Son but: la dictature universelle (156);
Son prétexte: la ruine de l'Angleterre (157);
Son moyen: subjuguer le continent pour le coaliser contre l'Angleterre (158);
Telles s'accusèrent les grandes lignes de sa politique, mais aux tracés rouges de sang. C'était organiser l'Empire pour la guerre éternelle (159).
Alors s'étendit, dans l'espace comme dans la durée, cette lutte désorganisatrice où les barrières des peuples furent arrachées, les limites naturelles, méprisées, les territoires neutres, violés, le droit des gens, foulé aux pieds, les monarques, déposés, les dynasties, retranchées, les petits Etats, supprimés, les grands royaumes, disloqués, les nationalités, mises en pièces: pêle-mêle de tout, des peuples, des frontières, des religions, des langues et des mœurs. L'Europe ? comme un homme blême après une grande perte de sang, changea de face et se prit à chanceler. La crise des Nations était ouverte. Parmi les atroces champs de bataille, l'un d'eux à Leipzig, reçut un nom significatif: la bataille des Nations.
Le Moyen Age a eu une tradition bizarre: la danse des morts;
C'était un grand bal présidé par la Mort, et auquel assistaient toutes les conditions et tous les âges de la vie humaine. La Mort disait au Pape: « C'est à toi d'ouvrir la danse; la tiare ne peut te dispenser de ce pas-là. » —Elle disait à l’Impératrice: « Vos courtisans ont fui, aucun ne s'approche pour vous présenter la main, acceptez la mienne, et dansons ensemble. » — Elle disait à l'Ermite: « Bon ermite, où allez-vous si tard hors de votre cellule la lanterne à la main ? Vous n'irez pas plus loin, j'éteins votre lumière ! » — Elle disait au Jeune homme: « Halte-là, mon garçon ! Où vas-tu si lestement ? Rire, chanter, danser, courtiser les belles Arrête-toi ! » Et ainsi, des autres âges et des divers états.
Ne serait-on pas dans le vrai en décrivant, au milieu des temps modernes, une danse des morts pour les Nations ? Il suffirait d'aligner, pour ce bal funèbre, les arrêts et les coups du terrible Empereur contre les nationalités et les dynasties coups et arrêts comme ceux-ci:
A propos de la république de Gênes, il écrit: « Je n’ai réuni Gènes que pour avoir des matelots. La seule réponse à son mécontentement, c'est: des matelots ! des matelots ! »
Il s'annonce ainsi à Venise: « Je serai un autre Attila pour Venise ! » et la reine de l'Adriatique est dépouillée et ruinée pour toujours.
Il décrète: « Les Bourbons de Naples ont cessé de régner ! »
Mêmes décrets funèbres atteignent la maison de Hesse, la maison de Bragance.
Il dit à une députation de Portugais: « Je ne sais pas encore ce que je ferai de vous, cela dépendra des événements. »
Il détrône la famille royale d'Espagne et dit au peuple espagnol: « Votre monarchie est vieille, ma mission est de la rajeunir. » L'Espagne se lève, et Lannes envoyé pour la réduire est contraint d'écrire: « C'est une guerre qui fait horreur. »
Comme la Mort qui est implacable, Napoléon ne recule jamais. Poursuivant son but à outrance, il aimera mieux tout perdre que rien céder.
En vérité, la gigantesque épopée napoléonienne est bien l'ouverture de la danse des morts pour les nations, danse macabre: étendards tricolores flottant au vent des batailles, mamelucks, cuirassiers, carabiniers, lanciers, artilleurs, grenadiers farouches, fantassins héroïques, traversant les rouges fusillades, tandis que les sabres sonnaient sur les casques et qu'à travers la fumée de la poudre brillaient comme des éclairs les noms d'Arcole, Iéna, Austerlitz, la Moskowa ! De 1795 à 1815, l'Europe a eu son bal de la Mort. La Révolution, qui inspire la danse, aura soin de l'entretenir...
A la désorganisation religieuse s'est ajoutée la désorganisation politique.
IV
Une autre, plus profonde peut-être parce qu'elle est sociale, va encore s'inaugurer: la désorganisation qui se rattache au Code Napoléon.
Elle commence, elle aussi, par des apparences organisatrices et salutaires. A l'ombre du Code Napoléon, la société va s'asseoir entre un térébinthe et un mancenillier.
Ce code a d'abord l'aspect d'un térébinthe, ce bel arbre de l'Orient qui étend de tous côtés ses branches hospitalières et auquel la Bible emprunte le symbole de l'honneur et de la fécondité; comme le térébinthe, mes branches sont des branches d'honneur et de grâce (159) ! Le Code Napoléon, en effet, réalisant pour la France l'unité de législation préparée et désirée depuis des siècles, se présentait comme un chef d'œuvre de justice et de simplicité. En outre, la famille et la propriété, ébranlées par la Convention, y retrouvaient en grande partie leur vie; et l'égalité civile y demeurait consacrée comme le caractère distinctif de la nouvelle société. Les autres nations l'envièrent à la France, affirment les historiens et les dictionnaires (160).
Bonaparte avait pris à ce travail une part personnelle double, par sa volonté qui était puissante et qui en hâta l'achèvement, puis par sa présence à quelques discussions auxquelles il se mêla, et où il donna ses décisions avec sa promptitude de conception, sa pénétration surprenante, sa parole toujours originale (161).
Voilà l'aspect du térébinthe dans ce code célèbre; mais, voici d'autre part, celui du mancenillier:
La famille va être énervée par le divorce;
Napoléon se montra cruel envers la femme, et il admit contre elle le divorce; il disait que le maire prononçait toujours d'une voix trop basse ces paroles de la loi: La femme doit obéissance au mari, et il aurait voulu les accompagner de formes plus solennelles. Son but était d'introduire dans la famille la même discipline que dans l'armée, résumant tout, là comme ailleurs, dans ce mot: Obéissez. Aveuglement étrange, ô César ! le divorce n'est-il pas lui-même une désobéissance à l'Evangile ? La famille est atteinte au cœur.
Elle va l'être également dans ses membres et dans son foyer, par la loi des successions;
Le Code interdit la faculté de conserver le bien;
Conséquences:
La liquidation des héritages résultant du partage forcé des successions détruira fatalement la petite propriété, les petits ateliers; les vieilles races de paysans disparaîtront du sol; les ouvriers des villes seront condamnés à toutes les misères morales et physiques de la vie nomade. Dans les classes supérieures aussi, le culte et l'éducation du foyer, l'esprit de tradition et de respect s'en iront, laissant un vide immense dans l'aspect décoloré de la société française.
En outre, le régime du partage forcé produira la stérilité des mariages, on limitera lâchement le nombre des naissances, et la statistique élèvera la marche croissante de la dépopulation à chaque recensement quinquennal.
Enfin le régime du partage forcé bouleversera et renversera les institutions qui exprimaient le mieux l'ordre et la liberté dissolvant les corporations et compromettant toutes les fondations religieuses.
Sous ces aspects de la loi des successions et du divorce le Code Napoléon est mauvais, c'est le mancenillier.
Il faut bien qu'il en soit ainsi pour que Pie VII, rentré dans ses Etats en 1814, ait fait afficher à Rome une proclamation où on lisait: Le Code Civil est aboli à jamais !
Les grandes nations de l'Europe, revenant sur leur premier sentiment, le repousseront et se défendront contre lui, comme on se défend contre un empoisonnement de l'air.
V
Désorganisées en religion, en politique, au foyer de la famille, dans la transmission des biens, la France, et, avec elle, l'Europe, vont traverser, par surcroît, la phase d'altération la plus triste: la désorganisation morale ou de la personne humaine.
Cette désorganisation, comme les précédentes, a un point de départ qui promettait mieux: l'amour de la gloire.
L'amour de la gloire, renfermé dans les bornes de la sagesse et de la modération, n'a rien que d'honnête et de légitime; et la religion même l'avoue et le consacre. C'est la passion des belles âmes, qui estiment assez leurs semblables, pour ambitionner de mériter leur attention et leur suffrage par l'éclat de leurs talents ou de leurs vertus.
Sous Napoléon, la personne humaine est couverte de gloire.
La Révolution française avait conféré à l'homme le droit civil de parvenir: Napoléon lui apprend à en user et à faire son chemin. « Une force nouvelle extraordinaire vient de s'introduire dans l'histoire: c'est une force spirituelle, analogue à celle qui jadis a soulevé les âmes en Espagne au XVIe siècle, en Europe au temps des croisades, en Arabie sous Mahomet. Elle surexcite les facultés, elle décuple les énergies, elle transporte l'homme au-delà ou à côté de lui-même, elle fait des enthousiastes et des héros, des aveugles et des fous par suite, des conquérants, des dominateurs irrésistibles; elle marque son empreinte et grave son mémorial en caractères ineffaçables sur les hommes et sur les choses, de Cadix à Moscou. Toutes les barrières naturelles sont renversées, toutes les limites ordinaires sont dépassées.
Les soldats français. écrit un officier prussien après Iéna, sont petits, chétifs; un seul de nos Allemands en battrait quatre. Mais ils deviennent au feu des êtres surnaturels: ils sont emportés par une ardeur inexprimable, dont on ne voit aucune trace chez nos soldats (162)...
Quelle est cette force nouvelle, extraordinaire, qui décuplait ainsi l'énergie française ? La passion de parvenir, éveillée en 1789, et devenue, avec Napoléon, la passion de la gloire. Sur les pas d'un tel chef, elle enfantait, comme le dit l'officier prussien, des êtres surnaturels. Ils sont célèbres, du reste, les mots dont Bonaparte avait le secret pour passionner, pour entraîner;
Aux troupes qui reculaient sur le pont d'Arcole:
En avant ! suivez votre général !
A un grenadier blessé qui craignait de salir une belle selle toute brodée du général en chef:
Va, il n'y a rien de trop beau pour un brave !
A l'armée de Marengo:
Soldats, souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille.
En voyant, le matin de la bataille de la Moskowa, le soleil se lever sans nuages:
C'est le soleil d'Austerlitz.
Au général Moreau, en lui offrant une paire de pistolets richement ornés:
J'ai voulu y faire graver le nom de toutes vos victoires, mais il ne s'est pas trouvé assez de place pour les contenir.
A un grenadier surpris par le sommeil et dont il montait la garde:
Après tant de fatigues, il est bien permis à un brave comme toi de s'endormir.
Mais ce n'est pas seulement dans les camps que la personne humaine grandissait, elle était dévorée de l'ambition de s'élever, dans toutes les conditions. « En ce temps-là, rapporte un contemporain, un garçon pharmacien, parmi ses drogues et bocaux, dans une arrière-boutique, se disait en pilant et en filtrant que, s'il faisait quelque grande découverte, il serait fait comte avec 50.000 livres de rente. En ce temps-là le commis surnuméraire qui, de sa belle écriture moulée inscrit des noms sur des parchemins, peut se figurer qu'un jour son propre nom viendra remplir un brevet de sénateur ou de ministre. En ce temps-là, le jeune caporal qui reçoit ses premiers galons, entend d'avance, en imagination les roulements de tambour, les sonneries de trompette, les salves d'artillerie qui le proclameront maréchal de l'Empire (163). »
Il y a donc justice à reconnaître que la personne humaine est emportée d'un beau mouvement à la suite de Napoléon. Mais alors, qu'est-ce qui est cause que cette envolée décroît rapidement, se change en chute et aboutit à un brisement moral ? Toujours le funeste excès révolutionnaire, compliqué, ici, de l'insuffisance des forces humaines livrées à elles-mêmes.
L'excès fut le malheur de Napoléon. L'Empereur avait dit: « Je reculerai pour les Français les limites de la gloire », il n'a que trop tenu parole. Il les a tellement reculées, que la personne humaine s'y est perdue avec ses sentiments moraux, comme s'est perdue la grande armée, avec tous ses équipages, dans les steppes de la Russie.
Et puis, outre l'excès, n'y a-t-il pas l'insuffisance des forces humaines, dont il fallait tenir compte ? Sans la religion, elles se fatiguent vite. La pauvre nature humaine a ses limites, auxquelles Napoléon ne pensait pas, quand il voulait reculer celles de la gloire. L'élan des forces humaines, avec les Croisades, avait duré deux siècles; avec Napoléon et l'Empire, il a duré vingt ans.
Sous la double influence de cet excès et de cette insuffisance s'est donc rapidement produite la désorganisation morale que voici :
Du côté de Napoléon, son ambition s'est rendue coupable d'un véritable crime: il a traité constamment la personne humaine comme un moyen, faisant litière de l'homme. Il est défendu, ô César, ce procédé ! Il n'y a que les choses privées d'intelligence dont on use comme de moyens, mais il n'est pas permis d'y ranger la personne. Un axiome en morale dit: Respecte la personnalité comme une fin, et n'en use jamais comme d'un moyen. Le dur Empereur a toujours voulu l'ignorer. Tout ce qui constitue l'homme dans son âme ou dans son corps devint moyen pour servir à son ambition, et fut traité comme tel:
Comme un moyen, ce feu sacré qui s'appelle l'enthousiasme. — Napoléon ne l'a pas proscrit, mais il a voulu tellement le diriger, qu'il a supprimé tous les grands efforts de l'âme au profit d'un seul: celui qui fait bien mourir les armes à la main;
Comme un moyen, quiconque approchait de lui. — On devenait un instrument de règne: « Ce terrible homme nous a tous subjugués; il tient toutes nos imaginations dans sa main qui est tantôt d'acier, tantôt de velours; mais on ne sait quelle sera celle du jour, et il n'y a pas moyen d'y échapper: elle ne lâche jamais ce qu'elle a une fois saisi (164); »
Comme des moyens, ses confidents et ses serviteurs. — « Nous ne nous apparaissions à nous-mêmes, en faisant uniquement la chose qui nous était ordonnée, que comme de vraies machines, à peu près pareilles, ou peu s'en faut, aux fauteuils élégants et dorés dont on venait d'orner les palais des Tuileries et de Saint-Cloud (165). »
Comme un moyen, les vices et les passions de la pauvre humanité. — « Il cultivait soigneusement chez les gens toutes les passions honteuses..., il aimait à apercevoir les côtés faibles pour s en emparer. Là où il ne voyait pas de vices, il encourageait les faiblesses, et, faute de mieux, il excitait la peur, afin de se trouver toujours et constamment le plus fort... Il regardait les hommes comme une vile monnaie ou comme des instruments (166); »
Comme un moyen, la pensée d'autrui. — « Ce qu'il craint le plus, c’est que, près ou loin de lui, on apporte ou l'on conserve seulement la faculté de juger. Sa pensée est une ornière de marbre de laquelle aucun esprit ne doit s'écarter (167); »
Comme un moyen, l'existence humaine. — Cela m'est égal, répond-il en apprenant la mort d'un dévoué serviteur, il ne m'était plus bon à rien. A un corps d'armée qui s'ébranle pour marcher au feu: Soldats, j'ai besoin de votre vie et vous me la devez (168);
Comme un moyen, la mort. — Il s'y prit de bonne heure: quatre cents blessés embarrassaient sa marche entre Jaffa et le Carmel; Bonaparte leur fit donner de l'opium. Desgenettes, médecin en chef de l'armée d'Egypte, consulté sur cette terrible question de l'opium, avait répondu qu'il donnait des soins pour guérir et non pour tuer (169). A l'autre extrémité de son règne, lorsque tous les vétérans ont péri, Napoléon n'ayant plus que des recrues, y supplée par un matériel immense; trois cent mille hommes traînent après eux quatorze cents canons: ces bouches à feu, auxquelles il donnait une mobilité prodigieuse, dévoraient dans les batailles une masse énorme de ce qu'il appelait chair à canon (170).
Voilà ce que Napoléon a fait de la personne humaine. Elle était le tas d'argile qui attend la main du potier. « S'il y a dans le tas quelques parties dures, le potier n'a qu'à les broyer; il lui suffira toujours de pétrir ferme (171) » L'Ecriture comparant Dieu à un potier, dit que, dans l'argile dont il fit l'homme, il souffla l'âme; le potier de la Révolution l'en a retirée.
Sous le manteau de gloire que Napoléon lui a jeté sur les épaules, la personne humaine a donc été amoindrie. Il faut reconnaître, toutefois, qu'elle s'y est prêtée.
En effet, dans le principe, au début de la Déclaration des droits, il y avait de l'idéal dans cette pensée: faire son chemin. Mais sous l'Empire, à partir de 1808, l'idéal a peu à peu disparu, et désormais ce qui va faire le fond des caractères en France et ailleurs, c'est la passion de parvenir, pour jouir. « Il ne s'agit plus que d'avancer vite, et par toutes les voies, belles ou laides. Sur cette pente, on glisse vite et bas; chacun songe à soi d'abord; l'individu se fait centre. Aussi bien, l'exemple est donné d'en haut. Est-ce pour la France ou pour lui-même que Napoléon travaille ? Tant d'entreprises démesurées, la conquête de l'Espagne, l'expédition de Russie, l'installation de ses frères et parents sur des trônes nouveaux, le dépècement et le remaniement continu de l’Europe, toutes ces guerres incessantes et de plus en plus lointaines, est-ce pour le bien public et le salut commun qu'il les accumule ? Lui aussi, que veut-il, sinon pousser toujours plus avant sa fortune ?
« Il est trop ambitionnaire », disent ses soldats eux-mêmes; pourtant ils le suivent jusqu'au bout. « Nous avons toujours marché avec lui », répondaient les vieux grenadiers qui traversaient la Pologne pour s'enfoncer dans la Russie, « nous ne pouvions pas l'abandonner cette fois-ci, le laisser aller seul ». Mais d'autres, qui le voient de plus près, les premiers après lui, font comme lui, et, si haut qu'ils soient montés, ils veulent monter encore plus haut, à tout le moins se pourvoir, tenir dans leurs mains quelque chose de solide. Masséna a amassé 40 millions, et Talleyrand 60: en cas d'écroulement politique, l'argent reste. Soult a tâché de se faire élire roi de Portugal, et Bernadotte trouve le moyen de se faire élire roi de Suède...
On connaît ces paroles du maréchal Marmont: « Tant qu'il a dit: Tout pour la France, je l'ai servi avec enthousiasme. Quand il a dit: La France et moi, je l'ai servi avec zèle. Quand il a dit: Moi et la France, je l'ai servi avec dévouement. Il n'y a que quand il a dit: Moi sans la France, que je me suis détaché de lui. »
« Bref, Napoléon a introduit dans la société nouvelle, comme moteur central, comme universel ressort, le besoin de parvenir, l'émulation effrénée, l'ambition sans scrupules, l’égoïsme tout cru, en premier lieu son propre égoïsme: est-il surprenant que ce ressort, tendu à l'excès, détraque, puis démolisse sa machine.
« Après lui, sous ses successeurs, le même mécanisme jouera de même, pour se casser de même, au bout d'une période plus ou moins longue (172) »
VI
C'était à Sainte-Hélène.
Dans un de ces délires qui ramenaient devant lui des espérances illuminées par les souvenirs, Napoléon s'écriait: « Les grandes et belles vérités de la Révolution française dureront à jamais, tant nous les avons entrelacées de lustre, de monuments, de prodiges ! Nous en avons lavé les premières souillures dans des flots de gloire. Elles seront immortelles. Sorties de la tribune, cimentées du sang des batailles, décorées des lauriers de la victoire, saluées des acclamations des peuples, sanctionnées par les traités, elles ne sauraient plus rétrograder. Elles vivent dans la Grande-Bretagne, elles éclairent l'Amérique, elles sont nationalisées en France. Voilà le trépied d'où jaillira la lumière du monde. »
Trépied menteur ! Napoléon ne l’eut-il pas frappé de son talon, et brisé, si, à sa lumière jaillissante, il eût aperçu dans l'avenir, comme résultat de ces batailles, de ces lauriers, de ces vérités, de ces traités, de ces flots de gloire: quoi donc ? la prépondérance juive.
Repassons une seconde fois par les brillantes ornières que le char de gloire a creusées, pour apercevoir les fils d'Israël, devenus citoyens, prêts à profiter de la désorganisation.
A. — LA RELIGION VASSALE Il n'a pas été dans les desseins de l'Empereur de supprimer ni même de diminuer la religion, mais il avait l'idée fixe d'en faire une vassale de son empire. Ce que nous en avons rapporté (page 180) se trouve confirmé par cette citation du Mémorial de Sainte-Hélène: « Si j'étais revenu vainqueur de Moscou, j'eusse amené le pape à ne plus regretter le temporel, j'en aurais fait une idole,... j'aurais dirigé le monde religieux, ainsi que le monde politique... Mes conciles eussent été la représentation de la chrétienté, et le pape n'en eut été que le président (173). »
C'est pour amener cette vassalité que les articles organiques ont été perfidement adjoints au Concordat et que le budget des cultes, dette envers l'Eglise de France, devient, dans la pensée du despote et de ses successeurs, un moyen de tenir sous le joug le Clergé, assimilé à un fonctionnaire rétribué.
L'Empereur a passé, et les instruments de vassalité sont demeurés.
Supposons les juifs, au cours de leur puissance grandissante, parvenant à diriger soit d'une manière occulte, soit par une participation normale aux affaires du pays, ces instruments de vassalité, ce budget, ces articles organiques, même ce Concordat, quel appoint pour leur crédit, grand Dieu ! et quelle humiliation pour l'Eglise de France !
Audacieux Empereur, avec votre astuce de léopard unie à votre vigueur de lion, vous avez voulu faire tomber dans le piège de votre gloire l'Eglise, la Synagogue, la France: l'Eglise usera le piège, la Synagogue saura s'en tirer, mais la France y sera trouvée pantelante et humiliée, jusque dans les choses saintes !
B. — LE BOULEVERSEMENT DES FRONTIÈRES, LE PÊLE-MÊLE DES PEUPLES ET DE LEURS INTÉRÊTS.
Ce pêle-mêle, que nous avons décrit (pages 186-189), complétons-le par la citation d'un historien:
« On vit alors les plus étranges mélanges de peuples; on vit les cipayes combattre en Egypte; une flotte anglaise partir des côtes du Malabar et de Coromandel pour débarquer des troupes à l'Ile-de-France; les Espagnols combattre à Dantzick, les Italiens à Varsovie, les Polonais à Saint-Domingue. Il (l'Empereur) mit en pièces les nationalités, foula aux pieds les constitutions, et fit d'une république un royaume ou une vice-royauté; il mêla selon son caprice, les plaines et les montagnes, les peuples anciens et nouveaux, sans souci des religions, de la langue et des mœurs; il conquit sans idée de conserver, sans suivre une diplomatie habile et sans savoir fonder l'avenir sur la connaissance du passé; il détacha le Tyrol de l'Autriche, à laquelle il livra Venise; il sépara Rome et Florence de l'Italie, dont elles sont le cœur; il mit un roi dans la Hollande républicaine; il détacha les princes allemands de leur empereur, et prétendit faire plier l'Espagne sous des rois étrangers. D'une ruine sortait une autre ruine; son but unique était de conquérir des peuples, afin de les employer pour en conquérir d'autres (174). »
Qu'est-il résulté de ce pêle-mêle ?
La naissance du cosmopolitisme; par sa convoitise babylonienne, Napoléon en est l'auteur.
Les sectes, du reste, l'avaient annoncé. « Les princes et les nations disparaîtront de dessus la terre. La raison alors sera le seul code des hommes (175). » N'est-ce point là le but, avoué aujourd'hui, du socialisme international: Renverser toutes les frontières, abolir toutes les nationalités, en commençant par les plus petites, pour ne faire qu'un seul Etat, effacer toute idée de patrie, rendre commune à tous la terre entière (176).
Or l'Empereur a inauguré ce cosmopolitisme par son bouleversement des frontières et son pêle-mêle des peuples.
Mais là encore n'était-ce pas préparer la prépondérance juive ?
Cosmopolites depuis le commencement de l'ère chrétienne, les juifs, dans les tendances réfléchies ou inconscientes de leur jalousie, n'ont jamais eu qu'un rêve: celui de désorganiser les peuples chrétiens et de briser par la ruse, ne pouvant le faire par la violence, le faisceau de leurs forces, de leurs gloires, de leurs intérêts. Quelle satisfaction secrète pour ces éternels voyageurs le jour où le cosmopolitisme leur donnerait des compagnons de voyage ! Le pêlemêle de l'Empire a commencé cette joie de la ressemblance. A tous ces princes descendant les degrés des trônes et s'en allant en exil, à tous ces peuples traînés et retraînés sur les grands chemins, le Juif-Errant a pu dire: Vous voilà devenus semblables à moi !...
Mais quel renversement, grand Dieu ! si jamais le Juif-Errant, ayant été invité à s'asseoir au foyer des nations, en apercevait les fils cheminant hors de leurs terres, de leur sol: complice de l'expulsion, ou simplement spectateur paisible !
C. - l’EMIETTEMENT DES FORTUNES
C'est un des plus fâcheux résultats du Code Napoléon inutile d'y revenir.
Mais, hélas ! par ce résultat, le Code Napoléon ne devient-il pas l'auxiliaire le plus actif de la puissance hébraïque ? comparable à la trahison d'un maréchal de France sur un champ d'opération où, contre la fortune des nations, s'avancerait la fortune juive ! Le Code livre à cette dernière domaines, châteaux, collections d'art, finances: tous les bagages seront pris.
Qu'on médite, en effet, les lignes suivantes; elles sont d'un Jurisconsulte aussi éminent qu'impartial: « Le juif conquiert le chrétien; nous n'avons pas la simplicité de lui en faire un reproche; mais nous demandons quel intérêt a le législateur à mettre le citoyen français dans la nécessité de vendre ses immeubles aux juifs qui les gardent ?
« Nos lois interdisent la faculté de conserver le bien. La liberté de tester est un délit qui est immédiatement réprimé par les tribunaux.
« Les Juifs ont beau jeu. Ils sont économes. Ils savent que les chrétiens, de par notre Code civil, subissent périodiquement pour leurs successions une crise financière. Ils sont à l'affût, ils se présentent la bourse à la main. Le chrétien trouve facile d'y puiser. Il n'a pas la prétention de garder une maison qui serait trop lourde pour un héritier, et qui d'ailleurs est grevée d'hypothèques et de droits de mutation. La maison passe naturellement au juif prêteur. La maison a été bâtie pour lui. Quant au chrétien qui l'a construite, embellie a ses frais, il lui restera la ressource de l'habiter comme locataire.
« On crie contre eux, ils laissent crier; on les ruinerait aujourd'hui, qu'ils recommenceraient demain. Ils ne sont que la cause seconde de leurs richesses. La cause première, c'est le Code. »
Le sage et clairvoyant jurisconsulte, écrivant en 1888, a pu ajouter:
« Aujourd'hui les juifs dominent à Rome en vertu du Code Napoléon, qui a retiré toute fixité aux intérêts matériels. Etablissez le Code civil à Rome, écrivait Louis-Napoléon à Edgar Ney. Le Code civil mine, ébranle, détruit tous les corps, toutes les institutions fondées à toujours; il leur ôte, par une liquidation incessante des intérêts matériels qui les soutiennent, toute puissance de s'affermir ou de se développer. Il ouvre, dès le premier jour, la place à l'ennemi. C'est par cette brèche, et non par la brèche de la porta Pia, que l'ennemi est véritablement entré à Rome. Sous les mots de ventes et d'achats, de commerce, de crédit, de partage de successions, patronnés par le Code civil, la Révolution a pris possession de Rome. Les Français, là comme en France en 1789, ont livré la société aux juifs. Les juifs règnent à Rome, et ce n'est pas leur faute; des chrétiens d'un genre particulier l'ont absolument voulu.
« Le Code civil est la dynamite qui fait sauter toutes les institutions (177). »
Tout commentaire affaiblirait cette douloureuse citation.
D. — LA PASSION DE PARVENIR
Belle d'idéal avec l'ouverture du siècle, elle est devenue, vers la fin de l'Empire, inquiète, égoïste, grossière: son horizon, qui était avant tout l'acquisition de la gloire, s'est bien assombri.
Laissons quelques années se dérouler, le siècle s'avancer... voici 1840... puis 1860... Qu'est devenue la passion de parvenir ? Son but est-il encore la gloire ?
Un peu... du côté de l'Afrique...; la conquête de l'Algérie Son but est-il du moins l'honneur ?
Assez ! mais à dire vrai, les honneurs plus que l'honneur.
Serait-il la jouissance ?
Oh ! d'une façon effrénée, et universellement. La passion de parvenir pour jouir, naufrage de tous les caractères ! Bossuet prévoyait un temps « où l'on tiendrait tout dans l'indifférence, excepté les plaisirs et les affaires (178) ».
En ce temps-là aussi, la prépondérance juive ne sera-t-elle pas en pleine floraison ?
D'abord, pour ce qui est de l'honneur et des honneurs, les israélites en seront avides: quoi d'étonnant, après dix-neuf siècles de rebut ! Mais ce qui deviendrait surprise poignante c’est que, quand l'israélite et le chrétien descendraient ensemble dans la carrière pour disputer le prix de la course, l'israélite obtînt presque toujours le prix. Sans doute, ses aptitudes auront été rafraîchies et stimulées par l'émancipation civile mais n'aura-t-il pas surtout l'or qui possède la vertu d'abréger, encore mieux que la vapeur, les distances à parcourir ?
Ensuite, pour ce qui est de la jouissance, sa poursuite ne serait-elle pas en voie de préparer une redoutable sujétion du chrétien vis-à-vis de l'israélite ? L'un et l'autre seront affamés de bien-être et de plaisir: l'un parce qu'il n'aura plus la foi, l'autre parce qu'il aura conquis la liberté de tout savourer, de tout attirer, de tout captiver. Et, de plus, c'est ce dernier qui aura l'or. Il en résulterait, quoi ? La néfaste reproduction de la personne humaine employée comme un moyen. Napoléon a mis à l'ordre du jour cette abominable théorie. Mais s’il y a eu, avec lui, gaspillage de la vie humaine, la personne de l'homme a été traitée, du moins, comme un moyen de gloire: tandis qu'il est à craindre que sous une ère « où l'on tiendrait tout dans l'indifférence, excepté les plaisirs et les affaires », la personne humaine ne fût traitée et exploitée que comme un moyen de jouissance et d'aplatissement.
Nous avons suivi, une à une, les brillantes ornières creusées par le char de l'Empire: elles mènent toutes à la prépondérance juive.
Le trépied où le captif de Sainte-Hélène faisait parler ses idées, ses batailles, ses lauriers, entrevoyant l'avenir pour lui et les siens, n'était-il pas menteur ?
CHAPITRE IV RÉORGANISATION DU CULTE JUIF PAR NAPOLÉON VAIN SIMULACRE EN SOI, MAIS FUNESTE
I. Une des grandes fautes de Napoléon a été la réorganisation du culte juif. Légèreté des historiens par rapport à cet acte. Examen de la faute de l'Empereur. — II. Le Châtiment des juifs prédit par leurs prophètes devait être celui-ci: une désorganisation religieuse, civile et politique. Napoléon, continuateur de la Révolution, entreprend une réorganisation. Gravité d'une pareille mesure. Dans quelles limites la Providence la tiendra circonscrite. Tableau de la réorganisation impériale du culte juif. — III. Ce que n'étaient plus les rabbins et ce qu'ils deviennent. Leur pouvoir usurpé à la faveur des désastres de la nation juive, ébranlé à la fin du XVIIIe siècle, est malheureusement réédifié, et plus solidement que jamais, par Napoléon.
— IV. Audacieuse tentative du grand Sanhédrin par rapport au salaire des rabbins. Napoléon lui barre le passage, mais elle triomphera avec Louis-Philippe. — V. L'écroulement de la Synagogue talmudique retardé pour longtemps. Comme quoi l'insanité de la doctrine du droit commun pour toutes les religions se juge bien ici « De soufflets en soufflets, jusqu'au trône du monde. »
I
En face du fracas des nations durant les années de l'Empire, se produisit un petit événement qui passa presque inaperçu, comme tout ce qui pointe et commence, mais qui devait être gros de conséquences.
Ce petit événement a été la réorganisation du culte juif. Retournons par la pensée à l'année du Sanhédrin, 1807.
« Je désire, avait dit Napoléon dans ses instructions à ses commissaires près du grand Sanhédrin, prendre tous les moyens pour que les droits qui ont été restitués au peuple juif ne soient point illusoires, et pour leur faire trouver Jérusalem dans la France (179). »
Généreux mais imprudent désir ! Les actifs et habiles fils d'Israël ne devaient que trop s'y conformer, et non seulement trouver Jérusalem dans la France, mais fondre la France dans Jérusalem.
Le mois d'avril avait vu la fin des Assemblées israélites à Paris. Une année presque entière s'écoula sans qu'aucune mesure ni pour ni contre fût adoptée. Napoléon réfléchissait.
Dans l'année 1808, le même jour (17 mars), trois décrets au sujet des juifs parurent au Bulletin des Lois.
Le troisième de ces décrets traitait de la condition des juifs au point de vue civil et politique, et devait soulever de violentes colères, et amener même une rupture entre Napoléon et ses protégés. Nous l'examinons ci-après, au Livre IIIe.
Les deux premiers avaient un but exclusivement religieux: ils organisaient l'exercice du culte israélite en France.
Les historiens français ont été d'une excessive légèreté par rapport à ces deux premiers décrets. Ils ont considéré l'organisation du culte hébraïque comme un objet très secondaire, et ne s'en sont point occupés. Du reste, tout le monde en France a imité leur insouciance. On payera cher cette légèreté.
Les fils d'Israël, eux, avaient compris toute l'importance de cette organisation, et lorsqu'il en fut question pour la première fois devant le Sanhédrin, après que lecture eut été donnée du projet de l'Empereur qui en fournissait les grandes lignes et les détails, le rapporteur prononça ces paroles dont lui-même ne soupçonna pas toute la gravité: « Le culte mosaïque sort pour la première fois, si nous pouvons nous servir de cette expression, de l'espèce d'incognito où il a été depuis deux mille ans (180). »
Singulière expression !
Quel était cet incognito ?
II
La plupart des prophètes en Israël avaient prédit une désorganisation totale du peuple juif qui serait la punition d'un grand crime; et parce que sa forme de gouvernement était théocratique, c'est-à-dire essentiellement religieuse jusque dans sa constitution civile et politique, la désorganisation, en portant plus particulièrement sur le culte, atteindrait la vie juive dans ses dernières ramifications. Le décret de désorganisation formulé par le prophète Osée qui avait récapitulé les menaces des prophètes ses devanciers, contenait une rigueur de termes qui ressemblaient à autant d'incisions de scalpel: Durant de longs jours, les enfants d'Israël seront sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans éphod et sans théraphims (181).
La désorganisation totale s'est réalisée:
Sans roi: avec la tribu royale de Juda perdue dans le pêle-mêle de l'exil, et avec la famille de David éteinte, la royauté a été anéantie;
Sans prince: ni Juge, ni Magistrat, nul Gédéon, nul Machabée, ne se sont plus levés parmi eux;
Sans sacrifice: l'agneau pascal n'a plus été immolé une seule fois, et la tribu sacerdotale de Lévi est introuvable;
Sans autel: du Temple de Jérusalem détruit il ne reste plus pierre sur pierre; il n'a pu être reconstruit; il était défendu d'avoir un autel ailleurs;
Sans éphod: vêtement sacré du Grand-Prêtre, l'éphod était le signe conventionnel des communications de Dieu avec son peuple; son rejet devenait l'annonce que Dieu ne communiquerait plus avec lui; en effet, aucun prophète ne leur a plus parlé, aucun thaumaturge n'a plus fait de miracle;
Sans théraphim: les théraphims étaient aux juifs ce que les dieux lares étaient aux païens; leur disparition marquerait l'instabilité des foyers en Israël: en effet, la paix et la fixité n'ont plus été leur partage.
La désorganisation totale est donc visible, palpable, portant plus particulièrement sur le culte. Les docteurs juifs, cependant, n'ont jamais voulu reconnaître le châtiment. Dans l'impossibilité où la Providence les tenait de réorganiser le culte, ils ont, sinon expliqué, du moins pallié le châtiment de la désorganisation par le prodige de la conservation: « éparpillés, la Providence nous conserve; un jour, nous nous réorganiserons... »
Cette explication donnée, revenons à la singulière expression prononcée au Sanhédrin.
L'impossibilité insurmontable de réorganiser leur culte foudroyé était ce que le rapporteur décorait du joli nom d’« incognito »: le culte mosaïque va sortir pour la première fois de l'espèce d'incognito où il a été depuis deux mille ans. On savait jusqu'ici que ce voile mystérieux, l'incognito, pouvait bien convenir à la Providence: le hasard est l'incognito que la Providence; mais on ignorait absolument que le voile enveloppât aussi le culte juif...
Or, le Sanhédrin annonçait solennellement que l'Empereur allait retirer le voile, faire cesser l'incognito.
C'était grave, fort grave.
La gravité, sans doute, sera circonscrite. Elle n'ira point jusqu'à infliger un démenti à la prophétie du châtiment: les paroles de Dieu ne passent pas. L'Empereur restituera au culte juif un lustre extérieur, un apparat, et par là une apparence de vie; mais l'ordonnance impériale ne leur rendra ni l'autel des sacrifices, ni l'agneau pascal, ni la tribu lévitique. Du reste, César n'y songe aucunement. Il ne s'est jamais inquiété du rôle et de la classification des sacrifices juifs, du sacrifice dont le sang était porté dans l'intérieur du tabernacle, du bouc émissaire, de la vache rousse, du sacrifice pour les lépreux. En faisant sortir le culte juif de l'impopularité et de l'isolement dans lequel il était demeuré, il n'a en vue qu'un motif d'ordre général, ou plutôt révolutionnaire. Au rang les soldats juifs ! et pour leurs synagogues une place au soleil ! c'est là toute sa visée.
Néanmoins, bien que circonscrite dans les limites de ce qui est extérieur et purement civil, la réorganisation du culte juif est une grande faute. Aux yeux de l'Eglise catholique, et pour le salut des populations, c'est déjà trop. Eh quoi, ce culte a été ruiné de fond en comble à l'apparition et par la mort du divin Législateur des chrétiens, et un César inconsidéré vient lui dire: Avance-toi sur la même ligne que la religion chrétienne ! C'était un mépris du passé, et il y avait là un danger pour l'avenir. Si, alors qu'ils étaient totalement désorganisés, les juifs ont été redoutables durant le Moyen Age, que ne deviendront-ils pas maintenant que l'Etat leur rend une vie civile et religieuse ? Voici le tableau de cette organisation impériale du culte juif:
DECRET DU 17 MARS 1808
ARTICLE PREMIER. — Il sera établi une Synagogue et un Consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.
ART. II. — Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille israélites dans un seul département, la circonscription de la Synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir. Le siège de la Synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse...
ART. VII. — Le Consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d'ancien du consistoire...
ART. XII. — Les fonctions du Consistoire seront: de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception et l’emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque; — d'encourager, par tous les moyens possibles, les israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n’ont pas des moyens d'existence avoués; — de donner, chaque année, à l'autorité connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.
ART XIII. — Il y aura, à Paris, un Consistoire central...
ART. XVII. — Les fonctions du Consistoire central seront: de correspondre avec les Consistoires; de veiller dans toutes ses parties à l'exécution du présent règlement; de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l’exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; de confirmer la nomination des rabbins.
Signé: NAPOLEON.
Par l'Empereur: Le ministre, secrétaire d 'Etat,
Signé: HUGUES B. MARET.
Voilà donc, en conformité avec le chant d'espérance entonné au Sanhédrin, le culte juif officiellement sorti de l’« incognito » où il s'était drapé durant près de deux mille ans !
Le nom d'un César est apposé au bas du décret.
Un autre César, Constantin, avait fait sortir le culte catholique de l'obscurité des catacombes. Celui des temps modernes arrache son protégé à des décombres foudroyés et à l'obscurité du ghetto. Il lui commande de prendre une physionomie, celle que lui confère le décret.
Nul évêque ne jeta le cri d'alarme, nul ne hasarda la moindre remarque. L'abbé Maury et Mgr de la Fare (182) s'étaient trouvés sur la brèche, pour s'opposer à l'entrée des juifs dans la société civile, en 1791; personne ne s'y trouve plus pour s'opposer à l'entrée de leur culte dans les prérogatives dont jouissait, jusqu'alors, le seul culte chrétien.
Le passé de la France était bien mort !
Les juifs, en ressuscitant, l'ont enveloppé de leur linceul.
De l'édit de Napoléon qui leur reconnaît le droit d'élever des synagogues sur toute la surface du sol de France, à l'édit (en remontant le cours des âges) de Charles VI qui leur avait ordonné de vider le royaume, quelle distance !
Tout est logique dans l'œuvre de la Révolution à leur égard:
En 1791, le décret de la Constituante leur a dit: Vivez; en 1808, le décret de l'Empereur leur dit: Vivez en juifs
En vérité, la prophétie d'Osée, qui ne saurait être contredite ni attaquée de front, est en quelque sorte tournée, prise à revers. Sans doute, les juifs n'ont plus de prince, mais l'Empereur, l'Etat, est devenu leur prince. Sans doute, ils n'ont plus ni temple, ni autel; mais, de par la loi, ils ont officiellement des synagogues et des consistoires. Qu'ont-ils besoin de théraphims ou dieux lares, puisque, selon le mot même de Napoléon, ils trouvent Jérusalem dans la France ? Et s'ils n'ont plus de prophètes, tous se chargent de l'être et d'annoncer que dans cent ans, cinquante ans et moins Israël sera en train de devenir le maître du monde !
III
La réorganisation néfaste entreprise par l'Empereur a un trait qui exige un relief à part: c'est le retour à la vie et le surcroît de puissance qu'il procure, le croirait-on ? aux rabbins.
En tant que personnes, les rabbins sont extrêmement respectables: pères de famille aux mœurs, la plupart du temps, patriarcales, gardiens de la paix au milieu de leurs frères, et parfois, savants distingués dans les sciences physiologiques et médicales. Mais en tant que funeste à la vérité divine, leur institution est bien malheureuse.
Expliquons la raison de cette antipathie qui n'atteint que leur titre, et qu’ont augmentée les mesures prises en leur faveur par Napoléon. Elle serait le salut d'Israël, si elle était étudiée à fond, et partagée !
Les rabbins ne sont nullement des prêtres, pas même des docteurs de la Loi (183). Leur autorité est un résultat des malheurs d'Israël. Quand tout fut à terre chez ce peuple, le Sacerdoce, la Magistrature, l'Ecole; quand tout fut dispersé: l'instinct de la conservation, puis la confusion et l'habitude, firent concentrer dans les mains d'un seul homme, qui n'était cependant ni prêtre, ni juge, ni docteur, les débris de ce triple pouvoir; ce fut de la sorte que surgit le rabbin, désigné du reste au choix de ses coreligionnaires par son savoir et ses qualités personnelles. Mais alors il se produisit au ghetto, dans l'intérieur des juiveries, ce qui arrive toujours quand tous les pouvoirs sont réunis dans un seul: il y eut exagération, et parfois exagération ridicule, de l'autorité rabbinique. On est stupéfait quand on lit ce que les rabbins disaient d'eux-mêmes et de leur autorité: « Apprends, mon fils, apprends à prêter une plus grande attention aux paroles des sages qu'aux paroles de la Loi (184). Plus grave est le péché contre les paroles des sages que contre les paroles de la Loi (185). » Et les habitants du ghetto n'avaient garde d'y contredire. « Tout ce que nos rabbins ont enseigné dans leurs homélies, écrit l'un d'eux, doit être accepté à l'égal de la Loi de Moïse. Et s'il arrive que ce qu'ils disent paraisse ou hyperbolique, ou contre-nature, ou au-dessus de notre intelligence, il faut l'imputer non à leurs paroles, mais à la pesanteur et à la pauvreté de notre esprit (186). » Après cela, il n'est pas étonnant que Basnage, qui a étudié à fond la matière, ait pu dire: « Les rabbins n'oublient rien pour faire valoir leur autorité. Ils soutiennent qu'on ne peut violer leurs lois sans s'exposer à la mort. Ils en allèguent des exemples qui font peur (187). »
C'est ainsi que s'est formé le pouvoir exorbitant du rabbin, alors qu'il n'est ni prêtre, ni juge, ni docteur (188). Une de leurs ouailles moins timorée les raille finement, dans les Archives israélites: « Le rabbinat est une création bâtarde des temps modernes; le sacerdoce est mort aux mains des fils d'Aaron; rabbinisme et prêtrise sont loin d'être synonymes; je pourrais vous faire suivre pas à pas, à travers les sentiers historiques, les transformations successives de la
chrysalide rabbinique, qui n’est revêtue de soie qu'à la dernière période de son existence (189). »
C'est vrai, la soie leur est venue de Napoléon.
Mais n'anticipons pas.
Ils n'étaient donc pas prêtres. De plus, vers la fin du siècle dernier, leur autorité, formée des malheurs de la nation juive et jusqu'alors incontestée dans les synagogues, avait subi un ébranlement inattendu, presque un déclin. Le souffle du rationalisme, en Allemagne, la tempête de la Révolution, en France, l'avaient produit. Mendelssohn avait appris à ses coreligionnaires allemands à s'enfuir d'une tutelle « qui empêche toute libre respiration ». Le rabbinat n'était plus, au-delà du Rhin, « qu'une institution desséchée, momifiée (190) ». Zung écrivait que « les rabbins allemands et polonais étaient étrangers à presque toutes les connaissances humaines (191) », et Steinheim, dans son Moïse Mendelssohn, faisait la description du « sacerdoce judaïque aussi insolent qu'ignorant (192) ».
Pour être moins bafoué en France, le rabbinat n'était guère en meilleure situation. Quand les commissaires impériaux près le grand Sanhédrin posèrent cette question: Qui nomme les rabbins ? Quelle juridiction de police exercent-ils parmi les juifs ?, l'assemblée répondit: « La qualification de rabbin ne se trouve nulle part dans la Loi de Moïse... Depuis la Révolution, il n'existe plus en France ni dans le royaume d'Italie aucun tribunal de rabbins... Les attributions des rabbins, dans les lieux où il y en a, se bornent à prêcher la morale dans les temples, à bénir les mariages et à prononcer les divorces (193). »
Donc, nullement prêtres ni docteurs de la Loi, et, à la fin du XVIIIe siècle, vilipendés en Allemagne, dépouillés en France de leur antique prestige: tels apparaissaient les rabbins, près de finir, pour le salut d'Israël et sa réconciliation avec le genre humain !
C'est à ce moment, hélas ! (et il faudrait donner à cet hélas toute la tristesse des lamentations de Jérémie), que dans le décret de 1808, concernant les synagogues et les consistoires, apparaissent également des articles concernant les rabbins: articles qui sauvent leur existence et érigent leur autorité à une hauteur inespérée, puisque, désormais, les rabbins seront considérés religieusement et civilement sur la même ligne que les prêtres catholiques.
Voici ce complément du chef-d'œuvre:
ART. V. — Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
ART. VI — Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le Consistoire...
ART. XIII. — Il y aura à Paris un Consistoire central composé de trois rabbins et de deux autres Israélites.
ART. XIV. — Les rabbins du Consistoire central seront pris parmi les grands rabbins...
ART. XXI. — Les fonctions des rabbins sont: 1° d'enseigner la religion; 2° la doctrine renfermée dans les décisions du grand Sanhédrin; 3° de rappeler en toute circonstance l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement encore tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi; 4° de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observations qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5° de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'Empire et la famille impériale; 6° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder, que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.
ART. XXII. — Le traitement des rabbins, membres du Consistoire central, est fixé à 6.000 francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales à 3.000 francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue. Il ne pourra être moindre de 1.000 francs. Les Israélites des circonscriptions voisines pourront voter l'augmentation de ce traitement.
C'en est fait, la chrysalide rabbinique, pour employer la comparaison fournie par les Archives israélites, est formée: les rabbins sont revêtus de soie par Napoléon. Qu'eux-mêmes nous permettent de donner, à la pittoresque figure, tout son développement Revêtus de soie: ce n'était que la moitié du bienfait du prince. Mais lorsque le Bulletin des Lois annonça que les grandes villes de l'Empire étaient pourvues de rabbins, on vit une métamorphose inusitée: celle de papillons hébreux diaprés des couleurs de France ! C'est ainsi qu'ont surgi le rabbin de Paris, le rabbin de Lyon, le rabbin de Bordeaux, les rabbins de Nancy, de Versailles, et ceux des autres villes.
IV
Il y a toutefois une chose que Napoléon a refusé d'accorder aux rabbins, et qui deviendra leur conquête sous Louis-Philippe.
Le budget des cultes constitué en vertu du Concordat (1801) fonctionnait à peine depuis cinq ans. Ce budget était, sinon la transformation, du moins la compensation des biens enlevés à l'Eglise de France par la Révolution. Il était une dette, érigée en institution. Les évêques et les prêtres, en acceptant d'être salariés par le Gouvernement, recevaient moins des émoluments de leurs services qu'une rente de leurs capitaux saisis et gérés par l'Etat.
Les rabbins méditèrent de prendre part à cet appétissant budget, à peine dressé.
Le flair hébraïque n'a jamais été, peut-être, plus développé qu'en cette circonstance. En effet, sans avoir rien perdu de son temporel sous la Révolution, la Synagogue se concertait avec ses protecteurs pour obtenir qu'on comprît et qu'on englobât ses rabbins dans les bénéficiaires du Concordat. Si on réussissait, on ferait coup double; car, outre de bonnes rentes constituées sur des biens non perdus, les rabbins obtiendraient, par cela même, la suprême consécration de leur reconnaissance comme prêtres juifs: ne seraient-ils pas en effet, de par le budget des cultes, sur le même rang que les prêtres catholiques ?
C'était de l'audace.
Pour mieux réussir auprès de Napoléon, les rusés fils d'Israël profitèrent de la question militaire. L'Empereur demandait aux rabbins de l'aider à former de bons conscrits parmi leurs ouailles. L'Assemblée des Notables et le Sanhédrin firent parvenir cette requête au pied du Trône où la mine avantageuse des soldats juifs en espérance devait faire passer le salaire des rabbins :
L’ASSEMBLEE DES ISRAELITES DE L’EMPIRE DE FRANCE ET DU ROYAUME D ITALIE,
« Considérant que c'est le devoir de tous les israélites de l'Empire français et du royaume d'Italie, de verser leur sang dans les combats pour la cause de la France, avec ce même dévouement et cette même valeur que leurs ancêtres combattaient autrefois les nations ennemies de la Cité sainte, et de chercher les occasions de se rendre dignes des bienfaits qu'un grand prince daigne en ce moment répandre sur eux:
« Arrête:
« Que Messieurs les Commissaires de SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE seront suppliés de porter aux pieds du trône l'expression de sa profonde et immortelle reconnaissance;
« Que Messieurs les Commissaires seront également suppliés de faire connaître à Sa Majesté le vœu que forme humblement l'Assemblée, pour que Sa Majesté mette le comble à ses bienfaits, en consentant à concourir Elle-même au salaire des rabbins, et en daignant charger les autorités locales de l'Empire de France et du royaume d'Italie de se concerter avec les consistoires, afin qu'ils achèvent de détruire par leur intervention et leur zèle l'éloignement que pourrait avoir la jeunesse israélite pour le noble métier des armes, et qu'ils parviennent ainsi à assurer la parfaite obéissance aux lois de la conscription (194). »
L'Empereur, il faut lui rendre cette justice, fut outré de cette audace; et l'ambition d'avoir des conscrits ne lui fit pas absoudre, chez les rabbins, l'ambition d'émarger au budget des cultes. Sa Majesté était au camp de Tilsitt. M. Furtado, président de l'assemblée juive, vint exprès de Paris pour lui présenter la requête. L'Empereur, d'un trait de plume, barra le passage à l'audacieuse tentative. Il ordonna que Messieurs les israélites fourniraient eux-mêmes, dans les différentes synagogues consistoriales, le traitement à leurs rabbins (195).
Malheureusement, le principe était posé, les juifs ne se tiendront point pour battus. Leur marche a quelque chose de celle de la petite aiguille des horloges qui, en paraissant immobile, arrive en même temps que la grande. Au surplus, les fautes du gouvernement impérial n'autorisaient-elles pas leurs prétentions ? On leur refuse le salaire des évêques et des prêtres, et leur entrée en fonctions est assimilée à celle des évêques. Le 10 mai 1808, à l'installation du Consistoire de Paris, les trois grands rabbins prêtaient ce serment: « Je jure et promets à Dieu, sur la sainte Bible, de garder obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur. Je promets aussi de faire connaître tout ce que j'apprendrai de contraire aux intérêts du Souverain ou de l'Etat. » Or la formule de ce serment était exactement conforme à celle que prêtaient les évêques, en vertu du Concordat: « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder fidélité et obéissance au Gouvernement, et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au
Gouvernement. » D'évêque à rabbin le serment étant le même, pourquoi n'y aurait-il pas similitude de salaire ? Ainsi pensait-on en Israël.
Cette tentation ne s'en ira plus. La faiblesse toujours plus grande de la société chrétienne malade de la Révolution ne fera que la fortifier. Les gardiens du budget des cultes oublieront insensiblement que ce budget en France implique une dette envers l'Eglise: ils n'y verront que le salaire de fonctionnaires religieux. Aussi, lorsque profitant d'une circonstance où le Gouvernement aura besoin d'eux, les israélites reviendront à l'assaut du malheureux budget, des ministres complaisants, appuyant leur attaque, exigeront, au nom de l'égalité devant la loi, qu'un culte ne reste pas sans le sou lorsqu'un autre culte reçoit des millions. p190 Cette circonstance arrivera en 1831, et Louis-Philippe, sollicité par le ministère Laffitte, apposera sa signature à cette loi de l'Etat, que nous transcrivons ici par anticipation:
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Article unique. — A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du trésor public.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par Nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, au Palais-Royal, le huitième jour du mois de février l'an 1831.
Signé: LOUIS-PHILIPPE.
Cette signature de Louis-Philippe comptera parmi les coups mortels portés à la société chrétienne; mais les fausses mesures prises par Napoléon en faveur des rabbins ont préparé le coup.
V
En résumé: le culte juif, tiré de ses décombres, est réorganisé civilement, et les rabbins sont assimilés à des prêtres.
Quelles conséquences vont sortir de cette fécondation étrange, hybride ?
De bien graves.
D'abord l'écroulement de la synagogue talmudique est retardé pour longtemps. Il n'y aura plus seulement le bandeau de l'erreur à arracher à tous ces rabbins, mais leur part au budget. Ils se tiendront cantonnés non plus seulement dans le Talmud, mais dans le salaire de l'Etat. Bien habile, celui qui les délogera de cette nouvelle position ! Au siège de Jérusalem par Titus, il y eut une tour fameuse qui, retardant longtemps la prise de la ville, augmenta les horreurs du siège: la tour Antonia, contre laquelle les légions romaines élevèrent huit chaussées successives. Le budget des cultes est devenu l'Antonia des rabbins ! Ils s'y sont établis comme dans une forteresse. Alors que les prêtres catholiques pourront être contraints de sortir du budget, eux s'y maintiendront.
Deuxième conséquence:
Une série d'affronts attend l'Eglise de Dieu.
Des ministres de la guerre interdiront aux soldats de la très noble France d'assister à la messe, même un jour de Pâques; mais pour les juifs qui seront sous les drapeaux, sur la demande du grand rabbin de Paris, des circulaires datées du cabinet du ministre, écrites de sa main, enjoindront à tous les chefs de corps de les laisser aller dans leurs foyers pour y célébrer leurs Pâques juives. O vous qui frémissez de ce contraste, et qui avez feuilleté la Bible, vous souvient-il d'une histoire qui a certainement intéressé votre enfance et ému alors votre imagination: l'animosité d'Ismaël contre Isaac, dans leurs jeux d'enfants.
Isaac est le fils de Sara, qui dans la langue sainte signifie reine: Sara est reine auprès d'Abraham, roi-pasteur. Ismaël, au contraire, est le fils de la servante, d'Agar qui est pleine d'arrogance. Stimulé par l'arrogance de sa mère, Ismaël, jouant avec Isaac, l'a maltraité: il le déteste, parce qu'Isaac est l'enfant du miracle et l'héritier de la promesse du Messie. Celle qui est reine se plaint auprès du patriarche, et Abraham, averti par l'ange du Seigneur d'avoir égard aux plaintes de Sara, met à la porte Agar, malgré la légitime affection qui l'unit à elle et la douleur d'une séparation; il l'abandonne dans le désert, en ayant soin de déposer un pain de froment .dans sa main, et une cruche d'eau sur son épaule.
Voilà l'épisode biblique.
Veut-on, maintenant, comprendre d'un seul trait la situation douloureuse qui sera faite aux catholiques sous les yeux des Israélites ? Qu'on renverse la figure biblique, qu'on intervertisse le rôle des personnages:
C'est la reine qui sera mise à la porte, l'Eglise catholique;
C'est la servante qui sera comblée de faveurs, la Synagogue !
Enfin, dernière conséquence:
Une inconnue redoutable pour la société chrétienne se dégage de toutes ces fausses mesures.
En effet, qu'on parcoure un à un les degrés de puissance où sont montés les fils d'Israël:
Ils étaient de tout temps une puissance hostile;
Ils étaient également une puissance financière, avec laquelle il fallait compter;
Ils sont devenus une puissance civile, par les droits du citoyen que la Constituante leur a reconnus;
Napoléon refait d'eux une puissance religieuse, en rendant la vie à leur culte et à leurs rabbins;
Il ne leur reste plus qu'à devenir une puissance politique, qui disposera, chez les nations hospitalières, du trésor, de la législature, de l'armée et de la diplomatie. Ils y arriveront. On les a initiés à ce succès. Le pouvoir central en religion, organisé au milieu d'eux en 1808, aura été le prélude et le modèle d'un pouvoir central à organiser en politique; et Crémieux, en créant l'Alliance israélite universelle, ne fera que transporter en politique la redoutable vitalité civile et religieuse que Napoléon a définitivement rendue aux juifs.
C'est ici le lieu favorable pour faire toucher du doigt l'insanité de cette trop fameuse doctrine du libéralisme: le droit commun pour toutes les religions.
Je ne me lasserai jamais de le redire et de le crier: un pareil régime est absurde et devait fatalement conduire aux plus funestes résultats (196). Absurde, parce que, ne se contentant pas d'outrager la doctrine et la morale de l'Evangile, il mettait sur le même pied d'égalité, sur le même rang d'honneur, les ténèbres et la lumière, le mal et le bien; et il ne pouvait manquer de conduire à des abîmes, parce que, les ténèbres recevant les mêmes égards que la lumière, il devait en résulter que les ténèbres l'emporteraient.
« Mais vous vous trompez ! » m'objectera le libéralisme, « et c'est de l'exagération ! Que le bien lutte, que la vérité combatte, et, de même que le soleil en apparaissant dissipe les ténèbres, la vérité en redoublant d'éclat dissipera les erreurs et les vices, et le bien triomphera. »
Voici la réponse doctrinale, appuyée, en fait, sur la question juive:
Le libéralisme part de cette hypothèse, de cette persuasion: que l'homme trouve dans sa nature égales forces pour le bien et pour le mal, et conséquemment, toutes forces étant égales, que le bien, parce qu'il est le bien, l'emportera, et que la lumière, parce qu'elle est la lumière, éclatera et triomphera.
Or, c'est là une méprise, une immense méprise, de laquelle devaient sortir la plupart des calamités de l'époque moderne.
Non, mille fois non, l'homme n'a plus dans sa nature forces égales pour le bien comme pour le mal. A l'origine, sous les berceaux émus de l'Eden, oui, cette égalité existait; bien mieux: dans notre nature sortie de la libéralité et des doigts magnifiques du Créateur, il n'y avait que le bien, encadré d'innocence, avec simplement la possibilité de mal faire. Mais depuis le péché originel, depuis le venin inoculé par le serpent, c'est le contraire qui est survenu et s'est établi: il y a eu en nous révolution. Dans notre nature viciée, la pente vers le mal est devenue plus forte que l'élan vers le bien. Nous n'avons plus eu, comme dit expressément le Concile de Trente, qu'un libre arbitre affaibli et incliné. Cela est si vrai, que tout bien nous coûte un long apprentissage; même après en avoir acquis l'habitude, nous ne l'accomplissons presque jamais qu'avec effort. Cela est si vrai, que l'homme le plus vertueux passe par des heures de vertige durant lesquelles, si le secours d'en haut ne le soutenait, le bien, en lui, succomberait. Le cœur de l'homme est devenu une arène, où les bêtes fauves sont les passions: qui ne les a entendues rugir ? Le chrétien seul, lorsqu'il s'humilie et tombe au pied de la croix, évite d'être dévoré.
Les forces de l'homme pour le bien et pour le mal ne sont donc plus égales: c'est une vérité indéniable, implacable. Cela étant, si, du domaine de l'individu, nous nous transportons dans la sphère sociale et politique, ne sera-ce pas une immense méprise et en même temps un suprême danger que de partir de ce régime-ci: le droit commun pour toutes les religions, les mêmes égards pour tous les cultes ? Attendu qu'on ne retrouve dans la vie publique de tous que ce qu'il y a dans la vie privée de chacun, dès l'instant que vous reconnaissez à l'erreur et à la vérité, au culte juif et au culte chrétien, les mêmes droits et les mêmes égards, vous arriverez aux conclusions les plus étranges. Voici, patente et accablante, une de ces conclusions.
Michelet, dans son Histoire de France, a imaginé, sur les juifs, ce joli contraste, bien connu:
« Pendant tout le Moyen Age, persécutés, chassés, rappelés, ils ont fait l'indispensable intermédiaire entre le fisc et la victime du fisc, entre l'agent et le patient, pompant l'or en bas, et le rendant au roi par en haut, avec laide grimace... Mais il leur en restait toujours quelque chose... Patients, indestructibles, ils ont vaincu par la durée. Ils ont résolu le problème de volatiliser la richesse; affranchis par la lettre de change, ils sont maintenant libres, ils sont maîtres; de soufflets en soufflets, les voilà au trône du monde (197). »
Qui leur a livré ce trône du monde ? Le droit commun. Et quels soufflets, à leur tour, ne vont-ils pas donner ?
CHAPITRE V EN FACE DE L’ENVIE DÉCHAINÉE EN EUROPE, LA FRATERNITÉ JUIVE REÇOIT DE L’EMPEREUR UNE NOUVELLE FORCE DE COHÉSION.
I. L'envie déchaînée en France et en Europe. — II. La fraternité israélite était peu redoutable autrefois, parce qu'elle avait, pour lui répondre, la fraternité des peuples catholiques. — III. Elle le devient, par son fait même, dans un milieu désagrégé par l'envie. Triste tableau de cette désagrégation. — IV. Napoléon confère encore à la fraternité hébraïque une cohésion nouvelle, une sorte de consécration civile, en créant les consistoires israélites. — V. Fausse mesure de l'Empereur en forçant les juifs à prendre des noms nouveaux. — VI. Habillés de neuf, un trop grand nombre d'entre eux ne changeront pas dans leur for intérieur; comme quoi il leur sera plus facile d'exploiter les passions devenues plus vénales au sein des démocraties et en particulier celle de l'envie.
I
Si le culte juif a reçu de l'Empereur une organisation qui équivaut à une investiture civile, la fraternité juive, cette autre chose d'Israël très célèbre et très importante, reçoit aussi sa faveur de la main impériale.
Appelons encore à notre aide le contraste, pour expliquer et faire comprendre la gravité des mesures napoléoniennes favorables à la fraternité juive: ce contraste, c'est l'envie déchaînée en France et en Europe.
Le livre des Proverbes s'est servi de cette énergique expression: L'envie est la pourriture des os (198); elle pourrit, parce que, en même temps qu'elle ronge l'âme de l'envieux, elle dessèche son corps.
L'envie aura été la pourriture de l'Europe, rongeant ses forces vives et desséchant ses nations les unes après les autres. Déchaînée une première fois avec Luther et les monarques du Nord, jaloux des prérogatives de la Papauté, elle renouvelle et étend son déchaînement avec les fureurs de la Révolution, les violences et les calculs de l'Empire.
Il viendra une heure dans la vie de la France où un grand évêque poussera ce cri d'alarme, hélas ! sans écho: « Il est remarquable que les évangélistes n'ont signalé, dans le cœur des ennemis de Jésus-Christ, qu'une seule passion comme cause de la mort à laquelle ils le livrèrent, l'envie; Per invidiam tradiderunt, c'est l'envie qui le fit livrer à Pilate (199).
« Eh bien ! la même passion ronge la France, l'envie, une terrible envie de toutes les classes de la nation les unes contre les autres; le mépris, le dédain, la jalousie des classes élevées contre la classe bourgeoise, de la bourgeoisie contre le peuple, et du peuple contre tous.
« Voilà non pas l'unique cause sans doute, mais voila le principe réel, intime de la Révolution française.
« Voilà la grande inspiratrice de tout ce qui se dit et se fit alors.
« Voilà ce qui a créé ces rages, absolument inexplicables sans cela.
« Oui, la France, souvent si noble et si fière, est une nation vaine; la vanité, l'orgueil vain, ont toujours joué un rôle terrible dans tous ses malheurs.
« Et la Révolution française n'est pas finie, parce que cela dure encore.
« L'union n'est pas faite; l'envie n'a pas désarmé; la vanité, l'orgueil, la jalousie nous aigrissent, nous divisent encore.
« Et après quatre-vingts ans de révolutions, le même mal est, à l'heure qu'il est, vivant et menaçant parmi nous (200). »
Vénérable évêque, vous avez mis votre doigt sur la plaie; mais, comme autrefois Babylone, la France ne veut pas guérir !
En effet, qu'est-ce qui divise et déchire la pauvre France ?
Est-ce la liberté ? Mais non, puisque tout le monde en France l'aime.
Est-ce l’égalité ? Mais non, puisque les castes n'existent plus et que, depuis la fameuse nuit du 4 août 1789, les diverses classes, en France, fusionnent et se mêlent volontiers.
Est-ce la propriété ? Mais non, puisque chacun, aujourd'hui, peut devenir propriétaire. Qui ne possède pas un champ ou une chaumine possède du moins des outils et ses deux bras, pour pouvoir acquérir autre chose.
Qu'est-ce donc qui désunit et déchire la malheureuse France ? L'exécrable et maudite envie.
Elle fit explosion dans cette lugubre séance de janvier 1793 où, Louis XVI ayant été amené à la barre pour être jugé, le propre parent du roi laissa tomber ce vote: J'opine pour la mort. A ce moment, de la poitrine même des plus mauvais, sortit spontanément ce cri d'horreur: O le monstre !
Il y eut, d'elle, une autre explosion dans les scènes de la Terreur où beaucoup de Français furent dénoncés, puis égorgés, parce qu'ils possédaient des biens convoités par les dénonciateurs: histoire de la vigne de Naboth où les chiens venaient lécher le sang; la France assista, depuis avril 1792 jusqu'en août 1794, à cette horrible histoire du sang léché par l’envie...
Avec Napoléon, les explosions de l'envie accompagnèrent souvent celle de la poudre. Les palais, les couvents, les églises les musées étaient livrés au pillage. L'homme qui, se plaçant au-dessus des scrupules, enlevait les couronnes et les trônes comme loiseleur enlève les nids dans la forêt, excitait à la même déprédation sa bande de généraux. « Les lieutenants de l’Empereur, disent les chroniques de tous les pays, faisaient main basse sur les tableaux ou sur l'orfèvrerie des couvents. » Les juifs eussent-ils été plus rapaces ? Les chefs-d’œuvre de Michel-Ange, de Raphaël, de Léonard de Vinci, de Murillo, prirent le chemin de Paris. Le Louvre, palais du goût et du tact, devint l'antre de l'envie napoléonienne. L’Italie frémit de se voir dépouillée de ses chefs-d'œuvre: « Si elle n’aimait plus les nobles, les rois et les prêtres, elle conservait son enthousiasme pour les arts; or, elle fut blessée dans ce sentiment; la dépouiller de ses tableaux c’était une offense à la majesté des nations (201). »
Hélas ! ce fut la dernière fierté de l'Italie. La peste de l’envie, s'étendant de France en Europe, la corrompra, elle plus que toute autre nation. Les Sardes, rongés par cette passion basse, voudront s'approprier toute la péninsule. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de la danse de la Mort pour les nations. La Mort a un rire sardonique, un rire qui cache une douleur. Chose singulière, cette locution vient de la Sardaigne, et elle se trouve déjà dans Homère (202). On prétend qu'il y avait chez les Sardes une certaine fête de l'année où ils immolaient non seulement leurs prisonniers de guerre, mais aussi leurs vieillards qui franchissaient soixante ans, et ces malheureux étaient obligés de rire à cette horrible cérémonie; d'où l'on a appelé ris sardonien tout ris qui ne passe pas le bout des lèvres, et qui cache une douleur véritable (203). A la fin du XIXe siècle, l'Etat sarde se chargera de rajeunir cette locution très ancienne. La Mort, dans sa danse macabre, invitera les petits Etats, duchés et principautés de la noble Italie, à danser en Sardaigne, et duchés et principautés, obligés de rire, auront le bonheur de former un grand royaume sardonien !
L'envie, pourriture des os, selon l'énergique expression du livre des Proverbes, n'aura que trop pourri l'Europe elle-même.
II
En face de ce mal qui ronge et décompose, voici que sort de ses quartiers à part, de ses appartements privés, la fraternité juive.
Fort célèbre en tous temps, elle était, toutefois, assez peu redoutable. Elle va le devenir, l'envie lui en offre l'occasion. Expliquons cette célébrité, son passé inoffensif, son avenir menaçant.
La fraternité, chez le peuple d'Israël, est la cause seconde de sa conservation, la cause première en est un miracle. Dispersés sur toutes les plages du monde, balayés comme les feuilles d'un arbre après la tempête, les enfants de ce peuple néanmoins se conservent, persistent dans l'existence, traversent siècles et nations sans se confondre, sans faiblir, sans rien perdre de leur puissante vitalité, et presque en se riant des efforts qu'on a tentés maintes fois pour les anéantir. Une si prodigieuse durée ne s'explique à fond que par un miracle. Dieu les conserve, parce que sa justice en a besoin pour les léguer plus tard à sa miséricorde. Il les conservé avec autant de facilité qu'il conserva leurs vêtements et leurs chaussures dans les déserts de l'Arabie, lorsqu'ils y marchèrent durant quarante années avant que d'entrer dans la Terre promise. « Voici la quarantième année, leur disait Moïse, et cependant les habits dont vous êtes couverts ne se sont point rompus par la longueur de ce temps, ni les souliers que vous avez aux pieds ne se sont point usés (204). » Eh bien, comme Dieu avait dit à leurs vêtements dans le désert: « Vous ne vous userez pas », il a dit de même, depuis la grande dispersion, à leur existence: « Vous ne vieillirez pas »; et ils continuent d'exister quand tout le reste meurt. La cause première de la conservation du peuple juif est donc, évidemment, un miracle.
Mais elle a comme cause seconde l'union fraternelle. Ses enfants se tiennent entre eux comme se tiennent les ondes indissolubles d'un fleuve qui peuvent bien, devant un obstacle, disparaître un instant sous terre, mais qui reparaissent à un autre endroit, toujours vivaces et bruyantes. Ils n'ont plus leur Temple, plus de généalogies, plus de princes, plus rien de leur splendeur palestinienne, sauf une chose: l'union que, sous la forme de douze tribus, Jacob leur avait recommandée à son lit de mort. Autrefois, quiconque attaquait une tribu avait les onze autres sur les bras. Aujourd'hui encore, qui attaque un juif fait crier tous les autres. Ils se soutiennent se connaissent, s'appellent d'un bout de la terre à l'autre. Pascal a dit. C'est un peuple tout composé de frères. Avant Pascal, le Livre dont ils sont porteurs leur avait inculqué cette forte maxime: Un frère qui est aidé par son frère, c'est une citadelle; et leurs entreprises sont comme les verrous, les barres de fer, des portes des villes (205). En quittant les villes de leur Palestine, il semble qu'ils en aient emporté les barres de fer et les verrous autour de leur fraternité.
Et cependant, si célèbre, si robuste fut-elle, cette fraternité juive, durant tout le Moyen Age, ne fut pas extrêmement redoutable.
Pourquoi donc ?
Parce qu'elle avait, pour lui répondre et la neutraliser, la fraternité des peuples catholiques.
Qu'elle était riante et forte, cette fraternité catholique lorsque, partant du Sauveur remonté aux cieux, elle reliait d'abord toutes les jointures de l'Eglise, puis, sous l'action de l'Eglise, tous les peuples chrétiens, et les faisait triompher des difficultés multiples de cette époque, et des misérables intrigues de la rivalité judaïque qui ne s'est jamais reposée ! A elle s'appliquaient les bénédictions du cantique de « l'union des frères » composé par David: Ah ! que c'est une chose bonne et agréable que les frères soient unis ensemble ! C'est comme le parfum répandu... C'est comme la rosée qui descend... C'est là que le Seigneur a répandu sa bénédiction et une très longue vie (206).
La joie et la vigueur, exprimées par le parfum et la rosée, s'étendaient partout, avec l'union des frères:
Joie et vigueur au village. — C'était si beau, un jour de dimanche, de rencontrer tout un village se rendant à son église, le vieillard cheminant d'un pas gai, le jeune mari ayant à son bras sa compagne, les enfants et les petits-enfants portant à Dieu leur forte et naïve santé; tous annonçant au dehors, du front chauve au front vierge, la sérénité, la fierté la possession de soi-même en Dieu, la sécurité de la conscience, et pas l'ombre de regret, ni d'envie !
Joie et vigueur dans la corporation. — La corporation se voyait partout. Nul n'était seul. Chacun avait quelque part sa place, son pouvoir et son honneur. Chaque métier formait un petit corps à part, ayant sa caisse, ses statuts, ses chefs et son saint patron.
Joie et vigueur au château, dans la cabane, entre le château et la cabane. — Le château protégeait la cabane, et l'homme de la cabane souriait à l'homme du château. Quand il y avait conflit, abus, injustice, le roi de France apparaissait, rapproché davantage de la cabane que du château. Peu à peu, l'homme de corvée et de peine était monté au rang de l’homme libre, et en l'an 1315, le roi de France pouvait prononcer cette parole, admirable de rapprochement fraternel: « Qu'il y a un royaume des Francs où toutes les servitudes ont été ramenées à franchises. »
Joie et vigueur dans la chevalerie. — C'étaient Du Guesclin, Bayard, Tancrède, Godefroy de Bouillon: hommes de guerre qui se montraient attendris par l'amour de Dieu, par l'amour délicat né de l'élévation où la femme chrétienne était montée, et par l'amour du pauvre et du faible. La loi de la chevalerie ordonnait: « D'être droit et loyal, de garder les pauvres gens et les faibles pour que les riches et les forts ne les pussent honnir et fouler, d'aider de son pouvoir dames et damoiselles qui doivent toujours être honorées et défendues ».
Joie et vigueur dans la cité. — Quel riant tableau que celui d'une ville, prise au hasard dans le siècle de saint Louis. « A Strasbourg, par exemple, l'évêque, de l'aveu des chanoines et des bourgeois, choisit parmi les habitants un prévôt, qui rend la justice sur la place publique et perçoit les amendes, un burgrave, qui entretient les murs d'enceinte, la propreté et l'alignement des rues, et règle tout conflit entre les ouvriers, un péager, chargé des routes, des ponts des mesures toutes marquées d'un fer chaud, enfin un monnayeur, frappant bonne monnaie et punissant les faussaires. Les simples bourgeois en sont quittes pour cinq jours de corvée par an, les corps de métiers, pour quelque services équivalents. De temps en temps, les pêcheurs donnent un coup de filet pour la table de l'évêque; les charpentiers, un coup de hache, si son toit s'endommage; les cabaretiers, toutes les semaines, un coup de balai à sa maison, et les pelletiers vont, à ses risques et périls, lui acheter des fourrures à Cologne. En échange, sécurité pour tous; point de service militaire hors des murs. Cette ville, comme les autres, met son honneur à être un séjour de paix et un asile inviolable, hormis pour les voleurs (207). »
Joie et vigueur dans le royaume. — C'était le temps du sacre, qui était « la grande affaire » du pouvoir, puisqu'il lui conciliait le respect, la fidélité et l'amour. « En ce temps-là, le peuple pardonnait des fautes au prince, comme l'enfant pardonne des faiblesses à son père; il compatissait au levain de l'humanité demeuré en lui aussi bien que dans le dernier des mortels. Le souverain avait foi dans son peuple, et le peuple avait foi dans son souverain. Ils croyaient l'un à l'autre; ils s'étaient donné la main, non pour un jour, mais devant Dieu et pour tous les siècles, au nom des morts et des vivants, au nom des ancêtres et de la postérité. Le prince descendait tranquille dans la tombe, laissant ses enfants à la garde de son peuple, et le peuple, les voyant petits et sans forces, les gardait en attendant d'être gardé par eux (208). »
Joie et vigueur dans la chrétienté. — Belle et imposante dénomination que celle de chrétienté: elle signifiait l'union fraternelle des nations qui avaient reconnu le Christ et formaient la garde et le rempart de son Eglise. Chaque nation chrétienne avait son rang marqué dans la garde; et chacune avait ses étendards, ses enseignes et ses couleurs. Toutes ensemble, elles rappelaient le fameux carré que les douze tribus d'Israël formaient lorsqu'elles étaient en marche dans le désert, autour de l'Arche d'alliance.
Il est célèbre dans l'histoire, le carré macédonien. C'est par lui qu'Alexandre vint à bout de toutes les innombrables armées de l'Asie. Celui que formaient les douze tribus d'Israël autour du Tabernacle ne l'est pas moins; c'est son aspect qui enthousiasma Balaam lorsqu'il s'écria, au lieu de maudire Israël: Que tes pavillons sont beaux, ô Jacob; que tes tentes sont belles, ô Israël ! Mais ces phalanges antiques ne valaient pas, à beaucoup près, la chrétienté, qu'on peut surnommer le carré catholique. Quatre nations, en effet, fort[es] comme une rangée en bataille à quatre aspects, autour de l'Eglise: la France, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, l'Italie. L'Eglise, sans doute, était visible et répandue partout, mais particulièrement au milieu de ces quatre nations qui la protégeaient et composaient son carré de défense, son quadrilatère inexpugnable.
La France avec ses Charles Martel, ses saint Louis, repoussant les Sarrasins;
L'Espagne avec son Cid Campéador, repoussant les Maures;
L'Italie avec ses fières républiques de Gênes, de Pise, de Florence, de Venise, repoussant les pirates qui infestaient les mers;
L'Autriche-Hongrie avec ses don Juan, ses Jean Hunyade et ses Mathias Corvin, repoussant l'islamisme
Tel était l'incomparable carré catholique, contre lequel toutes les forces du monde venaient extérieurement se briser, en même temps que toutes les portes de l'Enfer venaient, à l'intérieur du carré, se briser contre la chaire de Pierre !
Voilà comment se présentait, avec sa vigueur et sa joie, avec sa rosée et son parfum, la superbe fraternité catholique étendant sa floraison au village, au château, dans la cabane, dans la corporation, dans la chevalerie, dans la cité, dans le royaume, dans la chrétienté, partout, partout. En vérité, si compacte et si répandue que fût la fraternité juive, elle eût été bien téméraire d'oser se mesurer avec la fraternité des peuples catholiques: autant une armée de souris qui eût entrepris de ronger les Alpes !
Mais à présent que l'envie est en train de pourrir l'Europe la fraternité juive aura cette audace, et beau jeu.
III
En effet:
Qu'on observe, avant tout, qu'en vertu des principes modernes, cette fraternité juive se trouve introduite, implantée, enracinée dans le sein même de la société européenne, alors qu'autrefois elle n'était campée que sur ses flancs, en dehors d'elle.
A peine y est-elle installée, que se produisent ces deux étranges phénomènes: la fraternité européenne se dissout, tandis que la juive se corrobore.
L'une se dissout:
Dans ce sein social qui s'est ouvert à la fraternité juive, qu'aperçoit-on ? l'envie qui détruit, émiette, pourrit l'antique fraternité française et européenne, l'atteignant dans sa vigueur, dans sa joie, dans ses variétés, du haut en bas du corps social. Soufflant d'en bas, l'envie apporte l'anarchie; soufflant d'en haut, elle apporte le despotisme; les deux souffles procèdent de l'irréligion. Sous leurs atteintes meurtrières va être fauchée, comme par la faux de la mort, la magnifique floraison que nous admirions tout à l'heure. Reprenons-la en sens inverse:
Plus de chrétienté, de nations-sœurs. — Désormais, les nations ne comptent que sur la force pour se conserver; et, les armées nombreuses ne suffisant pas pour atteindre ce but, les peuples entiers seront contraints de descendre en champ clos. La paix se rattachera au fragile système de l'équilibre, emprunté aux poids d'un marchand, et qui remplace le doux nom de chrétienté.
Plus de royaume. — La France était une ruche; que devient-elle ? Tantôt un empire où il n'y a que des soldats et des chevaux, tantôt une monarchie bâtarde avec des frelons au lieu d'abeilles, tantôt une république avec des loups ou des renards, tantôt un antre maçonnique aux complots de tigres. La pauvre France subit toutes ces transformations, sans retrouver la concorde entre frères.
Plus de provinces. — « On a supprimé les anciennes provinces on a découpé géométriquement la France comme un damier, et dans ces cadres improvisés, on n'a laissé subsister que des individus isolés et juxtaposés (209). » La haute raison d'un Monnier eut beau prédire le danger de dissoudre ces groupes formés par le temps: contre la province qui représentait des intérêts généraux se rua la poussée formidable des intérêts particuliers. L'Assemblée constituante connut et excita ces convoitises (210).
Plus de corporations. — La fameuse (et pour parler plus justement), l'odieuse loi du 24 juin 1791 a brisé les corporations françaises. Cette loi de la Constituante, dans son article 2, en faisant défense aux artisans, aux patrons, aux ouvriers de se réunir à l'avenir, de délibérer sur leurs intérêts communs, de se nommer des syndics, des présidents, des secrétaires, a inauguré le régime de l'individualisme si improprement appelé le régime de la liberté du travail. Avec Napoléon, le Code pénal a sanctionné cette législation dans son article 416, qui punit les tentatives d'union de l'amende et de l'emprisonnement. Quoi qu'on fasse plus tard, les florissantes corporations ont vécu.
Plus de chevalerie. — L'Empereur a institué, en 1802, la Légion d'honneur, qui récompense les services militaires, les talents distingués, et même les vertus. Mais cette institution n'est plus un Ordre de fraternité qui impose à ses membres l'obligation de servir et de secourir les petits et les faibles, comme le faisait la vraie Chevalerie. La croix reste le signe de l'honneur sur la poitrine des braves, mais elle n'est plus le signe de l'amour: c'est une chevalerie qui n'exige plus des sentiments chevaleresques.
Plus de rapprochement sympathique entre les classes, entre la cabane et le château. — La division des fortunes, rendue obligatoire par la loi sur les successions, a diminué la distance qui séparait le pauvre du riche; mais, en se rapprochant, ils semblent avoir trouvé des raisons nouvelles de se haïr, et jettent l'un sur l'autre des regards pleins de terreur et d'envie.
Plus de cité. — Jamais les maisons n'ont été mieux alignées, ni les rues mieux percées; mais la confiance et la concorde y sont absentes, même la simple connaissance qu'on se doit entre enfants d'une même cité. Un écrivain autorisé a dit de Paris, et on peut le dire de beaucoup d'autres villes de France et d'Europe: « C'est une vaste fourmilière qui travaille, consomme, s'amuse, sans aucun lien commun. On habite le même quartier, la même maison, et l'on n'a aucun rapport; on se rencontre, on ne se connaît pas; rien qui réunisse... (211) »
Plus de demeures, de foyers. — « Dans notre société agitée et changeante, plus semblable, sous ses brillants dehors de luxe et de plaisir, à une tribu nomade qu'à un peuple de familles unies dans une patrie commune, on se fait facilement à l'idée de n'avoir pas de maison et d'habiter là où l'on se trouve, sans lien parce qu'on est sans affection, sans maison parce qu'on est sans famille, et bientôt sans patrie, parce qu'on est sans souvenirs et sans espérances (212) » Autrefois, le foyer, dans la chaumière aussi bien que dans la maison somptueuse, était le centre de tout: de la lumière qui brille, de la chaleur qui ranime, de la nourriture qui soutient, de la conversation où l'on s'épanche, de la famille qu'il constitue en quelque sorte, tant il s'identifie avec elle. Autrefois, quand les mœurs étaient simples, et la foi, naïve, c'était une manière touchante de compter les familles que de les compter par les feux... Aujourd'hui, les feux s'éteignent !...
Et voilà !
Belle fraternité française, belle fraternité européenne, qu'êtes-vous devenues ? Oh ! sans doute, la fraternité catholique subsiste, circule, fait ses œuvres; mais celle qui s'était infusée dans les institutions nationales et européennes, qui en était la vigueur et la joie, celle-là a disparu. L'envie a plissé tous les fronts, et allumé tous les yeux...
« L'Europe n'existe plus », sera contraint de dire, au milieu de ce siècle, un diplomate célèbre (213).
Or, en venant s'installer au sein d'une société ainsi appauvrie d'unité et d'amour, la fraternité juive ne deviendra-t-elle pas redoutable par le fait seul de ce qu'elle est et de ce qu'elle rencontre. Plus de traditions autour d'elle, et elle est une tradition; plus de corporations, et elle est une corporation; plus d'ententes, et elle est une entente; plus de buts, et elle a un but. Cela ne veut pas dire que la fraternité juive n'ait pas aussi ses défectuosités, ses petits côtés; que ses membres ne soient pas accessibles, comme ailleurs, à la jalousie, à l'envie, à l'animosité, à la haine entre eux: elle est défectueuse, très défectueuse, on l'accorde; mais elle est organisée pour résister. Elle voudrait se dissoudre qu'elle ne le pourrait pas: là est le miracle de conservation. Ses membres sont enclavés dans un vieux sillon qui remonte jusqu'aux flancs d'Abraham dans lesquels ils ont tous dormi; dès qu'ils naissent, ils sont introduits, engagés, dans le vieux sillon, et par la suite, fût-on de médiocre intelligence ou d'infime condition, on devient fort et on se tire d'affaire par le vieux sillon. Ils marchent là où leurs pères de dix, de vingt, de quarante siècles ont marché, héritiers de leurs pensées, de leurs secrets, de leurs espérances, de leurs précautions: ils sont forts ! Isaïe ne s'est pas trompé lorsqu'il désignait Abraham, en ces termes, à ses descendants: La roche dont vous avez été taillés, la carrière profonde dont vous avez été tirés (214). Or, voici que la roche, le bloc qu'ils ont formé à leur tour, se retrouve, après quatre mille ans, intact et redoutable au milieu d'une société pulvérisée. Comment la France et, ensuite, l'Europe n'ont-elles pas compris qu'en supprimant dans leur sein traditions nationales, provinces, corporations, associations, elles allaient préparer, à ce bloc, un poids prépondérant ?
Il s'est passé, durant la tenue du Sanhédrin de 1807, un petit fait qui provoqua justement l'admiration d'un des commissaires de l'Empereur; que n'a-t-il provoqué simultanément un appel à la prudence ? Ce commissaire le raconte ainsi dans ses Mémoires:
« A la suite d'une des conférences où M. Molé avait été plus amer encore que de coutume et où je m'étais efforcé de détruire le mauvais effet de quelques-unes de ses paroles, plusieurs d'entre les israélites vinrent me trouver le lendemain, et, ne sachant comment m'exprimer leur gratitude, ils finirent par m'assurer qu'avant qu'il fût six mois, il n'y aurait pas jusqu'à leurs frères de la Chine qui ne sussent ce que tous les juifs me devaient de reconnaissance pour le bien que je leur voulais faire, et pour l'excellence de mes procédés envers eux. Cette phrase m'a toujours semblé fort remarquable en ce qu'elle manifeste jusqu'à quel point ces hommes répandus sur la surface du monde, à distances si grandes, vivant sous des cieux si différents, et au milieu de mœurs dissemblables, conservent des rapports entre eux, s'identifient aux intérêts les uns des autres et sont animés d'un même esprit.
« Il nous fut affirmé, de manière que nous n'en puissions douter, que, lorsqu'un juif sans ressources personnelles avait une affaire pressante à suivre à une grande distance du lieu qu'il habitait, il pouvait se présenter chez le Rabbin ou chez le principal personnage de la Communauté juive, et que, sur l'exposé de ses besoins, un certificat lui était délivré à l'aide duquel il pouvait traverser l'Europe jusqu'aux extrémités de l'Asie, accueilli et défrayé par les juifs qui, de distance en distance, se trouvaient sur son passage, et qui partout le traitaient, non en pauvre qui arrache à la pitié un léger secours, mais en frère avec lequel on partage ce qu'on a (215). »
Eh bien, en face du bloc d'une pareille fraternité introduit dans la société française, qu'est-ce que la Révolution et l'Empire alignaient dans les Français ?
Un publiciste peu suspect répond:
« Une poussière d'individus désagrégés (216), des nains chétifs (217). »
C'était déjà trop.
Mais la fatalité révolutionnaire n'a-t-elle pas encore entraîné Napoléon à conférer à la fraternité hébraïque la consécration civile que voici ?
IV
Revenons au décret organisateur du culte juif, daté du palais des Tuileries, le 17 mars 1808.
Ce décret a établi qu'il y aurait non seulement une Synagogue, mais encore un Consistoire, c'est-à-dire un conseil de Notables, dans chaque département qui contiendrait un nombre suffisant d'israélites.
Un nouveau décret, daté du camp impérial de Madrid, le 11 décembre 1808, installe treize synagogues juives dans l'Empire, et conséquemment treize consistoires.
Les sièges des synagogues et de leurs consistoires sont à cette époque: Paris, Strasbourg, Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Créveld, Bordeaux, Marseille, Turin, Casal.
Il résulte du tableau de circonscription des synagogues, inséré au Bulletin des Lois, que le nombre total de la population juive française, telle qu'elle se composait à cette époque, était de 77.162 individus.
Cela fait donc près de quatre-vingt mille juifs solidement établis dans treize circonscriptions.
De plus, un Consistoire central de tous les israélites de France a été placé à Paris, dans le but d'entretenir des relations régulières avec le Gouvernement et avec les consistoires des différentes circonscriptions.
Un décret spécial, daté du palais de Saint-Cloud, le 19 octobre 1808, a réglé ainsi son installation:
NAPOLÉON, empereur des Français, roi d'Italie, et protecteur de la confédération du Rhin.
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. — Les Membres du Consistoire central des juifs établi dans notre bonne ville de Paris seront installés par notre conseiller d'Etat, préfet du département de la Seine, entre les mains duquel ils prêteront, sur la Bible, le serment prescrit par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X.
ART. II. — Notre ministre des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.
Signé: NAPOLEON.
Par l'Empereur, Le ministre, secrétaire d'Etat,
Signé: HUGUES B. MARET
Voilà donc une sorte de capitale juive installée dans la première capitale du monde, pour commander à des circonscriptions dont le nombre ira bien vite en augmentant.
Dotée d'une capitale, retrouvant Jérusalem en France, selon le mot de Napoléon, la fraternité juive acquerra une importance qu'il sera difficile de nier.
Elle ne possède plus seulement l'autonomie et la durée, qu'elle tient du dessein de l'Eternel, elle possède maintenant une organisation civile, qu'elle tient de la législation française: une organisation prise sur le vif du territoire. L'Empereur l'a assise, comme un canon trouvé à terre, sur un affût. Tandis que se prononcera de plus en plus la désagrégation des autres corporations et associations, la corporation juive se fortifiera, bénéficiant et de la durée que lui apporte le temps, et de la cohésion nouvelle que lui a apportée la législation, et aussi des complaisances que lui apporteront les gouvernements et les ministères qui vont se succéder. Le Consistoire central, comme un grand phare lumineux entretenu par la Fortune, projettera ces complaisances gouvernementales et ministérielles sur toutes les circonscriptions d’israélites. Ministre d'Etat, ministre des Cultes, ministre des Finances, ministre de la Justice, ministre de la Guerre, se feront les veilleurs des intérêts d'Israël. Quel appoint à la vieille corporation venue de Palestine ! Autrefois, elle se dépeignait elle-même ainsi: « Le plus déguenillé acheteur de vieux chapeaux ou marchand d'oranges de la juiverie est très sûr d'obtenir les moyens de célébrer dignement la fête de Pâques. Le plus tombé dans son commerce ne l'est pas aux yeux de ses coreligionnaires; il se relève par leurs coups de main. Le plus pauvre possède peut-être des qualités qui le placent haut dans leur estime; et beaucoup des plus misérables et des plus sales Hébreux qui parcourent les rues, achetant des vieux habits et des peaux, sont connus dans la communauté comme sachant par cœur de grandes parties de l'Ecriture sainte (218). »
Et maintenant, voici la différence:
De guenilleuse qu'elle se trouvait elle-même, en beaucoup de ses membres, la fraternité juive a le droit de dire: les lois de France forment mon piédestal, et les ministres de l'Etat brûlent devant moi leur encens !
En vérité, il y a quelque chose de très étrange dans la désagrégation européenne, d'une part, et la cohésion israélite, de l'autre. On serait tenté de croire que les rôles vont s'intervertir. Les nations étaient les rassemblées, et les juifs, les dispersés. A voir la ruine des royaumes, des traditions, des mœurs, des corporations, des familles, des fortunes, des foyers, on se demande tout bas: les nations ne deviennent-elles pas les dispersées ? A voir, au contraire, l'arrivée des juifs par toutes les avenues, leur marche vers les sommets, la concentration des ressources entre leurs mains, l'aide, voulue ou non voulue, des révolutions et des empires dans leur récapitulation extraordinaire, on se demande non moins bas: Ne sont-ce pas les légendaires dispersés des siècles et des espaces qui sont en train de devenir les rassemblés ? D'un côté comme de l'autre, quel mystère dans ce que prépare la Providence !
Mais poursuivons le récit des surprises historiques.
V
Autre mesure de Napoléon qui, dictée par de très sages motifs, va tourner à l'aigre, en résultats contraires, selon l'ironie de la Révolution. Cette mesure est le décret qui vient obliger tous les juifs à prendre des noms de famille, des noms nouveaux.
C'était un usage au sein des communautés juives, usage apporté de l'Orient, de n'avoir aucun nom patronymique ou de famille. Dans les premiers âges du monde, les noms de famille étaient inconnus. Chaque individu n'avait qu'un seul nom, ordinairement significatif, et ne se distinguait de ses homonymes qu'en ajoutant à son nom: fils d'un tel. Stationnaires sur la route des siècles, les juifs continuaient, dans tous les endroits où ils étaient dispersés, cette manière de se nommer. Tirant leurs noms de leur vieux Testament, ils s'appelaient, chacun pour son compte, ou Jacob, ou Nathan, ou Moïse, ou Salomon, etc., ajoutant pour se distinguer des autres Jacob, des autres Nathan, Moïse et Salomon, la locution: fils d'un tel; Jacob fils de Baruch, qui à son tour est fils de Samuel, qui à son tour est fils de Jonas. Toutefois il leur arrivait fréquemment de remplacer l'embarrassante formule orientale par le nom de la ville ou du village qu'ils habitaient, et alors ils se nommaient: Samuel de Francfort, David de Carcassonne, Abraham de Worms, Nathan de Lisbonne.
D'assez graves inconvénients s'étaient rattachés et à l'absence, parmi eux, de noms patronymiques, et à leur unique source de noms, la Bible. Le nombre des dénominations fournies par l'Ancien Testament étant nécessairement très restreint, il en résultait une grande confusion dans la désignation des individus, et, conséquemment, une foule de méprises dans les affaires de commerce. De là aussi, pour les fils d'Israël, la facilité de changer de nom; et, comme s'en plaignent les rapports présentés à l'Empereur, ils en changeaient toutes les fois qu'ils y trouvaient leur commodité, leurs avantages, ou qu'ils changeaient de villes. Bref, cette manière de se nommer fournissait trop souvent la tentation des taillis où les lièvres disparaissent !
Un décret impérial parut, daté de Bayonne; le 20 juillet 1808. Il enjoignait à tous les juifs de l'Empire:
De prendre: Un nom patronymique ou de famille; Un prénom fixe.
Défense leur était faite de choisir pour nom de famille un nom de l'Ecriture sainte ou un nom de ville (219). Alors se produisit une singulière efflorescence:
Pour la formation des noms de famille, les noms de la Bible furent défigurés, torturés, allongés, rétrécis. Exemples:
Moïse donna Mosches, Moche, Manche, Manché;
Lévi donna Lœwy, Lévilliers, Ludwig, Lévisthal, Halévy;
Abraham donna Brahm; Israël, Disraéli; Ephraïm, Ephrussi.
On eut recours également, comme sources de noms de famille, à l'astronomie, à la botanique, à la géographie, à la zoologie. Un spirituel nomenclateur dit:
Il y eut le juif astronomique: Stern, étoile; Goldstern, étoile d'or; Morgenstern, étoile du matin; Abendstern, étoile du soir; Mondschein, clair de lune.
Il y eut le juif botanique: Rosenzweig, branche de roses; Blum, fleur; Kornblüth, fleur des blés, bluet; Rosenthal, val des roses.
Il y eut le juif géographique: Crémieux, Carcassonne, Worms, Lisbonne, Cherleville. Car on tint peu compte à la longue de l'article du décret impérial qui défendait de choisir pour nom de famille un nom de ville.
Il y eut le juif zoologique: Beer, ours, avec ses petits. Meyerbeer, Cerfbeer; Wolf, loup; Katz, chat; Hirsch, cerf; Hahn, coq; Ganserl, petite oie.
La plupart de ces noms, ainsi qu'on le voit, étaient extraits de l'allemand, parce que le plus grand nombre des israélites de l'Empire peuplaient l'Alsace, la Lorraine et les pays limitrophes.
Tout cela constitue le côté plaisant de cette transformation; mais voici le côté grave:
L'acte de Napoléon, très utile incontestablement, si l'on ne considère que les affaires de commerce, n'allait-il pas devenir une fausse mesure, eu égard à des intérêts majeurs ?
N'était-ce pas, en effet, une chose grave, excessivement grave, que de conférer à tout un peuple d'émancipés, des noms nouveaux ? Avec la collation des droits civils, on achevait, par là, de les rappeler à une vie d'un inconnu redoutable. On leur livrait les langues des peuples et des pays, au sein desquels ils entraient. Franciser, germaniser, anglicaniser, italianiser les noms juifs, c'était introduire les Hébreux dans le plus intime des nations: qu'y a-t-il de plus intime que les noms ? Deux périls allaient s'ensuivre:
D'abord, en les invitant à franciser, germaniser, italianiser leurs noms, Napoléon supprimait le plus sûr rempart de la patrie française, et des autres patries. Le nom est non seulement un patrimoine, mais un rempart. Durant dix-huit siècles, les peuples chrétiens avaient dit au peuple juif: Chez toi, tes enfants se nomment de telle manière; chez nous, nos enfants se nomment de telle autre manière. Garde tes noms et nous gardons les nôtres.
C'était vraiment une ligne de démarcation, une ligne de défense;
Napoléon l'a abandonnée.
En s'infiltrant dans les noms comme une eau du Jourdain, ils vont encore, par là, contribuer à la désagrégation de la famille européenne: la pauvre fraternité des peuples n'avait pas besoin de cela !
Autre péril, connexe au précédent. En les invitant à se parer de noms nouveaux, Napoléon allait leur rendre plus aisés l'assaut et l'envahissement des dignités, des hautes fonctions, du pouvoir. S'ils eussent continué à s'appeler simplement Jacob, Tobie, Israël, Baruch, Moïse, ils eussent été plus timides à se présenter, à traverser les rangs de la société qui les accueillait, pour monter vers les sommets. Ils se fussent bornés à s'asseoir dans les environs de la dernière place, au lieu de viser à la première. Un Israël n'eût jamais été Premier ministre en Angleterre, un Disraéli le deviendra. Baruch ou Tobis n'eussent jamais osé, en France, briguer le portefeuille de la justice, Crémieux le prendra. A la faveur de leurs noms nouveaux, comme jadis les Romains sous le couvert de ces armures de siège nommées tortues, ils pourront plus facilement monter à l'échelle, envahir, occuper. Comment l'Empereur n'a-t-il pas compris le danger de noms nouveaux chez les juifs, lui qui, pour neutraliser, affaiblir l'ancienne noblesse monarchique, avait créé une noblesse impériale, lui donnant les noms de ses victoires ? En vérité, toucher aux noms n'est pas chose indifférente. Celui qui écrit ces réflexions n'oubliera jamais l'impression qu'il ressentit lorsque, sous Napoléon III, dans le fameux procès intenté à Talleyrand-Périgord pour l'empêcher de recevoir de l'Empereur le nom de Montmorency qui allait s'éteindre, Berryer qualifia l'usurpation de ces mots: Prendre le nom de Montmorency, c'est comme si on prenait les diamants de la Couronne ! A défaut des beaux noms de France, des blasons et des armoiries, les nouveaux citoyens fournis par la Judée acquerront les châteaux et les domaines; et dans cette substitution, la fausse mesure de Napoléon ne les aura que trop servis.
N'eût-il pas été plus prudent de les laisser se nommer comme ils se nommaient par le passé, au risque de voir des effets de commerce quelquefois compromis ? Un désastre plus considérable n'eût pas été ajouté à l'émiettement de la société chrétienne.
VI
Voilà donc les israélites organisés pour intervenir et parvenir, pour acquérir et conquérir.
Est-ce le fait de leur ingérence ?
Assurément non !
La Constituante les avait affranchis; mais eux, en lièvres peureux, demeuraient blottis dans leurs terriers, leurs quartiers à part. Napoléon les en a rudement tirés et, par des noms nouveaux, les a transformés en des apparences de loups (Wolf), de chats (Katz), d'ours (Beer), de lions (Löwe), jusqu'au jour où ils se transformeront eux-mêmes en barons, en ingénieurs, en généraux, en ministres. Il a rendu à leur culte un lustre public et lui a prêté l'appui du gouvernement, traitant la Synagogue presque en égale de l'Eglise. Il a étayé leur antique et solide confraternité du double contrefort des consistoires provinciaux et du Consistoire central, triplant ainsi la force de cette confraternité. Les israélites n'ont eu qu'à accepter ses dons, en exécutant ses ordres. L'organisation de leur prépondérance, jusque-là, a été à peu prés passive.
Où commencera leur coopération ? où se réveille leur ingérence ?
Avec les passions !
Il y a deux grandes forces ici-bas, à l'aide desquelles on acquiert la puissance: les idées et les passions.
Les idées ont formé la genèse de la puissance juive, idées de la Révolution mises ensuite à exécution et traduites en institutions à leur égard par Napoléon: car, comme l'a dit fort judicieusement Mme de Staël, il a été la Révolution à cheval. L'Empereur a consolidé, enrégimenté, encaserné les juifs, leurs droits, leurs synagogues, leurs rabbins, leurs consistoires, en vertu des idées d'égalité, de liberté de conscience, de liberté des cultes, principes de la Révolution.
Les idées ont donc commencé la puissance juive, mais c'est à l'aide des passions qu'ils vont, eux-mêmes, la développer.
Durant les siècles où ils ont été tenus à l'écart, les juifs n'ont eu aucune action par les idées, mais bien par les passions. Au moyen de l'or ou de la beauté, ils flattaient, encourageaient les penchants dangereux de celui-ci, de celui-là, d'un puissant monarque, d'un pauvre paysan, et par là se les asservissaient dans une certaine mesure.
Avec l'ère de la Révolution qui s'est ouverte, leur puissance va devenir formidable, parce que, cette fois, non plus seulement les passions, mais les idées deviennent leurs forces; et non plus seulement auprès d'individus isolés, mais aussi auprès des foules et des gouvernements.
Les idées de la Révolution ont fait leurs affaires sans qu'ils aient eu besoin de beaucoup se remuer depuis 1791, année de leur émancipation, jusqu'en 1808, année du dernier décret de l'Empereur en leur faveur. Mais à partir de ce moment, installés comme citoyens et, en quelque sorte, habillés de neuf par Napoléon, ils vont se mouvoir et opérer. Et comme malheureusement, beaucoup n'ont pas changé dans leur for intérieur (et comment changer, abstraction faite, par les Gouvernements, de la religion chrétienne ?), ils vont recourir à leur vieux moyen d'influence, au procédé qui leur est familier: les passions.
Or, quelle est, entre toutes les passions, celle qui a préparé à leur activité, à leur rivalité, à leur besoin de domination, un champ d'opérations, un champ de manœuvres, où ils sont sûrs d'avoir toutes les chances, tous les succès, quelle est cette passion ? l'envie.
Nous avons vu la funeste infiltration de l'envie pourrissant la société française et européenne, et la rendant faible et poussiéreuse devant les forces vives et renouvelées de la confraternité juive.
Peut-être un remède se prépare-t-il dans l'avènement plus régulier des démocraties ?
Oui vraiment, il y a là un remède, si ces démocraties savent reprendre, mieux que ne l'a fait l'Empire, le chemin de l'Eglise catholique, du royaume de Dieu, où elles retrouveraient la belle fraternité des anciens jours, laquelle réduirait bien vite la juive au silence.
Mais si les démocraties veulent accomplir leurs destinées en dehors de l'Eglise, bien fin serait celui qui nous apprendrait ce qui pourra les soustraire à l'envie, et à sa lamentable conséquence de domination juive ?
En effet, les démocraties ne sont-elles pas exposées, plus que les autres formes de gouvernement, aux inconvénients de l'envie et de sa pourriture ? Qu'on médite ce qui suit:
« L'amour du bien-être est devenu le goût national et dominant; le grand courant des passions humaines porte de ce côté-là, il entraîne tout dans son cours.
« Toutes les conditions étant à peu près égales, chacun voit les mêmes chances de s'élever. Le sentiment démocratique de l'envie s'exprime, alors, de mille manières différentes.
« Dans les gouvernements aristocratiques, les hommes qui arrivent aux affaires sont des gens riches qui ne désirent que du pouvoir; dans les démocraties, les hommes d'Etat sont pauvres et ont leur fortune à faire. Il s'ensuit que, dans les Etats aristocratiques, les gouvernements sont peu accessibles à la corruption et n'ont qu'un goût très modéré pour l'argent, tandis que le contraire arrive chez les peuples démocratiques. »
A côté de ces réflexions si justes, l'écrivain loyal qui les a tracées a placé la suivante, sorte d'euphémisme libéral:
« Peut-être dans les démocraties, n'y a-t-il pas moins d'hommes à vendre, mais on n'y trouve presque point d'acheteurs; et, d'ailleurs, il faudrait acheter trop de monde à la fois pour atteindre le but. »
Dans ses vues généreuses sur les démocraties, M. de Tocqueville a certainement oublié les juifs « comme acheteurs ». et leurs moyens d'acheter « trop de monde à la fois (220) ! »
LIVRE TROISIEME Les Israélites triomphent de Napoléon
CHAPITRE PREMIER LA VOLTE-FACE DE NAPOLÉON CONTRE LES JUIFS
I. Le décret du 17 mars 1808 restrictif des droits civils des juifs. Emotion et colère dans les communautés juives. — II Clause au bas du décret: menace de sa prorogation au bout de dix ans. Rire d'un vieux coq. — III. Motifs de cette volte-face: ce n'est pas une rupture de la part de Napoléon, mais une mesure de discipline pour dompter le caractère juif. Preuves à l'appui.
— IV. Les juifs, eux, n'y voient qu'une rupture. Leur accusation contre Molé. Démarches de Furtado pour soustraire ses coreligionnaires aux mesures d'exception et de rigueur. Napoléon se montre inflexible. — V. Impassibilité au milieu des souffrances engendrées par l'application du décret: anecdote touchante.
I
La politique de Napoléon se plaisait aux coups de théâtre. Elle plaçait des heurts et des chocs à côté des bienfaits, pour mieux dompter. Elle achevait par les effets de la crainte, quand elle avait commencé par les attraits de la bonté, contrairement à ce qui se passe dans la religion du Seigneur.
Les Juifs en savent quelque chose.
Bien que ses procédés eussent été un peu brusques, Napoléon s'était montré très favorable à leur égard; de leur côté, ils lui avaient décerné volontiers les louanges attribuées, dans la Bible, au Messie. Tout à coup, l'Empereur opère une volte-face.
A la date du 17 mars 1808, avait paru au Bulletin des Lois un double décret qui organisait le culte israélite dans l'Empire et lui assignait sa place au soleil de la patrie française: mesure que nous avons exposée au chapitre IVe du livre précédent.
Or, ce décret n'était pas seul. Un autre l'accompagnait. Et voici que celui-là vient restreindre les droits civils des confiants Hébreux en train de savourer, en France, les facilités et les joies d'une nouvelle Terre promise: l'Empereur ne leur avait-il pas fait espérer, par l'entremise de son commissaire Molé, qu'ils retrouveraient Jérusalem dans la France ?
C'était, à la médaille messianique, un revers inattendu.
Ainsi qu'il arrive toutes les fois qu'on est atteint dans le vif de ses intérêts les plus chers, les juifs ne prêtèrent nulle attention au premier décret qui était un bienfait, et déchargèrent toute leur colère sur le second. Ils se mettent à pousser des cris de paons contre l'aigle.
Etait-ce donc, de la part de l'Empereur, un retour à l'offensive contre le judaïsme, une déclaration de guerre après des apparences de paix ?
Nous allons relater le fameux et exaspérant décret; après quoi, nous ferons connaître, toujours documents en mains, sa vraie signification dans la pensée de Napoléon.
Par ce décret, daté du palais des Tuileries, 17 mars 1808:
I. - a) LES PRÊTS FAITS PAR LES JUIFS A DES MINEURS, A DES FEMMES, A DESMILITAIRES, SONT DÉCLARÉS NULS.
Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes, sans l'autorisation de leur mari; à des militaires, sans l'autorisation de leur capitaine, si c'est un soldat ou sous-officier, du chef de corps, si c'est un officier: sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir, et nos tribunaux autoriser aucune action en poursuite.
b) LES PRÊTS FAITS A DES DOMESTIQUES, OU SUR DES INSTRUMENTS DE TRAVAIL, SONT ÉGALEMENT DÉCLARÉS NULS.
Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gage.
Les juifs ne pourront recevoir en gage les instruments, ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.
II. - LEURS CRÉANCES FRAUDULEUSES OU USURAIRES SONT ANNULÉES.
Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse, souscrit par un de nos sujets non commerçant, au profit d’un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.
Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée, par la cumulation d’intérêts à plus de cinq pour cent, sera réduite par nos tribunaux. Si l'intérêt réuni au capital excède dix pour cent, la créance sera déclarée usuraire, et, comme telle, annulée.
III. - LEUR NÉGOCE EST SUBORDONNÉ A DES CONDITIONS DE PROBITÉ ET A DES MESURES DE PRUDENCE.
Désormais nul juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du Préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises, et que sur un certificat: 1° du Conseil municipal constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite; 2° du consistoire de la synagogue, dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.
Cette patente sera renouvelée tous les ans
Nos procureurs généraux près nos Cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes par une décision spéciale de la Cour, toutes les fois qu'il sera à leur connaissance qu'un juif patenté fait l'usure ou se livre à un trafic frauduleux.
Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.
Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à d'autres personnes, qu'autant qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel certifiera, dans l'acte, que les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront en ce cas ordonner la restitution gratuite.
IV. - L ALSACE EST INTERDITE A DE NOUVEAUX JUIFS.
Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départements du Haut et du Bas-Rhin ne sera désormais admis à y prendre domicile.
V. - LES AUTRES DÉPARTEMENTS DE L’EMPIRE NE SERONT ACCESSIBLES AUX JUIFS QU’AUTANT QU’ILS Y SERONT EXCLUSIVEMENT AGRICULTEURS.
Aucun juif, non actuellement domicilié, ne sera admis à prendre domicile dans les autres départements de notre Empire, que dans le cas où il y aura fait l'acquisition d'une propriété rurale et se livrera à l'agriculture, sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic. Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d'une autorisation spéciale émanée de Nous.
VI. - TOUT JUIF CONSCRIT DEVRA FAIRE SON SERVICE MILITAIRE, SANS POUVOIR SE FAIRE REMPLACER.
La population juive, dans nos départements, ne sera point admise à fournir des remplaçants pour la conscription: en conséquence, tout juif conscrit sera assujetti au service personnel.
A la lecture de ce décret, toutes les communautés juives de France furent exaspérées. Il n'y eut qu'un cri. « Par cet odieux, par cet infâme décret du 17 mars 1808, nous sommes mis de nouveau hors la loi. Il fait revivre à notre égard quelques-unes des plus humiliantes dispositions des ordonnances du Moyen Age. Nous voilà replongés dans l'humiliation la plus profonde (221). »
Ce qui est vrai, c'est qu'après avoir reçu la plus éclatante protection qui leur eût été accordée dans aucun siècle, les juifs « éprouvaient tout à coup dans leur fortune et dans leur personne une violente secousse (222) ».
On disait tout bas de l'Empereur: « Il nous avait promis que nous serions citoyens sans restriction. Il a trompé le monde entier, il a confisqué partout la liberté. Comment aurait-il pu garder sa parole aux juifs (223) ? »
II
Au milieu des cris de fureur s'élevant, à la lecture du décret, dans l'intérieur des quartiers juifs, une oreille attentive eût discerné le rire d'un vieux coq, aïeul, par la vétusté de son arbre généalogique, de celui que la Fontaine a immortalisé:
Sur la branche d'un arbre était en sentinelle Un vieux coq adroit et matois. .............................. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire (224).
Et pourquoi ce rire entrecoupant tout à coup les cris de fureur ?
Au bas du décret, il y avait cette clause:
Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai, et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre Empire; sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l'exécution, pour tel temps qu'il sera jugé convenable.
Ainsi donc, après qu'elles auraient été expérimentées durant dix ans, les dispositions contenues dans le décret étaient susceptibles d'une prorogation illimitée, si l'attente de leurs bons résultats était trompée. Les juifs ont dû rire !
Dix ans ! c'était plus qu'il n'en fallait pour voir passer de la scène du monde le décret de l'Empereur et, peut-être, l'Empereur lui-même. Toute convention avec les fils d'Israël où l'on fait appel à la durée est presque toujours un marché ruineux pour l'autre partie contractante. Le temps n'a-t-il pas été compris dans leur bagage de colporteurs ?
Nos juifs, menacés par cette date de dix ans dans le décret du 17 mars, tenaient de leurs frères d'Orient l'histoire suivante, plus d'une fois arrivée en Perse et au Maroc:
Le Shah, en Perse (le Sultan, au Maroc), convoquait les juifs avec leurs rabbins. « Chiens que vous êtes, leur disait-il, je vous ai fait venir pour vous obliger à reconnaître Mahomet. Fixez un temps à la venue de votre Messie. Je patienterai jusqu'à cette époque. Ensuite, ou vous serez mahométans ou vous perdrez vos biens et la vie. » Les juifs, épouvantés, obtenaient huit jours pour méditer leur réponse. Après avoir conféré ensemble, ils venaient annoncer au Shah que leur grand Libérateur, si patiemment attendu, paraîtrait dans trente ans; et, à côté de la décision dogmatique, ils déposaient doucement deux millions en or (225).
Au bout des trente ans, le Shah avait les yeux fermés par la mort; ou, s'il vivait, une nouvelle somme venait, comme une infusion de pavots, les lui faire fermer sur la question dogmatique.
Assurément, pour endormir le tout-puissant et très énergique empereur des Français, il ne fallait point songer aux pavots, mais il restait, comme auxiliaire, le temps qui fane les lauriers et les décrets. Les juifs étaient assurés du temps. Voilà pourquoi au milieu des cris de colère que soulevait, au sein des juiveries, la lecture du décret du 17 mars 1808, leur vieux coq riait. Il riait devant la date de dix ans assignée par l'aigle à la prorogation de son décret, si ses espérances étaient trompées.
III
Nous connaissons le décret qualifié d’« infâme » et l'exaspération de la population juive. Allons maintenant au législateur.
Dans la pensée de l'Empereur, ce décret, avec la volte-face, était-il une rupture entre son gouvernement et les juifs ?
On a employé ce mot de rupture. Il n'est pas juste. Celui qui convient est: mesure de discipline; par son décret, Napoléon veut amener les juifs à se plier à ce qu'il avait dessein de faire d'eux. Il est fidèle à son plan d'opération, les concernant. Dès le début de son règne, il a voulu les rendre plus honnêtes, utiles, frères des Français. C'est pour atteindre plus sûrement ce but qu'il a convoqué l'Assemblée des Notables israélites, puis le Grand Sanhédrin, et qu'il leur a dicté leurs réponses. Le décret du 17 mars 1808, si dur soit-il, fait suite dans les projets du régénérateur à la convocation de la haute Assemblée. Le Sanhédrin avait pour rôle d’éclairer doctrinalement; l'Empereur s'est réservé celui d'agir militairement: Aide-toi, l’Empereur t'aidera. Ce décret ne fut donc pas une œuvre spontanée de la part de Napoléon; il fut une œuvre mûrement réfléchie. Son élaboration fut même assez longue. Dès le 6 mars 1806, avant la convocation et la réunion des assemblées juives (les Notables, le 26 juillet 1806; le Sanhédrin, le 10 février 1807), l'Empereur s'était préoccupé des mesures à édicter contre les israélites (226). Elles furent remises après la réunion et la séparation de la docte et docile Assemblée.
Mais pourquoi (est-on en droit de se demander avec quelque surprise), pourquoi ce parti-pris, chez le souverain, de faire appel à des mesures d'exception et de sévérité, alors que les réformes et les promesses exigées par lui allaient lui être toutes accordées ?
Parce que l'Empereur avait cette conviction, arrêtée par devers lui, et corroborée par Portalis et surtout Molé: que ni appel à la représentation nationale juive dans une assemblée de Notables, ni appel à la sanction religieuse dans la réunion du Grand Sanhédrin, ne seraient suffisants pour changer un peuple réputé indomptable dans ses habitudes. Aux appels d'honneur il fallait allier des mesures de discipline. L'Empereur s'était écrié en plein Conseil d'Etat: On ne se plaint point des protestants et des catholiques, comme on se plaint des juifs. C'est que le mal que font les juifs ne vient pas des individus, mais de la constitution même de ce peuple; ce sont des sauterelles et des chenilles qui ravagent la France. Et Portalis avait terminé, par cette conclusion, un mémoire auquel l'Empereur donna la préférence sur celui de
M. de Champagny: « Il ne saurait être déraisonnable ou injuste de soumettre à des lois exceptionnelles une sorte de corporation qui, par ses institutions, ses principes et ses coutumes, demeure constamment séparée de la société générale. »
C'est sous l'empire de ces pensées que l'Empereur a prémédité et arrêté, dès 1806, les mesures de discipline édictées dans le foudroyant décret.
Le Grand Sanhédrin qui s'est tenu en 1807 n'a pas eu le talent, malgré son obéissance et ses adulations, de faire échouer la sévérité en réserve.
Quant à l'année qui s'écoule entre la séparation du Sanhédrin et le coup de tonnerre du décret (1807-1808), elle est si pleine, hélas ! de tromperies et supercheries juives, qu'elle confirme l'Empereur dans ses dispositions sévères et lui fait lancer le décret. Quelles supercheries, quelles tromperies ? Entre autres, celles-ci:
Pour sauver d'une ruine complète les malheureux cultivateurs de l'Alsace écrasés par les usures des juifs, Napoléon avait, en 1806, décrété un sursis d'un an à toutes les dettes hypothécaires de ces cultivateurs vis-à-vis de leurs rapaces créanciers. Qu'avaient fait ces rapaces ? Ils avaient imaginé de substituer aux inscriptions hypothécaires, des contrats de vente avec faculté de réméré (c'est-à-dire avec faculté du rachat, pour le vendeur, à la condition de rendre dans un délai convenu le prix à l'acheteur). A l'aide de ces contrats à réméré, maint paysan avait obtenu de l'argent, par la vente de son fonds qu'il avait donné à perte. Le délai arrivé, le pauvre paysan n'ayant pu rendre le prix, l'usurier était devenu, légalement et de plein droit, propriétaire irrévocable du fonds qu'il avait acquis à prix modique, et il le faisait passer dans d'autres mains avec de gros bénéfices. « Ce genre de prêt, écrivait fort justement M. de Champagny, est plus nuisible à l'agriculture que l'usure même, puisqu'il tend à ôter des mains du cultivateur un sol productif pour en faire un objet de trafic (227). »
Autres supercheries. — Depuis leur sortie de Palestine, les juifs avaient toujours eu de l'aversion pour le métier des armes. Mais, en acceptant d'être citoyens français, ils étaient devenus tributaires du drapeau et devaient tirer à la conscription. Or, soit parce que le service était dur sous Napoléon, soit parce que les chances du commerce leur semblaient préférables à celles de la guerre, ils ne se faisaient point faute de s'esquiver. Les rapports officiels se plaignent de cette dérobée:
Sur soixante-six juifs qui, dans un laps de six ans, devaient faire partie du contingent de la Moselle, aucun n'est entré dans les armées (228).
Dans le département du Mont-Tonnerre, jusqu'en 1806, les juifs ont constamment éludé les lois de la conscription (229).
Quoique la population juive de ce département du Mont-Tonnerre atteigne 1.000 résidents, il n'a fourni que 29 conscrits israélites de 1806 à 1810 (230).
On comprend que Napoléon, pour qui le service militaire était le plus grand des devoirs qu'un citoyen doit remplir, ait fait un bond en prenant connaissance de ces rapports et se soit écrié: Je leur apprendrai à être soldats ! En effet, le dix-septième article du décret de mars 1808, éclatant comme un coup de fanfare dans les quartiers juifs, apprenait que « tout juif conscrit serait assujetti au service personnel, et que la population juive, dans tous les départements de l'empire, ne serait point admise à fournir des remplaçants pour la conscription ».
De tout ce qui précède, il ressort avec évidence que l'Empereur n'a voulu nullement rompre avec les juifs, mais les dompter, les subjuguer. Il a voulu constituer pour eux une école de discipline: « Il n'édictait à leur égard des mesures exceptionnelles qu'afin de les faire renoncer à des habitudes également exceptionnelles (23l). »
Au surplus, ce qui prouve que telle était bien l'intention de l'Empereur, c'est le langage catégorique dont s'est servie Sa Majesté dans ce décret qualifié d'« infâme ». La clause qui annonce que le présent décret sera en vigueur pendant dix ans ajoute: « Nous espérons qu'à l'expiration de ce délai, et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre Empire. »
L'intention formelle de l'Empereur était donc d'achever leur incorporation à la société en les façonnant à la moderne ce qu'avait oublié de faire la Constituante, et non de les repousser dans les exceptions permanentes du Moyen Age (232).
Sa volte-face n'était qu'une manœuvre.
IV
Les juifs, eux, n'ont pas cru à cette manœuvre de guerre en morale. On ne leur ôtera pas de l'idée que le décret du 17 mars 1808 n'a été qu'une œuvre de haine et de répulsion.
Sur quoi basent-ils leur jugement pessimiste ?
D'abord sur la législation française. « Ce décret mérite toute réprobation parce qu'il était une violation du principe qui veut que la loi soit égale pour tous (233). » En effet, n'y avait-il pas dix-sept ans que les israélites émancipés par la Constituante jouissaient des droits civils ? Or, voici qu'un code tout particulier, s'écartant entièrement des principes du droit public, leur est brusquement appliqué. N'était-ce pas la haine qui venait rayer ainsi le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi ? N'était-ce pas la répulsion qui imprimait une flétrissure à toute une classe de citoyens, en les soumettant à des règles rigoureuses et exceptionnelles ?
Une sorte d'ironie par rapport à l'œuvre du Sanhédrin semblait confirmer ce jugement pessimiste. L'Empereur avait obtenu de la haute Assemblée tout ce qu'il avait désiré se faire accorder. Les notables et les rabbins avaient répondu à son terrible questionnaire comme des enfants de troupe répètent devant le général-inspecteur la leçon qui leur a été apprise dans la chambrée (234); et, nonobstant cette docilité, les israélites n'étaient-ils pas, tout à coup, mis au séquestre, ainsi que des vauriens ? Pour comble d'ironie, l'Assemblée avait fourni elle-même les verges dont on les fouettait. Elle avait manifesté, en termes enthousiastes, sa patriotique ambition de voir Israël procurer de nombreux et remarquables soldats, régénérer son commerce, etc.; et voici que, la prenant au mot, on interdisait aux seuls juifs la faculté de se faire des remplaçants au service militaire, et, pour quelques cas d'usure arrivés depuis la réunion du Sanhédrin, on soumettait tout le commerce israélite à des entraves tyranniques.
Cette pensée d'avoir fourni eux-mêmes les verges exaspérait rabbins et notables. De fait, Napoléon, après qu'il eut obtenu d'eux tout ce qu'il avait décidé de se faire accorder, ne les avait plus ménagés. « Les sanhédrites comprirent, mais un peu tard, qu'ils avaient eux-mêmes, par leurs propres résolutions, fourni à Napoléon des armes contre la race dont ils défendaient la cause (235). »
Au lieu de savourer le lait et le miel qu'ils avaient espérés dans une nouvelle Terre promise, nos Hébreux buvaient toutes les eaux salées de la mer Morte !...
« Napoléon nous a trompés ! » criait-on d'un bout à l'autre des juiveries; « que le ciel nous venge ! Œil pour œil, dent pour dent: revienne la loi du talion, puisque la loi française ne nous couvre plus ! »
Les juifs influents et mieux informés se montrèrent moins injustes envers l'Empereur que la collection de colporteurs et d'usuriers atteints au vif par le décret. En effet, ceux qui étaient au courant de la politique accusaient le comte Molé d'avoir été l'instigateur des mesures de rigueur. Ce qui est vrai, c'est que Molé ne supportait ni les juifs ni la croyance que leur sang eût osé entrer dans ses veines (236). Profitant de ce que l'Empereur était occupé sur le Niémen, à la veille de livrer la bataille de Friedland, il avait, par des intrigues auprès de ses collègues, fait voter l'urgence des articles contre les juifs (237); le souverain n'eut plus qu'à ratifier.
L'infatigable adversaire de Molé, Furtado, tenta une suprême démarche pour arracher ses coreligionnaires aux mesures d'exception et de rigueur. Une première fois, à la tête d'une députation du Sanhédrin, il s'était rendu à Fontainebleau pour protester, en face de Napoléon, contre les mesures de répression dont le Conseil d'Etat étudiait les termes: l'Empereur n'avait pas daigné les recevoir (238). Une deuxième fois, averti secrètement que le décret était sur le point de paraître, le généreux israélite s'élançait, d'un bond des bords de la Seine à ceux du Niémen. L'Empereur le reçoit à Tilsitt, l'accueille avec bonté, mais se montre inflexible sur la préparation du décret (239).
Quand il paraît, les juifs, à leur tour, croient avec entêtement à une rupture, aux temps du Moyen Age qui vont revenir pour eux. L’« infâme » décret leur a serré le cœur: l'ère de l'enthousiasme pour Napoléon est fermée.
L'impassibilité juive se retrouva tout entière pour supporter les souffrances que l'application du décret allait engendrer. La lutte pour triompher de Napoléon va aussi s'organiser.
Une anecdote touchante, rapportée par les Archives israélites, montrera bien l'impassibilité.
V
« Dans un village de l'Alsace vivait, en 1807, Mardochée Blum, avec sa femme Rébecca et son fils David. Comme dans toutes les familles juives d'alors, le père faisait le commerce, le fils étudiait le Talmud et la mère s'occupait du ménage. Mardochée Blum n'était pas riche; mais par son activité et son industrie, il savait tirer parti de son capital, et par le crédit dont il jouissait il parvenait à mener à bien les plus lourdes entreprises. Comme tous ses confrères, il trafiquait de tout, achetait des immeubles, les revendait et faisait à l'occasion un peu d'escompte. Loyal en affaires, bon et bienfaisant, il était généralement aimé et estimé, autant du moins que pouvait l'être à cette époque un israélite en Alsace, où un préjugé populaire, trop ancien pour être facilement déraciné, avait établi en principe que tous les juifs étaient des usuriers.
« David Blum était un grand et beau jeune homme de vingt ans, d'un caractère calme et réfléchi, couvrant, sous une apparence froide et timide, de fraîches pensées et de nobles sentiments. Il ne s'était pas borné à l'étude des livres rabbiniques; mais il savait lire l'allemand et le français, et il avait puisé quelques notions d'histoire dans de vieux bouquins achetés à vil prix à la vente d'un émigré. Aussi était-il regardé comme le savant de l'endroit, et toutes les filles à marier l'enviaient à Sarah, sa fiancée, jeune juive aux cheveux noirs et à l’œil vif, qui lui apportait une belle dot en mariage.
« La famille Blum vivait heureuse et contente, attendant le moment fixé pour l'union des jeunes fiancés, lorsque la promulgation d'un décret impérial vint faire évanouir cet échafaudage de bonheur qui paraissait si solide. Ce décret, qui imprime une tache indélébile au règne de Napoléon, et qui est marqué au coin de l'intolérance, de l'injustice et de l'oubli du droit des gens, ordonnait qu'à dater du 17 mars 1808 tout juif français serait forcément assujetti au service militaire, sans avoir la faculté de se faire remplacer, et il portait, entre autres dispositions draconiennes, que le paiement d’aucune obligation, promesse ou lettre de change souscrite à un juif par un Français non israélite, ne pourrait désormais être exigé sans que le bénéficiaire prouvât en avoir fourni la valeur entière. On conçoit facilement ce que de pareilles mesures exceptionnelles durent amener de perturbation dans l'Alsace, où le commerce, surtout celui d'argent, se trouvait presque exclusivement dans les mains des israélites; mais, parmi les nombreuses victimes que fit l'exécution de cet inique décret, aucune ne fut aussi violemment froissée que la famille Blum. L'heure de la conscription avait sonné pour David; désigné par le sort, il fut obligé de quitter ses parents; et comme il partait le visage brûlant des larmes que sa mère désespérée avait versées sur lui sous prétexte de lui donner le baiser d'adieu, il reçut la visite du père de sa fiancée, lequel lui apprit d'un air froid et embarrassé que Sarah ne pouvait attendre le retour d'un militaire, et qu'il allait lui chercher un autre mari. Quand le pauvre David eut rejoint son régiment et qu'il commençait à se former au service, il reçut de sa famille de tristes et déplorables nouvelles: les débiteurs de Mardochée Blum, profitant avec mauvaise foi des dispositions tyranniques du décret impérial contre les juifs, refusèrent de payer ce qu'ils lui devaient, avant qu'il n'eût prouvé avoir donné le montant total des obligations qu'ils avaient souscrites à son profit; et comme c'était matériellement impossible, Mardochée se trouva en un jour ruiné de fond en comble. Ce n'est pas tout, son crédit fut perdu; ses créanciers, qui n'avaient pas besoin de rien prouver, eux, parce qu'ils n'étaient pas juifs, réclamèrent ce qu'il leur devait, et comme il ne put payer de suite, il perdit la tête, fut mis en faillite; et, attendu qu'il n'avait pas de livres de commerce, il fut condamné comme banqueroutier à deux ans de prison. Ce qu'il eut à souffrir, nul ne le sut jamais, car Mardochée ne se plaignit pas; mais une morne douleur, des yeux éteints et ses cheveux qui blanchirent en quelques jours, voilà quels furent les seuls indices de son désespoir, jusqu'à ce qu'un matin on le trouva mort sur la paille fétide de sa prison. Sa femme, Rébecca, avait tout supporté avec une religieuse résignation, et même elle était parvenue à étouffer ses larmes silencieuses pendant l'heure qu'il lui était permis de passer chaque jour au guichet de la maison de détention; mais, lorsqu'elle eut perdu son mari, elle se livra à des cris de douleur, à des imprécations menaçantes et à des accès de rage où l'on reconnut bientôt tous les symptômes de la folie. Son égarement devint si violent, qu'elle fut enfermée dans une maison d'aliénés, d'où Dieu, ayant pitié d'elle, la rappela bientôt à lui.
« Rien ne saurait dépeindre la stupeur de David Blum quand il reçut ces fatales nouvelles en Espagne, où il avait suivi son régiment. Enfermé dans le cercle de fer du service militaire, il ne put même donner un libre cours à sa juste douleur; il eût sacrifié sa vie pour aller défendre son père ou consoler sa mère, mais la loi l'enchaînait sous les drapeaux, et il lui fut refusé jusqu'à la triste consolation d'aller pleurer sur leur tombe. Il maudissait l'Empereur, exhalait sa rage en vaines menaces, et sa haine en inutiles imprécations, et dans ses yeux brillait sans cesse le feu sombre du désespoir, en même temps que la lave ardente de la vengeance bouillonnait dans son cœur comme dans un lit de feu. Bientôt, il sembla mort à la vie réelle; il faisait son service avec exactitude, mais machinalement; il allait au feu et à la parade avec la même indifférence inerte; un cruel souvenir s'était emparé de tout son être, et la vie ne fut plus pour lui qu'une léthargie intermittente. Un jour cependant, à une revue d'inspection, le général Guilleminot, frappé de l'air défait du jeune soldat, en demanda la cause à l'officier le plus voisin, lequel répondit avec dédain: C'est un juif alsacien, assez mauvais soldat, sans nerf et sans courage. A ces mots, le rouge monta au front de David, il se redressa avec vivacité, portant convulsivement la main à la poignée de son sabre; mais cet éclair d'animation se calma aussitôt, et la pâle figure de l'orphelin reprit son impassibilité accoutumée.
« Depuis ce temps, rien ne réussit à troubler le sommeil de plomb qui engourdissait les facultés de David Blum; et lorsque, quatre ans après, il assista à l'incendie de Moscou et à la ruine du Kremlin, son calme et son indifférence ne se démentirent pas un instant au milieu des mille dangers qui l'entouraient. Quelques jours après, c'était le 24 octobre 1812, il se trouva sur les bords de la rivière de la Louga, avec une division de l'armée française battant en retraite, et vivement poursuivie par les Russes que commandait Kutusoff, lorsque le général français, voyant sa division écrasée par l’artillerie russe, fit jeter une centaine de grenadiers dans une église qui bordait la route et la dominait. David se trouvait parmi ces cent braves qui crénelèrent l'église et s'y défendirent avec tant de vaillance, que cinq fois, par leur feu ménagé et dirigé à propos, ils rompirent les colonnes ennemies et donnèrent ainsi à la division française le temps de se réunir au fond d'un ravin où, au nombre de 18.000 hommes, elle résista à 50.000 Russes, qu'elle défit complètement. Après cette brillante affaire, le général Guilleminot, qui commandait la division française, se fit présenter ceux des vaillants grenadiers qui n'avaient pas succombé dans la défense de l'église, et auxquels était dû le succès de la journée. David lui fut désigné comme s'étant surtout distingué par son intrépidité. « Comment te nommes-tu ? lui demanda le général. — David Blum, juif alsacien, qu'on vous a désigné il y a quatre ans en Espagne comme un mauvais soldat. — Tu es un brave, David Blum, et je te fais officier. — Merci, mon général, je ne veux rien; j'ai combattu parce qu'il s'agissait de la vie de mes frères d'armes, mais je n'ai rien fait pour votre empereur qui a ruiné, déshonoré et fait périr ma famille... »
« Quelques semaines après, l'armée française, en pleine déroute, opérait sa désastreuse retraite sur la Bérésina, et le froid et la faim jonchaient de morts et de mourants la campagne glacée, lorsque Napoléon, s'arrêtant pour se réchauffer au feu d'un bivouac, fut étonné de l'ordre et de la bonne contenance conservés par ce groupe de soldats au milieu de l'effroyable désordre du reste de l'armée. « C'est, lui dirent-ils, à notre camarade David Blum que nous devons notre conservation; son énergie a soutenu la nôtre, son courage nous a sauvés des escarmouches des Cosaques, et sa prudence nous a toujours procuré des vivres et du feu. — David Blum, dit l'Empereur, de cette voix qui faisait trembler les trônes européens, et qu'il savait, lorsqu'il le voulait, rendre si douce et si attrayante, David Blum, tu es un bon soldat, et ta place est marquée dans la vieille garde »; puis, détachant la croix d'argent qui ornait son uniforme de général, il la remit au soldat juif, lequel, combattu par le vieux levain de haine qui fermentait en lui, en même temps qu'il se sentait fasciné par la crainte respectueuse qu'imprimait à tous la présence de l'Empereur, répondit avec fermeté, quoique sa figure décelât les vives émotions qui l'agitaient: « Sire, je suis juif alsacien, et ne puis accepter ni avancement ni décoration, car ce serait accepter le prix du sang de ma famille déshonorée par l'odieux décret du 17 mars. — Ah ! reprit l'Empereur d'un air mécontent, on m'a déjà parlé de cela; puis il ajouta d'un ton bref: Ils m'ont encore trompé sur ce chapitre, mais nous aviserons »; et un nuage se répandit sur ses traits, une profonde ride vint sillonner son large front, et comme s'il voulait secouer une pensée importune, il s'élança sur son cheval et s'éloigna au galop, suivi de son état-major silencieux. David Blum était resté debout, faisant d'une main le salut militaire, et tenant de l'autre la croix de légionnaire que l'Empereur lui avait remise; ses facultés étaient comme suspendues, sa tête était en proie à un bourdonnement confus, son cœur battait violemment, et lorsque ses camarades l'eurent rappelé à lui, il lui sembla qu'il sortait d'un rêve. Mais de plus graves préoccupations vinrent bientôt faire diversion aux sentiments tumultueux de son âme agitée; une bande de Cosaques parut dans le lointain, et, après une lutte désespérée dans laquelle le détachement français périt presque en entier, David blessé fut fait prisonnier, et, comme il avait eu le commandement de sa petite escouade, on le prit pour l'officier; c'est à cette méprise qu'il dut la vie et l'affreux partage d'être ramené à Moscou, d'où, après de longues tortures, il fut envoyé en Sibérie. C'est dans une mine au-delà des monts Ourals, à neuf cents lieues de Pétersbourg, que l'infortuné prisonnier fut conduit au milieu des traitements les plus barbares. En descendant dans ce tombeau anticipé, il dut abdiquer son nom, sa patrie, son individualité, et son existence fut divisée entre le travail et le knout. Dans ce désert peuplé de quelques centaines de vivants, tous moralement décédés, on ne vit pas, on souffre. Là l'ouvrier mineur n'a ni maison, ni famille, ni amis, il n'a que des larmes et des grincements de rage; là, l'exilé ne tient plus au monde que par le fil imperceptible d'un souvenir qui va chaque jour s'amincissant; là, bourreaux et victimes, courbés sous le même joug, s'endorment l'un à côté de l'autre de l'éternel sommeil, et le désert qui voit passer les générations d'exilés n'assiste jamais à leur retour. David Blum vécut vingt-huit ans dans ce travail souterrain, vingt-huit ans pendant lesquels il n'eut ni regrets, ni ennuis, ni désespoir, car son âme était bronzée à la souffrance, et son cœur déchiré était depuis longtemps criblé de trop de coups pour être vulnérable à une nouvelle blessure. Un matin, on lui dit qu'il était libre; il ne comprit pas d'abord ce mot qui était rayé de sa mémoire; puis l'instinct humain le conduisit, et il se mit à marcher tout droit devant lui. Où allait-il, il n'en savait rien; mais il était si étonné de pouvoir marcher seul, s'arrêter quand il le voulait, et voir le ciel à toute heure, que son cœur se sentait inondé d'ineffables joies. Il bénissait la pluie, le vent, le froid, car tout cela, c'était, pour lui, renaître à la vie... Hélas ! bientôt, avec la raison, il recouvra le sentiment de tous ses maux ! Pauvre anneau violemment détaché de la chaîne sociale, il frémit de son isolement sur la terre, et il eut un instant la pensée de retourner à cette alternative de travail et de knout qui, pendant vingt-huit ans, lui avait tenu lieu d'existence. Mais le mot France réveilla comme par magie son âme engourdie, et il traversa toute l'Europe avec un courage qui ne se démentit pas un instant, ayant pour fortune son bâton de voyage, pour appui l'assistance des cœurs généreux, pour guide cette étoile polaire nommée patrie.
« Enfin, un matin de décembre 1840, il arriva au village natal; lui si beau autrefois en quittant l'Alsace, lui si fier alors de respirer à pleins poumons la fraîche vie que sa jeunesse lui offrait en perspective, il y revenait le dos courbé, le corps amaigri, l'œil éteint et le pas chancelant. D'abord il regarda autour de lui d'un air ébahi, car on lui dit: « Vous êtes arrivé », et cependant il ne reconnaissait pas là le village d'autrefois, ni la maison paternelle, ni le noyer sous lequel il s'abritait jadis pendant l'orage. Où est donc ce joli ruisseau dont il suivait, enfant, le cours capricieux ? Que sont devenus ces volets verts qui égayaient le pavillon d'en face ? Et ce jardin, témoin de ses jeux enfantins, et ces fleurs, qu'il cueillait pour Sarah, sa fiancée ?... Hélas ! tout cela a disparu, le village est devenu une petite ville, des fabriques s'y sont élevées, tout a changé d'aspect, et David, pour la première fois depuis vingt-huit ans, sent une larme mouiller sa paupière, une larme de regret pour ce passé doré qui s'est envolé au souffle de l'adversité. La population du pays était, aussi, bien changée, les anciens étaient morts et les jeunes gens lui étaient étrangers, le nom de Blum était entièrement oublié et inconnu, et David ne trouva pas une main pour presser la sienne, et ne rencontra que des regards inquiets et des mines soupçonneuses. Alors il s'en fut prier sur la tombe de ses parents, puis il se dirigea vers Paris, où s'apprêtait la cérémonie des funérailles de l'Empereur, et où le vieux soldat espérait rencontrer quelque ancien frère d'armes. Le 14 décembre, il était arrivé dans la capitale, accablé de fatigue, souffrant le froid et la faim, sans papiers, sans argent, et ne sachant que devenir. Il erra longtemps dans les rues de la grande ville, coudoyant souvent des gens qui parlaient des gloires de l'Empire, et qui ne s'inquiétaient pas si, à côté d'eux, le besoin rongeait un des vieux instruments de cette gloire nationale. La nuit venue, comme il n'avait pas un asile pour reposer sa tête, il s'étendit sur une pierre glacée à l'abri du porche d'un théâtre; et, comme il était à peine vêtu, il souffrit plus du froid qu'il ne l'avait ressenti en Sibérie. Il ne put dormir, et de sombres pensées agitèrent son insomnie; que faisait-il encore ici-bas ? Pourquoi toute sa vie avait-elle été ainsi vouée au malheur ? Pourquoi survivait-il seul à son père, à sa mère, à sa fiancée, à ses frères d'armes, à ses officiers, et n'avait-il dans le monde entier ni amis, ni fortune, ni travail, rien qui pût attacher son âme à l'espérance, rien qui pût soutenir son corps sur la terre ? Et tout cela parce qu'il avait plu un jour à un soldat heureux de mettre les juifs alsaciens hors du droit des gens; parce que, substituant l'arbitraire à la justice, il leur avait ravi en même temps leur fortune et leurs enfants; parce qu'enfin, ce fils parricide de la liberté semblait avoir pris à tâche de monopoliser à son profit l'héritage de sa mère... En ce moment, de nombreux cris de: « Vive l'Empereur ! » vinrent frapper l'oreille de David, et le firent tressaillir comme le voyageur qui vient de mettre le pied sur un serpent, lequel se redresse en sifflant. C'était la foule matinale qui se dirigeait vers les Invalides pour rendre un dernier hommage au héros qui fut son idole; le vieux soldat la suivit et fut saisi d'admiration à la vue du spectacle imposant qu'offraient les Champs-Elysées. Conviée à la fête mortuaire, la population parisienne arriva bientôt en masses noires qui débouchaient de tous les points, et chaque avenue ne cessa de lancer de nouvelles phalanges jusqu'à ce qu'un cordon de têtes unît les Tuileries à l'Arc de l'Etoile; on eût dit une mer houleuse où se précipitaient en grondant vingt fleuves débordés. Tous les états, toutes les classes sont représentés à cette lugubre solennité; toutes les récriminations, toutes les haines contre le grand homme paraissent oubliées, et la grande voix de l'histoire a seule la parole sur la tombe de ce géant que l'humanité n'a pu mesurer que lorsqu'il fut étendu sans vie.
« Ce sublime spectacle fit une révolution dans les idées dont David Blum avait nourri jusque-là son ressentiment, et son cœur subitement illuminé s'ouvrit à la pitié, comme l'horizon chargé de noirs nuages que déchire violemment un rayon de soleil. Il se rappela avec quelle émotion l'Empereur lui avait dit ces mots: Ils m'ont encore trompé ! et, s'inclinant devant la grande infortune du héros français, il lui offrit en holocauste, avec le pardon des maux qu'il lui avait fait souffrir, l'oubli de la haine qu'il lui avait vouée, et il s'écria, saisi d'un saint enthousiasme: Comment es-tu tombée du ciel, étoile impériale, resplendissante de tant de divines clartés ! Comment es-tu mort dans l'exil, toi qui menais les rois à la lisière, et les peuples à la chaîne ! Colosse gigantesque, qui voulais couvrir toute la terre de ton ombre, comment t'es-tu laissé disputer quelques pieds de l'aride rocher de Sainte-Hélène ! Non, je n'ose plus me plaindre de ma vie de douleurs et d'infortunes, car les tiennes ont dépassé ce qui est donné au cœur de l'homme de supporter de souffrances. Comme à moi, on t'a ravi les êtres qui t'étaient chers ! comme moi, on t'a enchaîné sur une terre lointaine ! comme moi, tu reviens le cœur glacé et le bras raidi ! et le grand Empereur et l'humble juif se rencontrent pour la dernière fois sur un sol consacré de nouveau par la liberté, la tolérance et la justice, car les mauvaises lois n'ont qu'un jour, la liberté, la tolérance et la justice sont éternelles...
« En ce moment, les cloches de la ville sonnèrent comme réveillées en sursaut par le bruit du canon, les tambours firent résonner leurs gémissements aériens, et une voix lointaine, composée de cent mille voix, s'écria: « Le voici ! » Sous l'Arc de l'Etoile, géant de pierre élevé pour que la grande ombre de l'Empereur pût se dresser dessous de toute sa hauteur, parut le cercueil triomphal avec sa ceinture de généraux mutilés, avec ses renommées éclatantes, ses bannières aux triples couleurs couvertes de crêpes, et ses aigles aux ailes déployées qui semblaient prendre leur vol vers l'éternité. Ce que David Blum éprouva à cet aspect, nul ne tentera de le peindre; il tomba à genoux, et pria. Son âme fut calmée par la prière, l'hallucination de son esprit se détendit, son corps cessant d'être soutenu par la seconde vie que donne la pensée, tomba affaissé par la fatigue et le besoin; et, quand la foule se fut rassasiée de voir passer le cortège, elle remarqua le vieux soldat appuyé inanimé contre une des colonnes triomphales qui avoisinaient l'Arc de Triomphe de l'Etoile.
« Le lendemain, on lut dans un journal l'article suivant: « Parmi les accidents arrivés hier, on cite un homme à l'aspect misérable et au visage étrange qui a été trouvé étendu sans connaissance dans les Champs-Elysées. On n'a pu savoir s'il est tombé victime du besoin, du froid ou de la pression de la foule. Transporté à l'hôpital Beaujon, les soins qu'on lui a prodigués ont été inutiles, et il est mort cette nuit après quelques heures d'agonie. On doit exposer aujourd'hui à la Morgue cet être inconnu, sur lequel on n'a trouvé ni argent ni papiers. Seulement pendant son agonie, sa main crispée tenait violemment appuyé sur sa poitrine un petit paquet qui renfermait une croix de la Légion d'honneur à l'effigie de Napoléon et un papier imprimé tellement plié et usé, qu'on n'a pu y déchiffrer qu'avec peine ces mots: Décret impérial concernant les juifs, 17 mars 1808 (240)... »
CHAPITRE II LE MOUVEMENT TOURNANT DES JUIFS
I. Différence entre l'action engagée par les juifs contre la Constituante et la tactique qu'ils emploient contre Napoléon. — II. Une file d'exceptions au décret. — III. Le contre-décret des sociétés secrètes. IV. La flagellation des événements. Horrible et barbare conduite des juifs polonais après le passage de la Bérésina. — V. Au bout des dix ans.
I
Refaisons, en reprenant les grandes lignes de l'histoire juive, le milieu historique que l'anecdote précédente a quelque peu bouleversé.
Nous sommes en 1808. Le sévère décret contre les juifs a paru en mars. C'est l'année où Napoléon ne respecte plus la majesté du Saint-Siège et où ses armées passent les Pyrénées pour envahir l'Espagne.
L'anecdote, écho de sentiments vrais, a montré l'impassibilité juive au milieu des souffrances engendrées par l'application du décret. Le présent chapitre rapportera la lutte engagée par les fils d'Israël, qui ont pris goût à la liberté française, contre le décret et son auteur.
Elle fut très habile, cette lutte.
Que font-ils ? Attaquent-ils le décret de front ? Ils s'en garderaient bien; ils ne s'y risquent pas. Ils eussent été culbutés, d'un revers de la main, dans leurs anciens gîtes.
Souples et d'un esprit fertile en expédients, ils emploient contre Napoléon une tactique diamétralement opposée à l'action qu'ils ont engagée, contre la Constituante, vingt ans auparavant. Celle-ci avait été attaquée de front: vis-à-vis de l'Empereur, ce sera un mouvement tournant.
On se rappelle le tableau que nous avons tracé de ces quatorze assauts livrés par la ténacité juive à l'Assemblée nationale, de 1789 à 1791, pour réclamer, au nom des Droits de l'homme, l'émancipation civile. Nous remettons sous les yeux du lecteur l'épisode du dernier assaut:
« Il faut reconnaître qu'ils avaient été tenaces, et surtout bons logiciens. Tenaces, puisque, dans l'espace de deux ans, c'est-à-dire pendant toute la durée de la Constituante, la question de leur émancipation avait été quatorze fois présentée par eux, écartée et ajournée quatorze fois par les législateurs, et qu'ils étaient encore là, pour la leur présenter une quinzième fois à la veille de la dissolution de l'Assemblée. Bons logiciens, parce qu'ils exigeaient qu'on tirât, de la Déclaration des droits, les conséquences logiques qu'on ne voulait pas y apercevoir.
« On était arrivé à la veille de la clôture de l'Assemblée constituante. C'était l'avant-dernière séance. Il n'y avait plus ni temps à perdre, ni sursis à accepter. Duport se lève et réclame, au nom des Droits de l'homme, l'émancipation des juifs. Régnault de Saint-Jean-d'Angély coupe court à toute contradiction, en disant: « Je demande qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui parleront contre cette proposition, car c'est la Constitution elle-même qu'ils combattront. »
« Lorsqu'un corps de troupes bat en retraite, si on parvient à le jeter sur un obstacle pour le détruire ou l'obliger à se rendre, on dit, en terme de guerre, qu'il est acculé. C'était la situation sans issue de la Constituante, à l'heure avancée de sa retraite. Elle se trouvait en face de cette alternative: ou mettre bas les armes devant les juifs, ou détruire la Constitution, son œuvre, ce qui équivalait, pour la Constituante, à se détruire elle-même devant l'histoire. Elle était acculée.
« La fameuse Déclaration des droits de l'homme était devenue une impasse, un cul-de-sac. L'Assemblée demeura silencieuse devant l'apostrophe de Régnault de Saint-Jean d'Angély. La victoire resta aux juifs (241). »
Ainsi donc, après quatorze instances auprès de l'Assemblée Constituante pour la mettre en demeure de se prononcer sur leur émancipation, après quatorze refus de sa part et quatorze défaites pour eux, à la quinzième tentative, les juifs étaient demeurés les maîtres (242).
Pareille attaque de front était absolument impossible avec Napoléon. Au reste, la difficulté à vaincre n'est plus la même. Avec la Constituante, c'était une déduction qu'elle ne voulait pas tirer d'un principe posé par elle; avec Napoléon, c'est un fait brutal à redresser. Dans le premier cas, on avait eu affaire à la logique; dans le second, on rencontrait la poignée d'un sabre et la redingote grise...
La gent prudente de Palestine s'arrêta au moyen du mouvement tournant: tourner la difficulté, c'est-à-dire l'éluder !
II
Le premier expédient auquel on eut recours pour l'éluder fut les exceptions au décret.
L'historien juif Halévy dit avec un dédain affecté, comme s'il avait voulu donner le change et effacer devant l'histoire la peur ressentie par ses coreligionnaires: « Au surplus, le décret était
à peine rendu depuis un an, qu'il en parut successivement plusieurs, affranchissant de ses dispositions les juifs d'un département, puis ceux d'un autre, de sorte que son application se trouva bientôt réduite aux seuls israélites de l'Alsace (243). » Cette phrase n'est que de la fanfaronnade, voici la vérité:
Napoléon se fit prier. Humbles et suppliants, les Hébreux de l'Empire vinrent successivement solliciter des exceptions au décret. En prince qui voulait se montrer débonnaire, Napoléon les accorda. Il se forma alors une file d'exceptions:
En 1808, l'Empereur affranchit du décret les israélites: de la Seine (6 avril), de la Méditerranée (16 juin), des Basses-Pyrénées (22 juillet).
En 1810, il accorda la même faveur aux israélites: Ces quinze départements furent favorisés à la fois (11 avril) des Alpes-Maritimes de l'Aude du Doubs de la Haute-Garonne de l'Hérault de Marengo du Pô de Seine-et-Oise de Stura de la Doire de la Seine des Vosges du Gard de Gênes des Bouches-du-Rhône
En 1811, il étendit l'affranchissement aux israélites: (19 mars) de Rome du Rhône de Montenotte des Forêts
Ainsi, lors de l'année 1811, vingt-deux départements de l'Empire se trouvaient déjà affranchis du décret du 17 mars 1808 (244). Il est juste de reconnaître que les israélites faisaient des efforts pour mériter de rentrer dans le droit commun. Le ministre de l'Intérieur le signale à l'Empereur: « La régénération des israélites est sensible; ils s'empressent de mériter les bontés paternelles de Votre Majesté, et ils cherchent à se rendre dignes d'une exception aux dispositions du décret (245). » Sur les soixante-huit départements de l'Empire, habités par des israélites, quarante-quatre étaient encore soumis en 1811 au décret de 1808. Les juifs ne s'étaient donc pas amendés dans tous les départements. Néanmoins, même dans ceux-là, la situation s'était améliorée. La corruption n'était plus aussi générale; tous les arrondissements, toutes les communes d'une région n'étaient plus uniformément pressurés par les excès des usuriers, et, si l'on ne pouvait pas encore enlever le département tout entier à l'application du
décret, il était du moins possible de rendre la liberté à certaines de ses parties. Aussi Napoléon permit-il à son ministre de l'Intérieur d'accorder isolément aux villes des exceptions à l'ordonnance de 1808. Le ministre de l'Intérieur aurait voulu que l'Empereur fît plus encore, et que des villes, il descendit jusqu'aux individus mêmes. Mais Napoléon ne consentit jamais à aller jusque-là. Nonobstant les exceptions, le législateur ne badina donc point sur l'application de son décret, quoi qu'en ait écrit avec un dédain assez léger l'historien Halévy. Le lion pouvait bien rentrer ses griffes, mais il n'était pas d'humeur à les laisser rogner.
Le 9 juillet 1812, un commencement de joie rentra dans les maisons juives. Le service militaire obligatoire pour tout conscrit israélite, sans lui permettre en aucun cas le remplacement, fut mitigé. Sur le rapport du duc de Feltre, ministre de la Guerre, les israélites furent autorisés à se faire remplacer par leurs coreligionnaires (246).
Toutes ces exceptions n'avaient, déjà, pas mal tourné la difficulté du terrible décret. La victoire de la patience se prononçait pour les juifs. Jusque-là, rien que de très légitime.
III
Mais voici la culpabilité: ils sont allés demander du secours aux sociétés secrètes.
Il est hors de conteste aujourd'hui que les sociétés maçonniques ont eu leur main dans les revers de Napoléon, après l'avoir aidé dans ses triomphes. « Durant la première partie de son règne, jusqu'en 1809, Napoléon rencontra dans tous les pays qu'il envahissait un appui énergique de la part des Loges maçonniques, et plus d'une fois son génie militaire fut aidé par la trahison des chefs qu'il combattait (247). » Ensuite les Loges se retirèrent de lui, lorsqu'elles comprirent que le despotisme impérial se concentrait tout entier dans une ambition personnelle et des intérêts de famille, et que la Maçonnerie n'avait été pour lui qu'un instrument. Dès ce moment, le combat contre le César infidèle (248) fut décidé; le Tugendbund en fut l'expression (249): mot allemand qui signifie lien de vertu.
Or, les juifs avaient été les complices des sociétés secrètes dans les triomphes de Napoléon: « A Francfort et dans toute l'Allemagne, raconte un historien illustre, les juifs l'acclamaient comme le Messie, tant ils avaient conscience du renversement de l'édifice social chrétien qui s'accomplissait par ses armes (250). »
N'ont-ils pas été les complices des mêmes sociétés secrètes, lorsque celles-ci se retournèrent contre leur idole ? En effet:
Il y a une coïncidence de dates, à charge:
Le décret de Napoléon contre les juifs, décret qui les a tant exaspérés, qualifié par eux d’« infâme », est de 1808;
Et le décret des sociétés secrètes qui déclare Napoléon abandonné est de 1809 (251).
Cette coïncidence de dates s'explique par celle des rancunes: « Il nous a trompés ! » hurlait-on fiévreusement dans les Loges;
« Il a trompé tout le monde, comment aurait-il tenu parole aux juifs ? » écrira, au nom de ses coreligionnaires, l'historien juif Gratz (252).
En gens habiles et prudents, les juifs chargèrent les Loges de leurs rancunes et des représailles à exercer. Ce n'était pas la première fois que les Loges et les juifs se rencontraient la main dans la main. Quand la Constituante, en 1790-1791, s'attardait et se refusait presque à promulguer le décret d'émancipation en faveur des israélites, ceux-ci s'adressèrent aux Loges qui envoyèrent les faubourgs de Paris appuyer à l'Assemblée leurs amis les juifs (253); maintenant qu'il s'agit non de faire rapporter (on n'oserait !) mais de punir un décret d'exception, les Loges se montrent encore de bonne composition.
Ainsi s'explique cet enchaînement historique:
En 1808, le décret de Napoléon et la colère des juifs;
En 1809, le décret des Loges et la volte-face contre Napoléon.
IV
Fort comme il l'était, il eût été presque indifférent à Napoléon d'être abandonné des sociétés secrètes, si un plus redoutable abandon ne fût venu ébranler son trône: Celui de Dieu.
L'Empereur avait osé porter la main sur l'oint du Seigneur. Un jour — c'était le jour même de la bataille de Wagram — le Pape avait été enlevé de son palais du Quirinal par le général Radet; au bas attendait une voiture dont les stores furent cloués, et les portières fermées à clef; puis, sans perdre une minute, on avait traîné l'auguste et invincible vieillard à Florence, à Turin, à Grenoble, à Valence, enfin à Savone. Livré à la plus amère tristesse, Pie VII avait fait répondre à Napoléon, qui le menaçait de lui ôter la tiare si elle ne se pliait à ses volontés: Je mets ces menaces au pied de la Croix, et j'abandonne à Dieu le soin de venger une cause, qui est la sienne.
L'Empereur était sous le poids de l'excommunication. En apprenant qu'il avait été excommunié par le Pape pour s'être emparé des Etats de l'Eglise, il s'était écrié en se moquant: Croit-il que son excommunication fera tomber les armes des mains de mes soldats
(254) ?
Le ciel avait recueilli ce défi, dans les trésors de ses colères. On était à la veille de la campagne de Russie.
Pour qu'il fût bien prouvé que Dieu lui-même s'était réservé de punir tant d'orgueil, ôtant ce soin au bras des hommes, il fut permis à la victoire d'accompagner la grande armée (255) jusque dans les murs de Moscou: Moscou, encore un de ces noms fabuleux qui avaient tant parlé à l'imagination de Napoléon, comme celui des Pyramides, comme celui du Saint-Bernard ! Ses aigles volèrent jusqu'au faîte du Kremlin. Alors celui qui devait être flagellé devant l'Europe, comme Héliodore l'avait été devant Jérusalem, fut abandonné aux éléments irrités et conjurés.
Le feu éclate, allumé par Rostopchine. Promené par le vent sur tous les quartiers de la ville, l'incendie devient un déluge de flammes. « Les hôpitaux ne pouvant être préservés, les blessés se traînaient avec effort pour mourir hors du brasier. Les soldats, fatigués d'éteindre le feu, retournaient à leurs quartiers, et n'y trouvaient que des charbons. En trois jours, la ville fut réduite en cendres, au milieu desquelles le Kremlin seul resta debout. L'armée victorieuse fut réduite à camper autour d'une ville embrasée. Dans la campagne détrempée par la pluie, le feu des bivouacs était alimenté avec des tableaux, des meubles précieux; on voyait autour des officiers, des soldats déchirés, brûlés, s'étendre sur des châles de cachemire, sur des pelisses de Sibérie, des tapis de Perse; la vaisselle d'argent était répandue partout; mais toutes ces richesses ne les consolaient pas des souffrances que la faim leur faisait éprouver, et de celles qu'ils entrevoyaient dans l'avenir (256). »
La retraite de Russie commença. Alors survinrent les grands froids, qui devaient non pas produire le désastre, mais le porter à son comble. « La neige se mit à tomber, en effaçant toute trace de routes; il fallait donc marcher au hasard, la bourrasque dans les yeux, exposé à chaque instant à s'enfoncer dans les marais. Les malheureux soldats, suffoqués par le vent, engourdis par le froid, venaient-ils à heurter quelque pierre, quelque tronc d'arbre, ils tombaient, hors d'état de se relever, et la neige les avait bientôt recouverts.
« LES FUSILS ÉCHAPPAIENT DE LEURS MAINS ROIDIES, les extrémités gelaient et se gangrenaient; celui qui s'endormait ne se réveillait plus. Si quelques-uns découvraient un sentier frayé et s'y dirigeaient avec espoir, les paysans et les cosaques en embuscade tombaient sur eux avec furie, et les laissaient expirer lentement sur la neige. Les chevaux, en petit nombre, n'étant pas ferrés à glace, glissaient sur le sol durci; ils brisaient la glace pour trouver quelque peu d'eau, et rongeaient l'écorce gelée des arbres. Lorsqu'enfin il s'affaissaient épuisés de fatigue, on se hâtait de les égorger pour se repaître de leur chair et pour se réchauffer les pieds et les mains dans leurs entrailles palpitantes.
« Chaque bivouac devenait un cimetière par le manque de feu; les soldats s'y couchaient le sac sur le dos et les cavaliers la bride passée au bras: souvent ils se tenaient embrassés pour se procurer un peu de chaleur l'un à l'autre; mais souvent aussi, le lendemain matin, ils ne trouvaient près d'eux qu'un cadavre, et le quittaient sans plaindre son sort; car il avait cessé de souffrir. Si l'on voyait quelque peu de bois, la marmite précieusement conservée était mise sur le feu, et la poudre remplaçait le sel pour assaisonner une poignée de farine de seigle ou un morceau de cheval. Un égoïsme farouche remplaça alors cette générosité qui est l'apanage du soldat, et chacun ne songea plus qu'à soi; on allait jusqu'à se disputer, le sabre à la main, une misérable croûte de pain, une botte de paille ou un fagot. On ne tendait pas la main au camarade qui tombait; à tel autre on arrachait de ses épaules, avant qu'il fût gelé et roidi, la pelisse qui le couvrait, pour l'endosser tiède encore. C'était en vain que ceux qui gisaient sur le sol glacé, tombés d'épuisement ou blessés, pressaient les genoux de leurs frères d'armes, les suppliant, au nom de leurs parents, de leur patrie, de ne pas les abandonner; puis, quand le tambour battait la marche, ils se traînaient sur la terre avec des hurlements, en leur montrant les cosaques qui arrivaient, implorant comme un dernier service un coup de fusil, pour ne pas tomber au pouvoir de ces barbares (257). »
Excommunié par le pape, Napoléon s'était écrié en se moquant: Croit-il donc que son excommunication fera tomber les armes des mains de mes soldats ? Messager de colère, le froid avait accepté, pour le compte de Dieu, le défi moqueur: Les fusils échappaient de leurs mains roidies !...
C'est à ce moment lugubre que l'histoire place un horrible épisode dont la honte a rejailli sur le nom d'Israël. Il se rattache à l'épouvantable scène du passage de la Bérésina, alors que, pour les survivants, l'horreur grandissait à chaque pas et que le froid s'était encore accru, le thermomètre étant descendu à 35 degrés. C'est le comte de Ségur qui parle, un témoin:
« Vingt mille Français étaient restés à Wilna, malades, blessés, épuisés de fatigue. A la vérité, les Lithuaniens, que nous abandonnions après les avoir tant compromis, en recueillirent et en secoururent quelques-uns; mais les juifs, que nous avions protégés, repoussèrent les autres. Ils firent bien plus. La vue de tant de douleurs irrita leur cupidité. Toutefois, si leur infâme avarice, spéculant sur nos misères, se fût contentée de vendre au poids de l'or de faibles secours, l'histoire dédaignerait de salir ses pages de ce détail dégoûtant; mais qu'ils aient attiré nos malheureux blessés dans leurs demeures pour les dépouiller, et qu'ensuite, à la vue des Russes, ils aient précipité par les portes et les fenêtres de leurs maisons ces victimes nues et mourantes; que, là, ils les aient laissées impitoyablement périr de froid; que même ces vils barbares se soient fait un mérite aux yeux des Russes de les y torturer: des crimes si horribles doivent être dénoncés aux siècles présents et à venir ! Aujourd'hui que nos mains sont impuissantes, il se peut que notre indignation contre ces monstres soit leur seule punition sur cette terre; mais enfin, les assassins rejoindront un jour les victimes, et là sans doute, dans la justice du ciel, nous trouverons notre vengeance (258). »
L'explosion de douleur et d'indignation du témoin s'est en quelque sorte glacée, à son tour, pour subsister: qui ne la partage ? qui n'est avec lui ? Nous-mêmes ! Nous apercevons ces blessés agonisant attirés et recueillis dans ces cruelles demeures, dénudés par ces mains rapaces, puis rejetés dans le froid terrible par les portes et les fenêtres: peuple d'Israël, garde, oh ! garde ce souvenir horrible, pour le jour de tes larmes et de tes expiations ! La vengeance, inscrite au ciel, est remise à la charité sur la terre !...
A côté de l'action barbare des juifs, il faut bien placer aussi, comme conclusion de l'effroyable campagne de Russie, un langage, également barbare, de Napoléon. Avant de monter sur le traîneau qui l'emmena loin des restes de sa malheureuse armée, il rédigea le célèbre trente-neuvième bulletin, où il apprenait à l'Europe étonnée que sa grande armée avait été vaincue par le froid. Il le terminait par ces mots: La santé de Sa Majesté ne fut jamais meilleure.
« Qu'un million de veuves et d'amantes se consolent ! il se porte bien, et cet homme n'a pas un mot de compassion pour les morts, pas un mot de consolation pour les survivants ! »
C'est la réflexion amère de l'historien Cantu (259). Elle est à placer dans le voisinage de l'indignation contre les juifs.
V
Anticipons, un instant, sur les événements: nous sommes au 17 mars 1818.
A cette date, le vieux coq des juiveries riait: Il y avait dix ans !...
Napoléon n'était plus en Europe: mort, sans avoir quitté la vie;
Son fameux décret du 17 mars 1808 lui ressemblait: lettre morte, sans avoir été retiré du Bulletin des Lois (260).
Au contraire, deux mystérieuses existences, auxquelles la durée a été promise, refoulées un instant et comprimées par la main de fer du despote, avaient repris le cours paisible de leurs destinées: le Pape était rentré dans Rome, et le peuple d'Israël était rentré dans la liberté. Napoléon avait usé son génie à soumettre à sa discipline ces deux existences.
Dans la lutte entre lui et le Pape, le dernier mot était resté au Pape:
Il y a de ces retours où les vues de la Providence sont transparentes. La dernière étape douloureuse de Pie VII avait été Fontainebleau. L'Empereur l'y avait abreuvé d'outrages, jusqu'à lui assigner cinq paoli (2,75 F) par jour. Or, dans ce même palais de Fontainebleau, il dut signer son abdication, et les souverains lui assignèrent l'île d'Elbe... Pie VII rentra dans Rome au milieu de l'enthousiasme indescriptible de ses sujets; au pont Milvius, la foule détela les chevaux de sa voiture et trente jeunes gens des familles les plus distinguées de Rome la traînèrent jusqu'à Saint-Pierre, le Pape versait des larmes de joie; l'émotion était immense, elle fut portée à son comble lorsque le vénérable Pontife, descendu de voiture, se mit à gravir lentement, d'un air radieux, les degrés de sa basilique; aux acclamations, se mêlaient des sanglots. A l'heure où le prisonnier de Fontainebleau rentrait ainsi dans le palais des Papes, Napoléon abordait à l'île d'Elbe, le seul coin de terre qui lui eût été laissé; il n'en devait plus sortir que pour remettre l'Europe en feu pendant trois mois et s'en aller, autant repoussé par les épouses et les mères qu'emmené par des geôliers, finir lugubrement sa vie sur un rocher.
Dans la lutte entre lui et les fils d'Israël, le dernier mot était aussi resté aux israélites;
Tandis que tombait, comme un barrage inutile, le décret du 17 mars 1808, ce peuple conservait toutes les positions qu'il avait conquises sous la Révolution et l'Empire:
L'installation des citoyens israélites dans la Déclaration des droits de l'homme;
L'installation du culte israélite au Bulletin des Lois;
L'installation des consistoires israélites dans les principales villes de France;
L'installation prochaine du rabbinat au budget des cultes;
L'installation des noms israélites dans la langue française;
L’installation des soldats israélites dans l'armée;
Et partout ailleurs, d'autres installations vont se faire.
Ainsi les juifs avaient repris leur marche en avant, imposée d'abord, puis résolument gardée et défendue, à travers les événements de France. Il y a plus. Maintenant qu'ils se sentaient établis dans de fortes et solides positions en France et dans les pays limitrophes, ils allaient, eux aussi, songer à un empire. En effet, durant les Cent-Jours, entre l'île d'Elbe et l'île Sainte-Hélène, quelque chose de bien singulier s'était passé:
L'histoire a enregistré la mélancolie et les larmes de Charlemagne, au déclin de sa vie. On lui avait rapporté que les Saxons et les Normands, insultant à sa vieillesse, venaient piller les rivages de ses Etats. Vainement, pour les châtier, avait-il construit de gros et forts bateaux: les pillards lui échappaient, sur leurs barques légères, insaisissables. Un jour, de la fenêtre d'un de ses palais, il les vit de ses propres yeux sillonnant la mer du Nord: ils avaient disparu à l'horizon que son œil pensif les suivait encore. Charlemagne versa des larmes.
Les grands génies n'ont-ils pas, comme les mères, des perplexités touchantes ?
Napoléon aurait-il eu les siennes ? L'histoire lui en prête. Il aurait entrevu les Cosaques maîtres en Europe avant la fin du siècle, et sa paupière d'aigle serait demeurée impassible. Mais si, sur cette mer du Nord où Charlemagne avait suivi, d'un regard mélancolique, les barques normandes, l'Empereur avait aperçu, le soir de Waterloo, la barque d'un juif voguant, pour aller inaugurer un empire qui devait succéder au sien, peut-être eut-il versé des larmes, lui qui ne savait pas pleurer !...
CHAPITRE III
ROTHSCHILD ET WATERLOO
I. La maison de l'Enseigne rouge dans la vieille rue des juifs à Francfort: berceau et commencement d'une dynastie financière. — II. Nathan Rothschild et le duc de Wellington. —
III. Mont Saint-Jean: l’agonie de l'aigle sous l’œil du vautour. — IV. La barque du millionnaire à travers l'orage et le coup de Bourse à Londres. — V. Jugement sur le gain de trente millions — VI. Un nouvel empire à l'horizon.
I
Gœthe a décrit ainsi l'aspect de la Judengasse ou quartier juif de Francfort: « Rue étroite, triste et sale, aux maisons enfumées, à la population grouillante. » Il y avait là une maison ornée d'une enseigne rouge (roth Schild). C'est à cette enseigne, à cet écu rouge, que se rattache le nom de la famille qui allait devenir la plus opulente de l'univers. Une dynastie d'un nouveau genre devait sortir de cet endroit humilié.
Un certain Moïse Anselme (Moses Amschel), brocanteur de curiosités et de vieilles médailles, gagnait sa vie en colportant de village en village sa modeste balle sur son dos. On raconte de lui un trait qui peint bien sa caractéristique prudence. Chemin faisant, il rencontra un jour un de ses compatriotes, colporteur comme lui, mais plus fortuné que lui, puisqu'il possédait un âne. Sur l'offre obligeante qui lui en fut faite, Amschel Moses s'allégea de son fardeau, qu'il déposa sur le bât. Arrivés au bord d'un ravin profond, sur lequel on avait jeté un branlant pont de planches, il arrêta l'âne, reprit sa balle, répondant à son compagnon qui le raillait: « Il arrive parfois des accidents dans des passages comme celui-ci, et puisque cette balle contient tout ce que je possède, vous ne me saurez pas mauvais gré d'être prudent. » Bien lui en prit de l'être, car l'âne et son conducteur s'étaient à peine engagés sur le pont qu'il s'effondrait sous leur double poids, les entraînant dans l'abîme (261).
Mayer-Amschel, son fils, naquit en 1743. Destiné par ses parents à devenir rabbin, il fut envoyé à Furth pour y suivre un cours de théologie juive; mais la vocation lui faisait défaut. Son goût le portait à collectionner, et à trafiquer de vieilles médailles et anciennes monnaies; il se lia avec des numismates qui apprécièrent sa sagacité et son jugement, et entra comme employé dans la maison de banque des Oppenheim de Hanovre. Il y resta quelques années, très estimé des chefs de cette maison. Sobre, économe, actif, il mit de côté quelque argent et s'établit pour son compte, achetant et vendant médailles et monnaies, joignant à ce commerce, dans lequel il était passé maître, celui des objets d'art, des métaux précieux, des avances sur dépôts, jusqu'au jour où il put se consacrer exclusivement aux opérations de banque.
Ce fut lui qui fit l'achat de la vieille maison à l'Enseigne rouge de la Judengasse de Francfort. En y entrant, il en prit le nom, et devint Rothschild. La Fortune signa cette appellation.
Il y établit sa femme, Gudula Schnappe, la mère de tous les Rothschild, des cinq Crésus modernes. L'humble juive n'allait-elle pas faire pendant à Marie-Laetitia Ramolino, la mère de la famille des rois du nom de Napoléon ? Disons en passant qu'elle ne consentit jamais à quitter, pour un plus brillant séjour, la maison de l'Enseigne rouge: elle l'habita jusqu'en 1849; elle s'y éteignit doucement, dans sa quatre-vingt-seizième année.
A sa réputation d'habileté, Mayer-Anselme Rothschild joignait celle d'une rare intégrité. On l'appelait l'honnête juif. Il sut gagner la confiance du landgrave ou électeur de Hesse-Cassel, Guillaume IX. Ce souverain s'était formé un trésor, un amas d'or, de pierres précieuses. En 1806, survint la grande débâcle des petits princes allemands: leurs principautés furent envahies de toutes parts par les armées de Napoléon. On vint annoncer à Guillaume IX l'envahissement de ses petits Etats: précipitamment, il fit venir en secret, dans son palais, Mayer-Anselme. De cette entrevue et de ce qui la suivit date la grandeur de la maison Rothschild.
Les détails précis en étaient peu connus. Les mémoires d'un témoin, d'un contemporain, du général baron de Marbot, ont apporté une propice lumière; laissons-le parler:
« Obligé de quitter Cassel à la hâte pour se réfugier en Angleterre, l'Electeur de Hesse, qui passait pour le plus riche capitaliste d'Europe, ne pouvant emporter la totalité de son trésor, fit venir un juif francfortois, nommé Rothschild, banquier de troisième ordre et peu marquant, mais connu pour la scrupuleuse régularité avec laquelle il pratiquait sa religion, ce qui détermina l'Electeur à lui confier quinze millions en espèces. Les intérêts de cet argent devaient appartenir au banquier qui ne serait tenu qu'à rendre le capital.
« Le palais de Cassel ayant été occupé par nos troupes, les agents du Trésor français y saisirent des valeurs considérables, surtout en tableaux; mais on n'y trouva pas d'argent monnayé. Il paraissait cependant impossible que, dans sa fuite précipitée, l'Electeur eût enlevé la totalité de son immense fortune. Or, comme d'après ce qu'on était convenu d'appeler les lois de la guerre, les capitaux et les revenus des valeurs trouvées en pays ennemi appartiennent de droit au vainqueur, on voulut savoir ce qu'était devenu le trésor de Cassel. Les informations prises à ce sujet ayant fait connaître qu'avant son départ, l'Electeur avait passé une journée entière avec le juif Rothschild, une Commission impériale se rendit chez celui-ci, dont la caisse et les registres furent minutieusement examinés. Mais ce fut en vain: on ne trouva aucune trace du dépôt fait par l'Electeur. Les menaces et l'intimidation n'eurent aucun succès, de sorte que la Commission, bien persuadée qu'aucun intérêt mondain ne déterminerait un homme aussi religieux que Rothschild à se parjurer, voulut lui déférer le serment. Il refusa de le prêter. Il fut question de l'arrêter; mais l'Empereur s'opposa à cet acte de violence, le jugeant inefficace. On eut alors recours à un moyen fort peu honorable. Ne pouvant vaincre la résistance du banquier, on espéra le gagner par l'appât du gain: on lui proposa de lui laisser la moitié du trésor s'il voulait livrer l'autre à l'administration française; celle-ci lui donnerait un récépissé de la totalité, accompagné d'un acte de saisie, prouvant qu'il n'avait fait que céder à la force, ce qui le mettrait à l'abri de toute réclamation; mais la probité du juif fit encore repousser ce moyen, et, de guerre lasse, on le laissa en repos.
« Les quinze millions restèrent donc entre les mains de Rothschild depuis 1806 jusqu'à la chute de l'Empire en 1814. A cette époque, l'Electeur étant rentré dans ses Etats, le banquier francfortois lui rendit exactement le dépôt qu'il lui avait confié. Vous figurez-vous quelle somme considérable avait dû produire, dans un laps de temps de huit années, un capital de quinze millions entre les mains d'un banquier juif et francfortois !... Aussi, est-ce de cette époque que date l'opulence de la maison des frères Rothschild, qui durent ainsi à la probité de leur père la haute position financière qu'ils occupent aujourd'hui dans tous les pays civilisés (262). »
Ce ne fut pas le vieux Mayer-Anselme qui eut la consolation de remettre entre les mains de l'Electeur le trésor confié; ce soin fut laissé à son fils Nathan (en 1814). Le fidèle dépositaire était mort le 13 septembre 1812. Avant de mourir, il avait rassemblé autour de son lit ses cinq fils Anselme, Salomon, Nathan, James et Charles, et leur avait dit: Restez toujours fidèles à la Loi de Moïse; — ne vous séparez jamais; — ne faites rien sans les conseils de votre mère; si vous observez ces trois préceptes que je vous donne, vous deviendrez riches parmi les plus riches, et le monde vous appartiendra (263). On doit convenir qu'il y avait dans ces recommandations quelque parcelle de l'ancienne grandeur patriarcale ! Les prédictions du vieux Francfortois devaient se réaliser. Une dynastie financière était fondée.
II
A la mort du père, les cinq fils, tout en restant unis, se répandirent dans le monde: Salomon alla à Vienne, Nathan alla à Londres, James vint à Paris, Charles prit Naples, tandis qu'Anselme, l'aîné, celui qui portait le nom du père, garda la maison de Francfort.
Cinq Rothschild tenaient ainsi les cinq grands marchés financiers de l'Europe. Forts de leur union, de leurs capitaux accumulés, du nom de leur père, ils étaient prêts à profiter des événements qui se précipitaient, des changements que devait amener la chute de l'Empire, imminente et prévue. Sentinelles d'un nouveau genre, ils se renvoyaient l'un à l'autre, de leurs observatoires, le mot de garde des anciens remparts de Jérusalem: Sentinelle, qu'avez-vous recueilli de cette nuit ? Sentinelle, qu'avez-vous vu dans la nuit (264) ?
Le Rothschild de Londres était Nathan. C'est lui que son père avait chargé de rapporter à l'Electeur de Hesse les quinze millions confiés. Il les avait eus, du reste, en sa possession dès 1806, pour les faire valoir: « Mon père m'avait expédié ces fonds dont je tirai si bon parti, que le prince me fit plus tard présent de tout son vin et de son linge (265). » Ce Rothschild anglais était de beaucoup le plus original de la famille. Lorsqu'il s'était établi en Angleterre et qu'il avait tenté la fortune au Stock-Exchange (Bourse de Londres), les premières fois, on s'était peu occupé de lui, « et les têtes grises des vétérans de la Bourse traitèrent avec quelque dédain le fils du banquier de Francfort. Mais il avait conquis rapidement sa place, quand on l'avait vu "en cinq années retourner 2.500 fois son capital", organiser un service spécial de courriers, consacrer des sommes considérables à l'achat de pigeons voyageurs, multiplier les moyens d'informations sûres et promptes ». La chute de l'Empire et la bataille de Waterloo devaient lui fournir l'occasion décisive d'inaugurer, sur le premier marché du monde, sa suprématie financière (266).
Nathan Rothschild avait pour ami le duc de Wellington. Cette amitié datait de la guerre d'Espagne. Le Gouvernement britannique, fort embarrassé pour faire parvenir régulièrement au duc de Wellington les fonds qui lui étaient nécessaires, s'était adressé à la maison Rothschild. Elle s'en acquitta avec ponctualité, inaugurant une neutralité qui consistait à fournir de l'or à ceux qui croisent le fer. Le poète a dit:
De peur d'endosser la cuirasse, Tu sers avec fidélité Une damoiselle de glace Qu'on appelle Neutralité (267).
Dans la maison Rothschild, la demoiselle était d'or...
Cette mission d'intermédiaire valut à l'opulente maison, en huit années, 1.200.000 livres sterling (30 millions), et créa des rapports étroits entre le duc de Wellington et Nathan Rothschild.
L'Europe respirait depuis que Napoléon était relégué dans l'île d'Elbe: c'était le triomphe de l'Angleterre.
Tout à coup éclate, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, la nouvelle du débarquement de l'Empereur au golfe Juan, de sa marche rapide sur Paris et de la fuite des Bourbons. L'Europe fut déconcertée, et le marché de Londres, bouleversé.
Peu après, le duc de Wellington vient prendre, en Belgique, le commandement des forces anglaises; et Nathan Rothschild, son ami, comprenant que le sort de l'Europe va dépendre de la première bataille et se fiant peu à la sagacité de ses correspondants, quitte Londres et arrive à Bruxelles. Puis il suit l'état-major du duc de Wellington à Waterloo.
III
L'aigle, « après avoir volé, de clocher en clocher, jusqu'aux tours de Notre-Dame », était venu se placer sur un arbre du champ de Waterloo;
A l'opposite, sur une ruine, regardait un vautour.
L'arbre mélancolique de l'aigle n'est pas complètement une fiction. Un contemporain de cette solennelle journée semble s'être appuyé contre; Chateaubriand a écrit: « Nous nous trouvions devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblon; nous traversâmes le chemin, et nous nous appuyâmes debout contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé nous apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette grande bataille encore sans nom, dont nous écoutions les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo !
« Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, nous aurions été moins ému si nous eussions été dans la mêlée: le péril, le feu, la cohue de la mort ne nous auraient pas laissé le temps de méditer; mais seul sous un arbre, dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui paissaient autour de nous, le poids des réflexions nous accablait. Quel était ce combat ? Etait-il définitif ? Napoléon était-il là en personne ? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort ? Succès ou revers de l'une ou l'autre armée, quelle serait la conséquence de l'événement pour les peuples, liberté ou esclavage ? Mais quel sang coulait ? Chaque bruit parvenu à notre oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français ? Etait-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouveau d'Azincourt dont allaient jouir les plus implacables ennemis de la France ? S'ils triomphaient, notre gloire n'était-elle pas perdue ? Si Napoléon l'emportait, que devenait la liberté (268) ? »
Napoléon était bien là en personne. Il avait confié de nouveau sa fortune aux champs de bataille, pour y acquérir le droit de tout pouvoir à son gré. Les souverains, réunis à Vienne, avaient mis sa tête à prix, comme aux temps barbares, en la taxant à deux millions. Trois armées, dont l'effectif devait dépasser huit cent mille hommes, s'étaient mises en marche pour l'écraser sous leurs poids: les Anglais, sous les ordres de Wellington; les Autrichiens, commandés par Schwartzenberg; les Prussiens, par Blücher. Mais Napoléon était encore le génie des batailles; il venait d'infliger des pertes énormes à Blücher en avant de Fleurus, au village de Ligny; et quarante-huit heures après, aigle au dernier vol impétueux, il attaquait Wellington au mont Saint-Jean, près de Waterloo.
Mais l'aigle était également sa vieille garde. A l'encontre des souverains qui l'avaient exclu d'une manière aussi étrange des lois de l'humanité en mettant sa tête à prix, ses soldats ne pensaient plus qu'à verser une dernière fois leur sang pour le défendre. A son retour de l'île d'Elbe, il leur avait dit, en leur rendant leurs aigles, et en présentant le petit bataillon qui l'avait accompagné dans son île: « Soldats ! voici les officiers du bataillon qui m'a accompagné dans mon malheur: ils sont tous mes amis; ils étaient chers à mon cœur. Toutes les fois que je les voyais, ils me représentaient les différents régiments de l'armée. Dans ces six cents braves, il y a des hommes de tous les régiments; tous me rappelaient ces grandes journées dont le souvenir m'est si cher: car tous sont couverts d'honorables cicatrices reçues à ces batailles mémorables. En les aimant, c'est vous tous, soldats de l'armée française, que j'aimais !... Ils vous rapportent ces aigles; qu'elles vous servent de ralliement; en les donnant à la garde, je les donne à toute l'armée; la trahison et des circonstances malheureuses les avaient couvertes d'un voile funèbre; mais, grâce au peuple français et à vous, elles reparaissent resplendissantes de toute leur gloire. Jurez qu'elles se trouveront toujours et partout où l'intérêt de la patrie les appellera ! Que les traîtres et ceux qui voudraient envahir notre territoire n'en puissent jamais soutenir les regards ! »
Un frémissement général dans les rangs de la garde, avait été la réponse d'un dévouement jusqu'à la mort: ce dévouement venait tenir sa parole à Waterloo.
C'est bien l'aigle !
En face, regardait le vautour.
Ce n'est pas nous qui infligeons à Nathan Rothschild cette appellation, nous ne faisons que la relater. Dans une brochure que nous avons sous les yeux, datée de l'année 1846, se trouve ce pénible passage: « La corruption engendre les vers. Les cadavres attirent les vautours. Les grandes catastrophes font vivre les agioteurs. Les destins de l'Europe allaient être décidés à Mont-Saint-Jean. Le vautour avait suivi la trace de l'aigle. Nathan Rothschild était en Belgique, les yeux fixés sur Waterloo (269). »
Dans ce peu de lignes, quel portrait ! Ni manteau broché d'or, ni titres de noblesse, ne corrigeront jamais la physionomie de ce Nathan, venu en spéculateur de ce solennel désastre. Les livres d'histoire naturelle caractérisent le vautour par des yeux à fleur de tête: quels yeux à fleur de tête l'anxiété du gain devait donner au financier, qui suivait l'état-major du duc de Wellington !
Alors se déploya le dernier vol de l'aigle, puis son agonie.
Au mont Saint-Jean, Wellington s'était fortifié dans une position défensive, très favorable au froid courage britannique.
En le voyant adossé à une forêt presque sans issue, l'Empereur calcule qu'il peut lui faire essuyer un désastre, et malgré la fatigue de ses soldats et une boue affreuse, il n'y résiste pas.
Séparé des Anglais par un petit vallon, par-dessus lequel sa grosse artillerie les foudroie, il charge Ney de franchir cet espace et de percer leur centre. Les pentes sont enlevées; Ney s'établit sur le bord opposé. Des canons, des troupes fraîches, et la bataille est gagnée... Mais, en voulant le suivre, les pièces restent embourbées au pied des hauteurs, et en même temps les réserves sont obligées de faire face à trente mille Prussiens subitement apparus sur la droite. C'était l'avant-garde de Blücher, commandée par Bulow.
En dépit de ces accidents, les Français se maintiennent sur le plateau, et les efforts de Wellington n'aboutissent qu'à retarder sa défaite jusqu'à 7 heures du soir. Il se croit perdu, quand tout à coup une vaste rumeur parcourt le champ de bataille.
Qu'apporte cette rumeur ?
Après avoir battu Blücher à Ligny, Napoléon avait chargé Grouchy de le surveiller et de l'empêcher de passer, tandis que lui-même irait attaquer Wellington au mont Saint-Jean. Or, dans le milieu du jour, l'avant-garde prussienne était arrivée au secours des Anglais: elle avait passé. Et vers le soir, Blücher en personne, ayant passé aussi, se présentait avec le reste de ses forces sur le champ de bataille de Waterloo (270).
« Voilà Grouchy ! enfin Grouchy, mais à temps ! » se disent entre eux les braves exténués de l'armée française ! Epouvantable déception, sans pareille dans l'histoire des combats !
Ces braves sont exténués, et les troupes de Blücher sont fraîches. Une nouvelle bataille à 8 heures du soir est devenue impossible: ils se rejettent les uns sur les autres. Ce n'est plus une lutte, mais le massacre dans une effroyable déroute.
La garde, cependant, est restée impassible. Elle s'est formée en plusieurs carrés; avec elle, l'aigle saura mourir ! « Autour de cette phalange immobile, le débordement des fuyards entraîne tout, parmi des flots de poussière, de fumée ardente et de mitraille, dans des ténèbres sillonnées de fusées à la Congreve, au milieu des rugissements de trois cents pièces d'artillerie et du galop précipité de vingt-cinq mille chevaux: c'était comme le sommaire final de toutes les batailles de l'empire. Deux fois, les Français ont crié: Victoire ! Deux fois leurs cris sont étouffés sous la pression des colonnes ennemies. Le feu de nos lignes s'éteint; les cartouches sont épuisées; quelques grenadiers blessés, au milieu de quarante mille morts, de cent mille boulets sanglants, refroidis et conglobés à leurs pieds, restent debout appuyés sur leur mousquet, baïonnette brisée, canon sans charge. Non loin d'eux, l'homme des batailles, assis à l'écart, écoutait, l'œil fixe, le dernier coup de canon qu'il devait entendre de sa vie (271). »
Il se demanda s'il n'entrerait pas dans un carré de sa garde pour succomber avec elle: ses généraux l'emmenèrent de force.
Retournons à d'autres anxiétés, celles de l'homme du gain.
Nathan Rothschild s'est mêlé à l'état-major du duc de Wellington. « Pendant toute cette journée mémorable du 18 juin, il ne quitta pas le terrain, interrogeant anxieusement Pozzo di Borgo, le général Alava, le baron Vincent, le baron Muffling, passant avec eux de la crainte à l'espoir, voyant tout compromis, quand Napoléon lançait sur les carrés anglais cette masse de vingt mille cavaliers, les plus aguerris et les plus redoutables de l'Europe; estimant tout perdu quand la garde gravit, l'arme au bras, le ravin de Mont-Saint-Jean. Sur ce grand tapis vert où se jouaient les destinées de l'Europe, se jouait aussi sa ruine ou sa fortune. Son étoile l'emporta; il vit l'invincible colonne osciller, sous les décharges répétées de deux cents pièces d'artillerie, comme un immense serpent frappé à la tête, et sentit tout sauvé quand l'avantgarde de Blücher déboucha des défilés de Saint-Lambert (272). »
Eperonnant alors son cheval, il regagne Bruxelles l'un des premiers, se jette dans sa chaise de poste et, le matin du 19 juin, il arrivait à Ostende.
IV
La mer est affreuse.
Aucun pêcheur ne veut risquer la traversée. Vainement Rothschild offrait 500-600-800-1.000 francs: nul n'ose accepter. Mais est-il quelque chose d'insurmontable à la cupidité ? Enfin l'un d'eux consent à transporter de l'autre côté du détroit le millionnaire, moyennant une somme de
2.000 F que Nathan compte à sa femme, le pauvre homme doutant fort de revoir sa cabane et sa compagne !
La barque s'éloigne.
Au large, la tempête se calmait. Jamais le proverbe que la Fortune est avec les audacieux ne trouva plus complète application.
Etrange barque, tu peux bien rappeler, par ton audace heureuse, celle de César: mais ne rappelles-tu pas plus justement, sur cette mer du Nord, la barque des Normands qui fit pleurer Charlemagne ?...
Le même soir, Nathan Rothschild abordait à Douvres. « Brisé de fatigue, il réussit cependant à se procurer des chevaux de poste. Le lendemain, on le retrouvait à sa place habituelle, appuyé de côté à une des colonnes du Stock-Exchange, le visage pâle et défait comme celui d'un homme que vient d'atteindre un coup terrible. Le désarroi et la stupeur régnaient à la Bourse, et l'abattement de Rothschild n'était guère de nature à rassurer qui que ce soit. On l'observait, on échangeait des coups d'œil significatifs, on prévoyait de désastreuses nouvelles. Ne savait-on pas qu'il arrivait du continent et que ses agents vendaient ? Dans la vaste salle silencieuse, secouée par moments de bruyantes clameurs, les spéculateurs erraient comme des âmes en peine, discutant à voix basse l'attitude affaissée du grand financier. Ce fut bien pis quand le bruit courut qu'un ami de Rothschild dit tenir de lui que Blücher, avec ses cent dix-sept mille Prussiens, avait essuyé une terrible défaite, le 16 et le 17 juin, à Ligny, et que Wellington, réduit à une poignée de soldats, ne pouvait espérer tenir tête à Napoléon victorieux, libre désormais de disposer de toutes ses forces. Ces bruits se répandirent comme une traînée de poudre dans la cité. Les fonds baissèrent encore; on considérait la partie comme perdue.
« Pourtant, quelques fous semblaient tenir bon encore, car on signalait, par moments, des achats importants, suivis d'accalmie. On les attribuait à des ordres venus du dehors, donnés la veille par des spéculateurs mal renseignés; ils se produisaient quand le découragement s'accentuait, intermittents et comme au hasard.
« Cette journée, puis la matinée du lendemain, s'écoulèrent ainsi. Dans l'après-midi seulement, éclata la nouvelle de la victoire des alliés. Nathan lui-même, le visage radieux, la confirmait à qui voulait l'entendre. D'un bond, la Bourse remonta aux plus hauts cours. On plaignait Rothschild; on supputait le chiffre de ses pertes; on ignorait que, s'il avait fait vendre par ses courtiers connus, il avait fait acheter, sur une bien plus vaste échelle, par des agents secrets, et que, loin d'être en perte, il réalisait plus d'un million de livres sterling de bénéfice (273). »
Un coup de filet de trente millions de francs: jamais la mer du Nord ne s'était révélée si poissonneuse !
V
Que doit-on penser d'un pareil gain ? et quelle impression en est-il resté dans les esprits ?
Il semble qu'au point de vue de la morale on doive considérer cinq choses autour de ce lucre tiré de Waterloo.
L'entreprise, Les chances, L'opération financière, Le silence gardé par Rothschild sur l'issue de la bataille.
La feinte avec laquelle il a agi.
L'entreprise ? — Elle a été, pour lui, pleine de fatigues et de dangers.
Les chances ? — Elles ont été incertaines au début, puisque nul batelier ne voulait diriger la frêle embarcation, et qu'il s'est exposé, devant une mer mugissante, à être englouti.
L'opération financière ? — Elle lui était permise, attendu que la Bourse de Londres existait depuis l'an 1571, inaugurée par Elisabeth sous le nom de Royal-Exchange. Maints banquiers et financiers lui donnaient l'exemple des opérations.
Le silence sur l'issue de la bataille de Waterloo ? — Il n'était pas tenu d'en sortir, vu qu'il n'était qu'un simple particulier, sans rôle officiel, nullement chargé de renseigner le public.
Mais la feinte avec laquelle il a agi ? — Ah ! c'est là la ligne noire sur le lucre des trente millions.
En apercevant, dans la salle de la Bourse, ce visage abattu, funèbre, de Rothschild en prêtant l'oreille au récit de la défaite de Blücher à Ligny, on se hâtait de vendre, de se débarrasser de ses titres: ne les eut-on pas gardés sans ce visage, sans ce récit ? Les uns disent: C'est probable. Les autres disent: Les mauvaises nouvelles, apportées par les courriers officiels et confirmées par les hommes d'Etat, suffisaient à l'effondrement du marché. Ils ajoutent: Rothschild n'était pas tenu d'avoir un visage différent des événements connus, ni d'apporter d'autres récits que ceux qui se lisaient au journal officiel. Le mieux pour l'israélite eût été, assurément, de se tenir enfermé chez lui, tout en faisant acheter par des agents secrets les titres en baisse sous l'impression de la débâcle, mais sans augmenter et presser la débâcle par sa présence affaissée et son air lugubre.
A la suite de cette investigation morale, doit-on dire que le lucre de Waterloo tombe sous le coup de la sentence de Mabillon: Que les fortunes énormes et mal acquises sont un scandale public et révoltant ?
Les avis seront, sans nul doute, partagés, dans un monde superficiel. Mais le sentiment favorable à Nathan Rothschild aura peine à expliquer et à dissiper l'impression douloureuse qui en est restée dans les esprits, et dont nous ne rapportons que l'écho le plus respectueux:
« Impossible de voir une fortune dont l'origine soit plus honorable (le dépôt confié par le landgrave de Hesse-Cassel). Mais un fleuve, clair à sa source et dégagé de fange, ne roule pas toujours vers son embouchure des flots aussi limpides... Le lendemain de la bataille de Waterloo, Nathan Rothschild réalisa, sans trouble et sans remords, un coup de filet de trente millions (274). »
Emue de cette déviation, plus encore que des interprétations défavorables, l'opulente famille s'efforcera, dans la suite, de rappeler la clarté de sa source et de repousser la fange, en creusant, au milieu de sa colossale fortune, un lit superbe à la bienfaisance:
La morale chrétienne inspirerait mieux encore !...
VI
M. de Chateaubriand, rapportant les pourparlers de hauts personnages après les événements que nous venons de raconter, caractérisait la puissance de l'un d'eux par cette phrase:
« Le MAITRE DES ROIS repartit: Il faut savoir si on lui en laissera le temps (275) ! »
Il semble, à la majesté du qualificatif et à la suffisance de la réponse, qu'on soit ramené par l'écrivain à l'épisode de Napoléon à Dresde, alors que, dictant la loi à l'Europe, il était environné d'une cour plénière de rois. Qu'on se détrompe: il s'agissait de Rothschild. La plume de Chateaubriand ne s'est point méprise en écrivant: le maître des rois.
En effet, le soir même où finissait et disparaissait l'empire napoléonien, un autre commençait à poindre sur l'horizon. Etrange empire que celui-là ! il ne ressemblera en rien à tous ceux qui l'ont précédé. Dès 1815, le nom emprunté à l'enseigne rouge brille déjà comme celui d'une maison souveraine: le maître des rois s'annonce !
Les moyens que Napoléon a employés pour introduire et a asseoir sa dynastie, Rothschild s'en servira aussi, sous une forme nécessairement hébraïque:
Napoléon est entré dans la famille des rois, en soldat couronné, avec armes et bagages; son mariage fut une conquête. — Rothschild y entrera, non par la chambre nuptiale, mais par la chambre du Trésor; et la vieille Europe n'en sera ni moins stupéfaite ni moins silencieuse.
Napoléon avait imaginé de faire des rois. Ne donnait-il pas des trônes à tous ses frères, « afin de créer, disait-il, des points d'appui et des centres de correspondance au grand Empire » ? — La maison Rothschild s'installe et trône bientôt dans cinq capitales de l'Europe, à Francfort, à Londres, à Vienne, à Naples, à Paris. Disposant d'énormes capitaux, les cinq frères établissent dans tous les coins de l'Europe des bureaux de correspondance. On les informe des moindres fluctuations des fonds publics. Ils n'opèrent qu'à coup sûr, et leurs opérations sont enveloppées du secret le plus impénétrable. L'or afflue dans leurs caisses comme une marée toujours grossissante. D'un bout du continent à l'autre, les rois les comblent d'honneurs.
Napoléon disait: « Où est Drouot ? » pour l'artillerie; « Où est Murat ? » pour la cavalerie. — Les rois et les gouvernements diront: « Où est Rothschild ? » C'est la coalition des capitaux qui commence, autrement puissante que celle des armées. Conquérants d'un nouveau genre, les capitaux marchent plus sûrement à la suprématie que l'épée de César.
Etrange et insolite empire ! redisons-nous. Il n'y aura que l'Eglise qui, en passant devant l'enseigne rouge, saluera avec cette fierté dont les premiers chrétiens, dans les arènes, accompagnaient leur salut à César: Ave, Caesar, te judicaturi salutant (276).
L'antique métropole de Notre-Dame de Paris, qui a vu le couronnement du César des aigles, a entendu aussi cette fière et émouvante péroraison, où la prophétie se mêle à l'histoire:
« Quand l'empereur Julien s'attaquait au christianisme par cette ruse de guerre et de violence qui porte son nom, et qu'absent de l'empire, il était allé chercher dans les batailles la consécration d'un pouvoir et d'une popularité qui devaient, dans sa pensée, achever la ruine de Jésus-Christ, un de ses familiers, le rhéteur Libanius, rencontrant un chrétien, lui demanda, par dérision et avec toute l'insulte d'un succès déjà sûr, ce que faisait le Galiléen; le chrétien répondit: Il fait un cercueil. Quelque temps après, Libanius prononçait l'oraison funèbre de Julien devant son corps meurtri et sa puissance évanouie. Ce que faisait alors le Galiléen, il le fait toujours, quels que soient l'arme et l'orgueil qu'on oppose à sa croix. Il serait long d'en déduire tous les fameux exemples; mais nous en avons quelques-uns qui nous touchent de près et par où Jésus-Christ, à l'extrémité des âges, nous a confirmé le néant de ses ennemis. Ainsi, quand Voltaire se frottait de joie les mains, vers la fin de sa vie, en disant à ses fidèles: « Dans vingt ans, Dieu verra beau jeu »; le Galiléen faisait un cercueil: c'était le cercueil de la monarchie française. Ainsi, quand une puissance d'un autre ordre, mais issue de la sienne à quelque degré, tenait le Souverain Pontife dans une captivité qui présageait la chute au moins territoriale du vicaire de Jésus-Christ, le Galiléen faisait un cercueil: c'était le cercueil de Sainte-Hélène. Et toujours en sera-t-il ainsi, le Galiléen ne faisant jamais que deux choses: vivre de sa personne, et mettre au tombeau tout ce qui n'est pas lui (277). »
Cette énumération appelle un complément, une demande et une réponse:
A l'incalculable et prépondérante fortune du maître des rois, le Galiléen prépare-t-il un cercueil ?
Oui, assurément;
Mais fasse le ciel que ce cercueil soit le sépulcre même du Golgotha ! car, à l'entour, le repentir et la richesse pourraient renouveler magnifiquement le plus acclamé des triomphes: celui des larmes et des parfums de Madeleine, la riche juive de Magdala (278) !
CHAPITRE IV CE QUE FUT NAPOLÉON, A LA LUMIÈRE DU LIVRE DE DIEU
I. Comme quoi le Livre de Dieu fournit les éléments d'une appréciation juste de Napoléon. —
II. La Providence lui avait préparé la mission d'un Cyrus: son œuvre en présente l'ébauche. — III. Mais il s'est rapproché d'Hérode le Grand, dans ses passions et par ses attentats. —
IV. Appréhensions de Bonaparte sur son avenir. Un grand homme et son œuvre, au jugement de Dieu.
I
On ne quitte qu'à regret les grands hommes, vivants ou morts. Après avoir étudié Napoléon dans ses rapports avec le peuple d'Israël, nous avons demandé à cette figure extraordinaire la permission de la définir et de la résumer dans un jugement où la Bible fournirait les éléments de vérité.
Beaucoup de jugements ont été portés sur Napoléon.
La plupart, dans le principe, se ressentaient de l'antiquité païenne. C'est un parallèle devenu banal que celui de Napoléon avec César, Annibal, Alexandre. Lui-même, de son vivant, l'appelait et le posait. Une littérature enthousiaste l'a ensuite poussé à l'extrême, trouvant « que l'homme dont le nom remplit le monde et qui s'est emparé du temps, de l'espace. de l'imagination, de la pensée, a sa place marquée au-dessus des Alexandre et des César (279). » Il est hors de conteste, cependant, que, comme guerrier, Napoléon égale, et dépasse même, les plus grands capitaines: jamais nom n'est allé aussi loin que le sien, sur l'aile de la foudre !
Deux historiens, l'un dont la plume est un pinceau, l'autre dont la plume est un scalpel, mais les premiers de tous, l'ont jugé en lui-même, et à fond, dans sa personne, ses entreprises, son œuvre: Thiers et Taine (280). Il y a, comme on a dit avec beaucoup d'esprit, le Napoléon de
M. Thiers et le Napoléon de M. Taine. On convient généralement que tous deux ont péché contre les règles de la perspective, l'un par excès, l'autre par défaut. Thiers, en exagérant les proportions, transporte assez souvent son héros et l'épopée napoléonienne dans le domaine de la légende. Taine, en examinant de trop près, et continuellement, les défauts et les petits côtés de la personne, a rapetissé le grand homme.
Nous osons espérer que notre appréciation sera trouvée juste, parce qu'elle s'isole de tous les partis, et qu'elle s'est inspirée du Livre de Dieu. Lorsqu'il s'agit de parallèles, la Bible fournit des types illuminateurs et sûrs: il y a là une galerie de portraits qui éclaire toutes les autres physionomies. En outre, elle fait éviter ces deux écueils, le danger d'exagérer, et celui de rapetisser: car la Bible est aussi un phare. Nous avons donc côtoyé, à sa lumière, la grande figure; nous étions plein de respect pour la personne, d'admiration pour les prodiges, de tristesse pour les fautes, de compassion pour les malheurs. A l'expiation sur le rocher de Sainte-Hélène, ces vers de Lamartine nous revinrent à la mémoire:
On dit qu'aux derniers jours de sa longue agonie,
Devant l'Eternité seul avec son génie, Son regard vers le ciel parut se soulever: Le signe rédempteur toucha son front farouche... Et même on entendit commencer sur sa bouche Un nom !... qu'il n'osait achever. Achève... C’est le Dieu qui règne et qui couronne; C’est le Dieu qui punit; c'est le Dieu qui pardonne: Pour les héros et nous il a des poids divers. .............................................
Que ce dernier vers est touchant, tout en semblant contenir une erreur ! Dieu n'aura point d'égard à la condition des personnes: saint Paul le déclare (281); mais, à cause des difficultés qui accompagnèrent leur mission, les héros obtiendront, il est permis de l'espérer, la bonne mesure de la miséricorde.
II
Quelle est la plus belle figure de conquérant, au regard de la Bible ?
Est-ce Alexandre ?
Il s'en faut bien !
Le Livre de Dieu, comptant pour peu de chose ses vastes conquêtes et voulant faire comprendre combien il fut misérable avec toute sa gloire, dit:
« La terre se tut devant lui. Son cœur s'éleva et s'enfla. Il se rendit maître des peuples: après quoi il tomba malade sur son lit, et reconnut qu'il devait mourir (282). »
La plus belle figure de conquérant, de fondateur d'empire, célébrée par la Bible, c'est Cyrus. Le nom de Cyrus signifie soleil.
De tous les conquérants, de tous les monarques qui ont existé ou existeront, Cyrus est le seul dont la naissance ait été annoncée, et même, dont le nom ait été prononcé, cent cinquante ans avant son apparition. Voici le superbe passage qui l'annonçait dans Isaïe:
« Moi, le Seigneur, je dis à Cyrus qui est mon Oint, que j'ai pris par la main pour lui assujettir les nations, pour mettre les rois en fuite, pour ouvrir devant lui toutes les portes, sans qu'aucune lui soit fermée: « Je marcherai devant vous; j'humilierai les grands de la terre; je romprai les portes d'airain, et je briserai les gonds de fer. Je vous donnerai les trésors cachés et les richesses secrètes et inconnues, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui vous ai appelé par votre nom (283). »
Eh bien, c'est à ce prince, à ce soleil si magnifiquement annoncé dans la Bible, qu'il convient de comparer Napoléon, durant la période qui s'étend de 1796 à 1807. Chose remarquable, le grand Sanhédrin et M. de Chateaubriand se rencontrèrent pour saluer de cette comparaison la gloire alors grandissante, et pleine de pures espérances, du nouveau chef des Français: Le Sanhédrin, en 1807, au milieu des adulations dangereuses que nous lui avons reprochées (284), fut juste sur ce point : il remercia un nouveau Cyrus;
Et M. de Chateaubriand, en 1802 — avant le Sanhédrin — écrivant sa première préface du Génie du Christianisme, avait l'intuition du rapprochement entre Bonaparte et Cyrus: ce qui devait plus tard lui attirer une fine raillerie (285).
Ni M. de Chateaubriand ni le Sanhédrin ne se trompaient.
Rappelons, en effet, succinctement ce que furent la physionomie et la mission de Cyrus:
Enfant de la Perse, il mit aux pieds de sa patrie le sceptre de l'Asie. Il fonda l'unité de l'Orient. Dans le vaste empire des Perses vinrent se confondre, comme les fleuves dans l'Océan, tous les autres empires. Alors il y eut le siècle de Cyrus. Ce prince fut le héros le plus accompli dont il soit parlé dans l'histoire ancienne. Aucune des qualités qui font les grands hommes ne lui manqua: sagesse, modération, courage, grandeur d'âme, noblesse de sentiments, merveilleuse dextérité pour manier les esprits et gagner les cœurs, profonde connaissance de l'art militaire, prudente fermeté dans l'exécution des vastes projets, intime conviction qu'il n'était sur le trône que pour rendre ses sujets heureux. Il suffit de rapporter cette remarque d'un ancien: que, dans les écoles publiques de la Perse, Cyrus ouvrit un cours de justice aux enfants, comme ailleurs on leur ouvre un cours de lettres. Mais « ce qu'il faut le plus remarquer, dit Bossuet, c'est que ce grand conquérant, dès la première année de son règne, donne son décret pour le rétablissement du Temple de Dieu à Jérusalem. Ravi des oracles qui avaient prédit ses victoires, il avoue qu'il doit son empire au Dieu du ciel que les juifs servaient (286). » Le ravissement de Cyrus auquel Bossuet fait allusion provint de la lecture du célèbre passage d'Isaïe que les juifs captifs à Babylone montrèrent à leur libérateur (287), passage dans lequel la venue et le nom de Cyrus étaient annoncés, comme nous l'avons dit, cent cinquante ans avant sa naissance. Certes, ce privilège unique dans l'histoire, puis la majesté du grand empire qu'il fonda, et surtout son obéissance aux vues de l'Eternel en rétablissant le Temple et le peuple de Dieu, justifient, pour Cyrus, la signification de soleil attachée à son nom.
Or, Napoléon, durant la première période de son règne, put véritablement donner les espérances d'un Cyrus, ramené par la main de la Providence.
Que le lecteur veuille bien se représenter quelqu'une de ces régions polaires soumises à la privation du soleil une partie de l'année. Les habitants ne l'ont plus revu depuis très longtemps. Que de privations ils ont endurées durant ces journées lugubres ! Ils ont vécu dans des cavernes. Ils n'ont entendu que les cris rauques d'oiseaux voraces, que les hurlements des ours. Huit longs mois d'attente ! Mais un matin, un filet d'or a coupé l'horizon: c'est le soleil ! Se figure-t-on la joie de ces pauvres habitants ? Ils le regardent, ils lui parlent, ils le contemplent comme une nouveauté, ils le bénissent comme l'image de la Divinité.
Quelque chose de cette émotion, de cette extase, s'est produite, assurément, à l'apparition de Bonaparte. On avait vécu sous la Terreur. L'horreur, le silence et la nuit avaient fait, de la France, une terre glaciale. D'autre part, Bonaparte était allé en Orient, dans ces contrées mystérieuses d'où vient la lumière. Tout à coup, sans être attendu, il revient d'Egypte, arrive à Paris, et suivi de ses grenadiers et de vingt victoires, lance aux Jacobins cette apostrophe: Qu'avez-vous fait de la France ? C'était l'éclat du soleil qui déchirait la nue et reparaissait sur la France !
Puis, à la suite de cet éclatant lever, que de rayons en tous sens, que d'œuvres fécondées par son génie ! Rien n'échappe à son perçant regard, rien n'est laissé de côté par sa sollicitude. Il répand ses bienfaits sur les chrétiens et sur les israélites, sur les noirs et sur les blancs, sur les armées et sur les écoles, sur la législation et sur l'agriculture: comme l'astre du jour qui luit avec autant de splendeur sur les campagnes paisibles et sur les champs de bataille ! Quelle carrière de gloire que celle qui présente le cortège des maréchaux, les aigles, la garde, la Légion d'honneur; le Concordat et les églises rouvertes; le Code civil et l'Université, dont on n'aperçoit alors que les côtés tutélaires; l'Ecole polytechnique, le creusement des ports et des canaux, la réparation des routes; la Banque de France; la Madeleine et le Panthéon; le pont d'Austerlitz jeté sur la Seine; la colonne Vendôme, l’Arc de Triomphe du Carrousel; l'étonnement de l'Europe, les regards de tous les souverains tournés vers les Tuileries; et pardessus tant de choses illustres, la présence de Pie VII à Notre-Dame pour sacrer Napoléon restaurateur de l'ordre et de la religion dans la société française !
En vérité, devant cet ensemble de services et cette profusion de rayons, n'était-on pas fondé à saluer l'apparition d'un nouveau Cyrus ? La Providence se complaisait dans cette reproduction. L'ébauche en est restée fixée dans la première période de l'Empire. A quatrevingt-dix ans de là, elle ne s'est pas effacée. On vit encore en France sur l'énorme gloire que Napoléon a amassée.
Pourquoi faut-il que cette apologie ne convienne pas à toute l'étendue de l'Empire ? Mais une seconde période fait suite où l'on ne rencontre plus Cyrus. Qui donc rencontre-t-on ?
Une autre figure biblique: Hérode le Grand.
III
Hélas ! oui, quand les traits de Cyrus, que la Providence avait voulu repeindre sur le visage de Napoléon, s'altérèrent, l'Empereur se mit à exprimer Hérode le Grand.
Cet Hérode est celui qui occupe le trône de Judée au moment où le Christ vient au monde.
Que présente le type d'Hérode le Grand ?
Le lecteur nous saura gré de le lui dire, ce monarque étant demeuré inconnu pour beaucoup, sous plus d'un aspect.
Le type d'Hérode le Grand présente la magnificence des vues et l'audace, mais aussi cette furieuse ambition de régner qui a recours à la cruauté, à l'irréligion, à toutes sortes de passions mauvaises.
C'était un parvenu qu'Hérode. Iduméen de nation, il était monté sur le trône de Judée avec l'aide des Romains. Afin qu'on fût forcé de mieux oublier son origine par la perte des traditions des anciennes familles. il fit brûler les archives et toutes les généalogies qui étaient conservées avec soin, depuis des siècles, dans le Temple de Jérusalem. Ombrageux et cruel, il se débarrassa de tous ceux qui le gênaient. Restait un jeune prince, âgé de dix-sept ans, Aristobule III, dernier rejeton des Asmonéens, cher au peuple: il fut noyé dans un bain, par ses ordres. Une fois paisible possesseur du trône, Hérode s'excita à l’accomplissement de choses pompeuses, tant pour l'avantage des Juifs que pour la gloire des Romains, et ce furent ses magnificences qui lui concilièrent le surnom de Grand, qu'Athènes même lui reconnut. Sous le despotisme d'Hérode, on vit s'introduire dans la Palestine le luxe de l'empire romain, avec tous ses vices. Le désordre était autorisé par l'exemple du monarque. Il avait donné le diadème à la belle princesse Mariamne, dont les vertus étaient aussi remarquables que la beauté: il la fit périr par jalousie. Il professait la religion juive, mais il méprisait, au fond du cœur, toutes les lois divines et humaines. Il voulut cependant gagner la faveur des juifs en réparant leur Temple. A ce grand œuvre furent employés dix-huit mille ouvriers, pendant neuf ans. Le nouveau temple surpassa en splendeur celui que Salomon avait bâti. Majestueux sur la colline du Moriah, et dominant une vaste plaine, son aspect, dit Josèphe, frappait chacun d'étonnement et d'admiration. Il était entièrement construit d'un marbre blanc comme la neige, et son faite était revêtu d'or massif: quand il réfléchissait les rayons du soleil, l'œil ne pouvait en supporter l'éclat. Mais Hérode profana cet admirable édifice en plaçant, comme signe de la suprématie spirituelle de César, un grand aigle d'or, sur la principale porte du Temple. Selon la loi de Dieu, il ne devait y avoir aucune figure. Les juifs furent irrités, ils renversèrent l'aigle, et le sang coula à flots dans Jérusalem. Il coula ensuite à Bethléem, dans le massacre des Innocents. Mais pour un tyran tel qu'Hérode, accoutumé à tuer les hommes par centaines, qu'était-ce que ce carnage exercé sur de pauvres enfants de bergers ? Pour faire diversion aux rigueurs et aux cruautés, il occupa les juifs à de nouvelles et énormes constructions. C'est alors que fut bâtie la ville de Césarée avec des palais superbes, que Samarie fut somptueusement agrandie, que le mont Sion fut orné d'une demeure royale où le luxe et le génie prodiguèrent tous les ornements possibles, et qu'aux sources du Jourdain un temple fastueux fut dédié à Auguste. Comme toutes ces constructions étaient dans un style païen, et qu'il y avait là le renversement des mœurs de la patrie, le mécontentement devint général. Hérode le dompta en ne laissant plus au peuple aucun repos. Un temple fut bâti à Apollon dans l'île de Rhodes, des promenades merveilleuses avec des arcades embellirent les rues d'Antioche, et la célébration des jeux olympiques fut rehaussée par des présents considérables qu'il envoya. Il va sans dire qu'un pareil prince ne devait pas laisser intact et tranquille le souverain Pontificat: toutes choses y furent brouillées; les Grands Prêtres ne jouirent plus du droit d'hérédité, ils étaient créés ou destitués selon le caprice du roi. Il bouleversa aussi les noms des villes, et, à l'étonnement du monde entier, l'on vit en Judée les villes d'Antipater, d'Hérodion, d'Archélaus, de Tibériade, etc. Les tours mêmes de Jérusalem prirent les noms de Marianne, d'Antonia, de Phasaëlis, si bien que, plus tard, Adrien n'aura besoin que d'inscrire sur la ville en cendres le nom d'Ælia-Capitolina. Enfin, il mourut, après avoir lassé de meurtres et de corvées la nation juive. Il ne tint presque à rien que sa mort ne fût accompagnée de monstrueuses hécatombes (288). Il expira dans des tourments affreux, rongé par les vers. Il est incontestable, cependant, qu'il eut de grandes qualités et fit de fort belles choses.
Voilà ce que fut Hérode le Grand.
Le rapprochement avec Napoléon ne se présente-t-il pas de lui-même ?
Comme l'Iduméen, le Corse est un parvenu, et, pour garantir la sûreté de son trône et de son empire, il a recours lui aussi, aux moyens les plus terribles, au détrônement des autres rois, et aux passions mauvaises. A côté du meurtre du jeune Aristobule III, noyé dans un bain, ne voit-on pas, venant se ranger lugubrement, le meurtre du duc d'Enghien, fusillé dans les fossés du château de Vincennes ?
Est-ce que la fin tragique de Mariamne, l'épouse aimée, ne fait pas songer au rebut de Joséphine de Beauharnais ?
Du reste, mêmes emportements chez Hérode et chez Napoléon, et aussi mêmes appels à la duplicité: ils savent, l'un et l'autre, mêler à la colère du lion la ruse du renard. Hérode n'eût certainement pas désavoué la mauvaise foi qui rattacha les articles organiques au Concordat; et Napoléon n'eût pas blâmé l'hypocrisie qui, de Jérusalem, guida vers Bethléem les rois Mages, pour les aider à trouver le Messie.
Même cœur de marbre chez tous les deux: mais celui d'Hérode est plus dur.
Tous deux cherchent à faire grand, à éblouir par la magnificence: ils y réussissent. Ils précipitent leurs sujets dans la gloire.
Tous deux ne laissent aucun repos à leurs peuples: Hérode accable la Judée de constructions pompeuses, et Napoléon étouffe la France sous les conquêtes et les couronnes.
Pour l'un comme pour l'autre, la vie de l'homme ne compte pas. L'aigle d'or fait couler le sang à la porte du Temple, et les aigles de l'Empire le font ruisseler sur les champs de bataille.
Il vient un moment où les populations affolées en appellent au Ciel contre les deux tyrans. Mais ils ne disparaissent qu'après avoir révolutionné toutes choses: Hérode a déchiré les archives de l'Etat, brûlé les généalogies des familles, bouleversé jusqu'aux noms des villes; Napoléon a arraché et roulé dans un pêle-mêle européen les frontières, les peuples, les nationalités, les usages.
Ensemble, ils ont porté une main sacrilège sur ce qui est saint: les Grands Prêtres ont été destitués à Jérusalem, le Pape a été enlevé de Rome.
Ils meurent, frappés tous deux par la justice divine: les vers rongent l'un tout vivant, l'autre se ronge lui-même sur le rocher de Sainte-Hélène.
Entre Cyrus et Hérode le Grand, s'éclairant de tous les deux: telle apparaît la physionomie vraie de Napoléon le Grand;
Restauratrice avec le premier, néfaste avec le second;
Sur le premier l'avait calquée la Providence; vers le second l'a entraînée la Révolution.
Il s'est levé avec Cyrus, et il est tombé du côté d'Hérode.
IV
Son œuvre, aux deux périodes si disparates, aura-t-elle été profitable ? Char du soleil, puis char armé de faux, son passage aura-t-il été utile à la France et à la société ?
Laissons Bonaparte répondre sur Napoléon:
N'étant encore que Premier Consul, il s'était rendu à Ermenonville, très beau domaine dans l'Oise, où le comte de Girardin avait offert en 1778 un asile à Jean-Jacques Rousseau: le philosophe y avait passé ses derniers jours, puis y avait été inhumé au milieu d'un lac du parc, dans une île appelée île des Peupliers.
Le noble propriétaire raconte ainsi dans ses Mémoires la visite de Bonaparte:
« Arrivé dans l'île des Peupliers, le Premier Consul s'arrêta devant le tombeau de Jean-Jacques Rousseau et dit: Il eut mieux valu pour le repos de la France que cet homme n’eût jamais existé.
« — Eh pourquoi, citoyen consul ? « — C'est lui qui a préparé la Révolution française. « — Je croyais que ce n'était pas à vous à vous plaindre de la Révolution. « — Eh bien, l’avenir apprendra s'il ne valait pas mieux pour le repos de la terre, que
Rousseau ni moi n'eussions jamais existé. « Et il reprit d'un air rêveur sa promenade (289). » L'avenir évoqué par le sévère visiteur a apporté ses leçons Elles sont sous les yeux de tous; En ce qui concerne les juifs, sans Rousseau il n'y eût pas eu, pour eux, l'émancipation telle
qu'elle s'est faite, au nom des Droits de l'homme.
Et sans Napoléon, il n'y eût pas eu, à la suite du grand Sanhédrin, l’organisation commencée de ce peuple au sein des autres peuples qui, eux au contraire, se désorganisaient. Mais au-dessus du jugement de Bonaparte, il y a le jugement de Dieu; et, dans la stratégie de
la divine miséricorde, il y a des mouvements qui sauvent la personne d'un grand homme et son œuvre.
La personne: Brillante carrière de Napoléon dans la justice et la vérité, tu n'as pas été longue, parce que toute créature humaine est incapable de soutenir longtemps le rôle de soleil qui n'appartient qu’à Jésus-Christ. Seul, le Christ de Dieu est le soleil de l'humanité. Même Cyrus, sa figure prophétique (290), n'a pu soutenir ce rôle jusqu'à la fin (291). Napoléon a donc vite décliné, et il est allé s'éteindre dans une île perdue de l'Atlantique. Et là, un acte de repentir, sur le crépuscule du soir, un dernier soupir dans la charité, n'ont-ils pas rendu à l'astre humilié, de
l'autre côté du temps, le radieux éclat de ses premiers matins ? Que Dieu lui ait fait cette grâce, le Dieu qui pardonne et couronne !
Mais l'œuvre ?
L'œuvre pour laquelle Bonaparte, dans l'île des Peupliers, devant le tertre de Rousseau, était comme effrayé de sa propre existence, elle a, hélas ! abouti à des ruines et des décombres qui, après bientôt un siècle, n'ont pas fini de s'amonceler. Mais là encore, Dieu et sa miséricorde voudront avoir le dernier mot. Voici la superbe marche du Tout-Puissant décrite à la première page des Ecritures:
Pour chacun des six jours de la création, le récit biblique apprend que Dieu partait du soir pour aboutir au matin. Dieu dit: Que la lumière soit, et la lumière fut. Et du soir et du matin se fit le premier jour. — Dieu dit: Que le firmament apparaisse au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux, et il donna au firmament le nom de ciel. Et du soir et du matin se fit le deuxième jour. — Dieu dit: Que la terre produise de l'herbe verte qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit. Et cela se fit ainsi. Et du soir et du matin se fit le troisième jour.— Et de même pour les autres jours.
Le Créateur partait donc du soir pour aboutir au matin; mais d'où vient que son point de départ n'a pas été le matin pour aboutir au soir ?
Dans sa sagesse et sa bonté, Dieu prévoyait que l'homme, par des faiblesses, des erreurs et des dépravations, ramènerait fréquemment la nuit dans l'œuvre qui allait lui être confiée; que les riches couleurs de l'ordre physique et les belles vertus de l'ordre moral seraient souvent comme anéanties par les ombres du soir; et que, là où circulait la vie, s'étendraient l'horizon noir et l'effroi: et alors, infiniment miséricordieux, il daigna, dans les six jours de la création, partir constamment du soir, afin d'apprendre à l'homme que sa Providence ne se laisserait pas vaincre par l'obscurité, et que, quelles que fussent les époques de décadence, de ruines et de ténèbres que produiraient, dans le cours des âges, la faiblesse et la perversité humaines, la Providence, elle, dans les jeux de sa sagesse et de son amour, aboutirait toujours au matin.
Nous sommes au soir du siècle qui posséda Napoléon. Aux transformations salutaires que son génie a suscitées, son bras a associé bien des ruines, et les ruines, à cette heure, émeuvent plus que les transformations. Même, les décombres n'ont pas fini de s'amonceler, car le géant, s'il revenait, estimerait jeux d'enfants les moyens qu'il avait de renverser les barrières, en comparaison de ceux que la science a, depuis lui, livrés aux hommes. Autour des ruines, tout le monde est debout, et chacun se demande avec anxiété: Que peut-on espérer ? Doit-on espérer ? Que va-t-on devenir ?
Les uns disent: Des ruines un aigle peut encore sortir !
Les autres disent: Une fleur royale peut seule les recouvrir et les faire oublier.
D'autres disent: C'est l'acheminement à la dernière ruine et à la consommation des siècles.
Il nous suffit, à nous, pour espérer, d'écouter d'abord du côté du Vatican, puis, de prendre notre vieille Bible et d'y relire, à la première page, la marche du Tout-Puissant: Il partait du soir pour aboutir au matin.
NOTES
- (1)
- Le Livre des orateurs , par Timon.
- (2)
- La sagesse atteint avec force depuis une extrémité jusqu'à l'autre, et elle dispose tout avec douceur (Livre de la Sagesse. VIII, 1.)
- (3)
- Discours sur la Loi de l'Histoire , par Lacordaire.
- (4)
- Un impartial connaisseur, le savant rabbin Drach, dit du Talmud: « Nous qui, par état, avons longtemps enseigné le Talmud et expliqué sa doctrine, après en avoir suivi un cours spécial, pendant de longues années, sous les docteurs israélites les plus renommés de ce siècle; nous qui avons, par la grâce d'en haut, abjuré les faux dogmes qu'il prêche, nous en parlerons avec connaissance de cause et avec impartialité. Si, d'une part, nous lui avons consacré nos plus belles années, d'autre part il ne nous est plus rien. Nous dirons ce qui le recommande, ce qui le condamne « Or, dans la Ghemara , il y a au moins cent passages qui attaquent la mémoire de notre adorable Sauveur, la pureté plus qu'angélique de sa divine mère, l'immaculée reine du Ciel, ainsi que le caractère moral des chrétiens, que le Talmud représente comme adonnés aux crimes les plus abominables. On y trouve des passages qui déclarent que les préceptes de justice, d'équité, de charité envers le prochain, non seulement ne sont pas applicables à l'égard du chrétien, mais font un crime à celui qui agirait autrement. Le Talmud défend expressément de sauver de la mort un non juif, de lui rendre les effets perdus, etc., d'en avoir pitié; Traité Aboda-Zara, fol. 13, verso, fol. 20, recto; traité Baba-Kamma , fol. 29, verso. Les rabbins disent encore: Puisque la vie de l’idolâtre est à la discrétion du juif, à plus forte raison son bien. « Dans la Mischna, on rencontre à peine quatre ou cinq de ces passages impies, haineux, atrocement intolérants; encore y garde-t-on une certaine mesure dans les expressions. Voici la cause de cette réserve: dans l'édition du Talmud que Froben, imprimeur de Bâle, exécuta en 1581, les censeurs Marcus Marinus, Italus Brixiensis, Pétrus Cavallerius supprimèrent les principaux des passages que nous venons de signaler, ainsi que le traité entier Aboda-Zara (De l'idolâtrie). Mais quelque temps après, les juifs rétablirent, dans une édition qu'ils publièrent à Cracovie, toutes les suppressions opérées à Bâle. Toutefois, ces passages réintégrés ayant soulevé l'indignation des hébraïsants chrétiens, le synode juif, réuni en Pologne en 1631, en prescrivit le retranchement dans les éditions qui devaient se faire subséquemment, par son encyclique hébraïque dont nous transcrirons le passage suivant : « ...C'est pourquoi, nous vous enjoignons, sous peine d'excommunication majeure, de ne rien imprimer dans les éditions à venir soit de la Mischna , soit de la Ghemara , qui ait rapport en bien ou en mal aux actes de Jésus le Nazaréen... Nous vous enjoignons, en conséquence, de laisser en blanc, dans ces éditions, les endroits qui ont trait à Jésus le Nazaréen, et de mettre à la place un cercle comme celui-ci O, qui avertira les rabbins et les maîtres d'école d'enseigner à la jeunesse ces endroits de vive voix seulement. Au moyen de cette précaution, les savants d'entre les Nazaréens (chrétiens) n’auront plus de prétextes de nous attaquer à ce sujet. » (DRACH, De l'Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t. I, pp. 121-2, 166-8.)
- (5)
- Collection des écrits et des actes relatifs au dernier état des individus professant la religion hébraïque (1808), pp. 69-70.
- (6)
- POUJOULAT, Histoire de la Révolution , chap. XXIX
- (7)
- « Que ce projet gigantesque fût exécutable ou non, il est certain qu'il occupait son imagination; et, quand on a vu ce qu'il a fait aidé de la fortune, on n'ose plus déclarer insensé aucun de ses projets. » (THIERS, Hist. de la Révolution, t. X, chap. VII.)
- (8)
- Les imams priaient le vendredi le sultan Kébir (grand sultan). C'est le nom que l'Orient a donné à Bonaparte.
- (9)
- Moniteur de l'an VII = 1799. n° 243 p. 187. Le Moniteur rapporte également, d'après une correspondance de Constantinople: qu'un grand nombre de juifs avaient été armés par Bonaparte, et que leurs bataillons menaçaient déjà Alep. — Détails confirmés par GRAETZ, Hist. des juifs , t. XI, p. 236.
- (10)
- Il se décida enfin à lever le siège. Mais son regret fut tel, que, malgré sa destinée inouïe, on lui a entendu répéter souvent, en parlant de Sydney-Smith, défenseur de la ville: « Cet homme m'a fait manquer ma fortune. » Les Druses, qui pendant le siège avaient nourri l'armée, toutes les peuplades ennemies de la Porte, apprirent sa retraite avec désespoir. (THIERS, Hist. de la Révolution, t. X, chap. VII.)
- (11)
- Bonaparte voulut monter sur le Thabor; les traces d'un Dieu attirèrent comme invinciblement son génie. Le général en chef coucha au couvent de Nazareth le 18 avril; il assista à un Te Deum solennel chanté au bruit des orgues en présence du Saint Sacrement. Pour qui eût senti vivement les choses de religion et de patrie, le Te Deum du 18 avril 1798 dans l'église de Nazareth était un beau spectacle; le vainqueur du Thabor en gardait encore le souvenir à Sainte-Hélène (POUJOULAT, Hist. de la Rév., chap. XXXI.)
- (12)
- « Cet homme, objet de vœux si singuliers, voguait tranquillement sur les mers au milieu des flottes anglaises. On avait craint de devenir leur proie. Lui seul, se promenant sur le pont de son vaisseau avec un air calme et serein, se confiait à son étoile, apprenait à y croire et à ne pas s'agiter pour des périls inévitables. Il lisait la Bible et le Koran, œuvres des peuples qu'il venait de quitter. » (THIERS, Hist. de la Révol., t. X.)
- (13)
- « Les grands noms ne se font qu'en Orient », disait un jour Napoléon. La fortune le fit passer à travers ce pays de la gloire. Toutes les nations de l'Orient nous ont parlé de lui. Ses œuvres de guerrier et de civilisateur occupent les imaginations de l'Asie depuis un demi-siècle; les tentes du désert n'ont pas de récits plus attachants. L'Arabe des vieux temps, quand son cheval s'effrayait, lui disait: As-tu vu l'ombre du roi Richard ? L'ombre du vainqueur des Pyramides, d'Aboukir et du Thabor plane aussi sur le monde oriental. » (POUJOULAT, chap. XXXI.) — Comment n'est-il venu à la pensée d'aucun poète de faire le poème de l'Orient disputant à l'Occident le cœur de Napoléon, et l'Occident l'emportant ! Quelle riche matière à des scènes grandioses et émouvantes !
- (14)
- Au sein de cette île, son imagination refoulée dans le passé se reportait vers l'Egypte et l'Orient, et s'illuminait des souvenirs brillants de sa jeunesse. « J'aurais mieux fait, disait-il en se frappant le front, de ne pas quitter l'Egypte. L'Arabie attend un homme. Avec les Français en réserve, les Arabes et les Egyptiens comme auxiliaires, je me serais rendu maître de l'Inde, et je serais aujourd'hui empereur de tout l'Orient. » (Mémorial de Sainte-Hélène.)
- (15)
- Discours de Portalis à la séance du Corps législatif, le 15 germinal an X (5 avril 1802).
- (16)
- Paroles prononcées par Napoléon au Conseil d'Etat (séance du 30 avril 1806). — Citées par GRAETZ, t. XI, p. 623.
- (17)
- PELET, Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration (Paris, 1833, p. 211.) — D'autres historiens, et de toutes les nuances, n'ont pu s'empêcher de remarquer la sinistre apparition des juifs le soir des champs de bataille ou dans les journées de gaspillage. — M. Thiers dit, à propos de l'invasion des Etats de l'Eglise: « Malheureusement, des excès, non contre les personnes, mais contre les propriétés, souillèrent l'entrée des Français dans l'ancienne capitale du monde... Berthier venait de partir pour Paris; Masséna lui avait succédé. Ce héros fut accusé d'avoir donné le premier exemple. Il fut bientôt imité. On se mit à dépouiller les palais, les couvents, les riches collections. Des juifs à la suite de l'armée achetaient à vil prix les magnifiques objets que leur livraient les déprédateurs. Le gaspillage fut révoltant. » (THIERS, Histoire de la Révol., t IV.)
- (18)
- Archives nat. Sect. du Secrétariat , AF, IV, 300, dr. 2151. Note particulière à Sa Majesté sur les juifs d'Alsace par le maréchal d'Empire sénateur, Kellermann, 23 juillet 1806. — Ibid., dr. 2150. Rapport à Napoléon des commissaires de S.M. pour traiter les affaires des juifs, mars 1807. — Ces recherches aux Archives nationales ont été faites par M. Fauchille, avocat à la Cour de Paris, et consignées par lui dans la consciencieuse et remarquable brochure la Question juive en France sous le premier Empire , à laquelle nous les avons empruntées.
- (19)
- « Il y a, dit un député au Corps législatif, des familles chrétiennes et même des fonctionnaires qui exercent le vilain commerce de « l’usure ». » Archives nat., Sec. adm., F/19, 1808.
- (20)
- Son gouvernement fera cette déclaration au Moniteur « ... Leur état d'abaissement dans lequel ils ont longtemps langui, état qu'il n'entre point dans nos intentions de maintenir ni de renouveler. » Décret du 30 mai 1806.
- (21)
- Archives nat., Sect. adm., F/2, 410-413. Lettres des préfets de différents départements au ministre de l'Intérieur. — Sect. du Secrét . AF. IV, 300, dr. 2150. Observations de l'archichancelier au Conseil d'Etat, juin 1807.
- (22)
- Le rabbin DRACH, Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue. t. I p. 47.
- (23)
- Récit de M. de Barante, alors auditeur au Conseil d'Etat. Ce récit se trouve dans l'article consacré à « Monsieur de Barante, ses souvenirs de famille, sa vie et ses œuvres », par M. Guizot, dans la Revue des Deux Mondes , années 1867, juillet, pp. 18-20.
- (24)
- Le récit de ces trois séances nous a été fourni par le livre Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration , par PELET DE LA LOZÈRE, lequel en tenait les détails de la bouche d'un Conseiller d'Etat présent à ces séances.
- (25)
- CANTU, Hist. universelle, t. XVIII, p. 223.
- (26)
- Napoléon disait à l'un de ses lieutenants, en traversant les Alpes: Vous croyez donc que c'est quelque chose de bien grand d'être empereur des Français et roi d'Italie ? Je ne me fais pas d'illusion; je suis l'instrument de la Providence, qui me conservera tant qu'elle aura besoin de moi: cela passé, elle me brisera comme un verre. Plût à Dieu que ces paroles ne fussent jamais sorties de sa mémoire et qu'il eût agi en conséquence ! (Mémoires du colonel de Baudus.)
- (27)
- Discours de M. Molé, commissaire de Sa Majesté, à la 6é séance de l'Assemblée des Notables, le 17 septembre 1806.
- (28)
- Ces cent onze membres se répartissaient ainsi: 94 laïques, 17 rabbins.
- (29)
- Le lecteur apprendra avec intérêt l'étymologie de ce nom de Sanhédrin. Emprunté à la langue grecque (συνεδριον), il signifie assemblée de gens assis. On sait avec quel calme et quelle gravité les Orientaux ont l’habitude de traiter les questions.
- (30)
- Le jugement des soixante et onze, dit la Mischna, est invoqué quand l'affaire concerne toute une tribu, ou un faux prophète, ou le grand prêtre; quand il s'agit de savoir si l'on doit faire la guerre; s’il importe d'agrandir Jérusalem et ses faubourgs, ou y faire des changements essentiels, etc. D'après cette citation de la Mischna, on voit combien étaient larges les attributions du Sanhédrin.
- (31)
- La Question juive en France sous le premier Empire; par FAUCHILLE, pp. 33-39. — Règlement pour les membres du grand Sanhédrin dans l'intérieur de la salle les séances: ARTICLE PREMIER. — Aucun membre composant l'assemblée du grand Sanhédrin ne pourra entrer en séance s'il ne s'est conformé au costume prescrit. Ce costume consiste en un habillement complet en noir, manteau de soie de même couleur, chapeau à trois cornes et rabat (Collection des procès-verbaux du grand Sanhédrin.)
- (32)
- Collection des procès-verbaux et décisions du grand Sanhédrin, publiée par Tama, pp. 17-18.
- (33)
- Archives nat., Sect. du secrét., AF., IV, 312, d. 2250.
- (34)
- Ibid.,AF.,IV,300,d.2151.
- (35)
- A la fin de la première séance de l'Assemblée des Notables, « lorsque l'officier qui avait été placé à l'entrée de la salle s'approcha du président élu pour prendre ses ordres, que la garde rendit les honneurs militaires aux députés et que les tambours battirent, ceux-ci se sentirent relevés, et leur crainte se changea en confiance. » (GRAETZ, Hist. des juifs. t. XI, p. 282.)
- (36)
- Discours de M. David Sinzheim, chef du grand Sanhédrin, séance du 9 février 1807.
- (37)
- Notes adressées par l'Empereur à M. Champagny (Archives israélites, année 1841, p. 139.)
- (38)
- HALLEZ, Hist. des juifs en France, p. 205.
- (39)
- Gräetz incline à croire que ce fut M. Furtado, président de l'Assemblée des Notables (t. XI, p. 282).
- (40)
- Discours de M. Molé, commissaire du gouvernement dans la séance du 18 septembre 1806 (Moniteur, 21 septembre 1806, p. 1171.)
- (41)
- Correspondance de Napoléon 1er, pièce numéro 10.725. Napoléon à M. Champagny, 3 septembre 1806.
- (42)
- Vingt-cinq Notables laïques, élus au scrutin secret.
- (43)
- Correspondance de Napoléon Ier, pièce n° 10.725. Napoléon à M. Champagny, 3 septembre 1806. — Pièce n° 11.320. Lettre à M. Champagny, 29 novembre 1806.
- (44)
- Ibid., pièce n° 10.725. Nap. à M. Champ., 3 sept. 1806. — Pièces n° 10.537 et 10.686. Nap. à M. Champ., 22 juillet 1806 et 23 août 1806. — Pièce n° 11.320. Lettre à M. Champ., 29 novembre 1806. — Archives israélites, années 1841, pp. 142-143.
- (45)
- Correspondance de Napoléon Ier, pièce n° 11.320. Lettre à M. Champagny, 29 novembre 1806. — Archives israélites, année 841, p. 144.
- (46)
- Ibid., pièces n°s 10.537 et 10.686. Napoléon à M. Champagny, 22 juillet 1806 et 23 août 1806.
- (47)
- Le Comité des Neuf fut composé ainsi: MM. Furtado, Avigdor, Andrade (juifs portugais); Jacob Lazare, Moyse Levy, Beer Issac Berr (juifs allemands); Segré, Cologna, Cracovia (juifs italiens).
- (48)
- Portalis, directeur des affaires ecclésiastiques, 1806, et ministre des Cultes, 1804, se signala par sa tolérance, mais prépara le décret qui, en crainte des Jésuites, remit en vigueur les lois contre les congrégations. La même année il passa au ministère de l'Intérieur, et, en 1806, fut élu membre de l'Académie française. Il a laissé: De l'usage et l'abus de l'esprit philosophique durant le dix-huitième siècle , ouvrage remarquable par l'impartialité, le véritable esprit philosophique, et le sentiment chrétien qui l'ont inspiré; le style a de la clarté, de l'élégance, et beaucoup de traits d'un goût fin et délicat (DÉZOBRY.)
- (49)
- « Il s'efforça de séduire les juifs, si nous pouvons ainsi parler, de les attirer dans le grand chemin de la nationalité française. » (HALLEZ, Des juifs en France , p. 184.)
- (50)
- MALVEZIN, Hist. des juifs à Bordeaux , p. 291. — On évaluait la fortune de Samuel Bernard à 33 millions. Dans une circonstance critique, comme on en vit plusieurs fois à la fin du grand règne Louis XIV humilia son orgueil jusqu'à caresser la vanité de ce financier, et lui faire lui-même les honneurs de Marly. L'heureux financier fut anobli, et sa famille se trouva par la suite alliée aux plus grands noms. On rapporte que, jouet d'une superstition singulière, il croyait son existence attachée à celle d'une poule noire qu'il faisait traiter avec un soin extrême.
- (51)
- Les Mémoires du chancelier PASQUIER qui viennent de paraître confirment précieusement notre appréciation. Nous y lisons: « Une circonstance, qui était personnelle à M. Molé, ajoutait encore à l'horreur que les formes de son langage inspiraient à ceux qu'il avait mission de ramener. On tenait assez généralement pour certain que son arrière-grand-mère, fille de Samuel Bernard, célèbre financier de la fin du règne de Louis XIV, était d'origine juive, et il n'était pas permis de douter que la grande fortune dont jouissait sa famille ne vint presque entièrement de cette alliance. A la vérité, il prétendait que le judaïsme de Samuel Bernard était une pure fiction, fondée sur le hasard d'un nom de baptême, plus usité, en effet, chez les juifs que chez les chrétiens. « ... M. Molé était toujours menaçant; M. Portalis et moi, nous nous efforcions de ramener, par des formes plus conciliantes, les esprits que notre impétueux collègue ne cessait de cabrer. » (Mémoires du chancelier PASQUIER, par le duc D’AUDIFFRET-PASQUIER, t. I.) De son côté, l'historien israélite Gräetz ne dissimule pas son dépit à l'endroit du langage dur et des manières hautaines de Molé; il dit de lui: « Le comte Molé était réputé pour une personne peu franche. Lui, dont l'arrière-grand-mère était juive, avait donné à un rapport sur les juifs, dont l'Empereur l'avait chargé, une nuance hostile », et il l'avait terminé par cette conclusion: « que tous les juifs français devaient être soumis à des lois d'exception. » (GRAETZ, Hist. des juifs . t. XI, pp. 272-273.)
- (52)
- Moniteur, 31 juillet 1806, p. 972.—Collections des actes de l'Assemblée des israélites de France et du royaume d'Italie convoquée à Paris en 1806, pp. 130-132.
- (53)
- HALLEZ, Des juifs en France, p. 200.
- (54)
- GRAETZ, Hist. des juifs, t. XI, p. 285.
- (55)
- Archives israélites, année 1841, pp. 361 et suiv. — Eloge d'Abraham Furtado par Michel BERR, Paris, 1817.
- (56)
- GRAETZ, t. XI, P. 278.
- (57)
- On peut consulter, sur les partis, dans GRAETZ, le chapitre VI du tome XI.
- (58)
- Proficiscentibus ait: Ne irascamini in via (Genes., XLV, 24.)
- (59)
- GRAETZ.
- (60)
- Bossuet a dit des flatteries de l'historien Josèphe à l'égard d'Hérode le Grand, puis à l'égard de Vespasien: « C'est ainsi qu'il détournait l'Ecriture sainte pour autoriser sa flatterie: aveugle, qui transportait aux étrangers l'espérance de Jacob et de Juda, qui cherchait en Vespasien le fils de David et attribuait à un prince idolâtre le titre de celui dont les lumières devaient retirer les gentils de l'idolâtrie. » (Discours sur l'Histoire universelle, IIe partie, chap. XXIII.)
- (61)
- GRAETZ, t. XI, p. 290.
- (62)
- Collection des actes de l'Assemblée des israélites en 1806, discours prononcé en italien par M. le rabbin SEGRÉ, P. 204.
- (63)
- Collection des actes de l'Assemblée des israélites en 1806, sermon prononcé en allemand par le rabbin SINZHEIM, pp. 211-218.
- (64)
- Collection des actes de l'Assemblée des israélites en 1806, ode pour le jour de la naissance de Napoléon le Grand par le rabbin COLOGNA, PP. 222-226.
- (65)
- « L'Empereur fut très satisfait. Il n’y eut pas d'audience. Mais Sa Majesté fit savoir toute sa bienveillance à l'Assemblée. » GRAETZ, t. XI, p. 290.
- (66)
- Collection des procès-verbaux et décisions du grand Sanhédrin . pp. 3 et 5.
- (67)
- Collection des procès-verbaux et des décisions du grand Sanhédrin , pp. 128-129.
- (68)
- Ibid., p. 130.
- (69)
- Sa païenne adulation fut la suivante: « Comment acquitter l'immense dette de reconnaissance pour des bienfaits si grands ? Dans les temps appelés héroïques, et qui l'étaient moins que celui où nous vivons, la reconnaissance déifiait les fondateurs des sociétés, ou les destructeurs des brigands qui désolaient les hommes paisibles adonnés à l'agriculture naissante. On les plaçait, comme des dieux conservateurs, à la tête de la peuplade que leur génie avait retirée du sein des forêts, ou que leur vaillance avait sauvée de la férocité des hordes errantes; leur famille et leurs descendants recevaient, par la vénération des peuples, un caractère auguste qui les désignait d'avance comme les héritiers naturels des héros dont ils étaient issus. « Docteurs et Notables d'Israël, vous le sentez plus fortement que je ne pourrais l'exprimer: il n'est pas un seul des bienfaits qui attiraient sur les héros de l'antiquité ce concert unanime d'applaudissements, de respects, de bénédictions, de la part de peuples, dont nous ne soyons redevables, et comme Français, et comme israélites, à Napoléon le Grand. » (Discours de M. Furtado. — Procès-verbaux et décisions du grand Sanhédrin, pp. 110-111.)
- (70)
- L'apôtre saint Paul dit de l'Antéchrist: « Il doit venir avec toutes les séductions qui peuvent porter à l'iniquité. » (IIe Epître aux Thessal., II, 10.)
- (71)
- Recueil des lois concernant les israélites depuis la Révolution de 1789, par HALPHEN, pp. 249-250. Collection les actes de l'Assemblée des israélites en 1806, pp. 132-133.
- (72)
- Notes secrètes adressées par l'Empereur à M. Champagny en 1806 (copiées fidèlement sur les originaux, en 1813, par M. Baude, conseiller d'Etat et adressées par lui en 1841 aux Archives israélites avec un témoignage d'authenticité). Archives israélites, années 1841 pp. 138-142.
- (73)
- Notes secrètes, etc. (Archives israélites, année 1811, p. 144.)
- (74)
- Lettre de Napoléon à M. Champagny, Posen, le 29 novembre 1806. (Archives israélites, année 1841, pp. 143-144.)
- (75)
- Collection des actes de l'Assemblée les israélites de France et du royaume d'Italie, convoquée à Paris en 1806, p. 147.
- (76)
- BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, IIe partie, chap. XXIV.
- (77)
- Décisions doctrinales du grand Sanhédrin, préambule des décrets. (HALPHEN, Recueil des lois concernant les israélites, pp. 20-21.)
- (78)
- HALLEZ, Des juifs en France, pp. 200-201.
- (79)
- Notes secrètes de l'Empereur à M. de Champagny en 1806 (Archives israélites, année 1841, p. 140).
- (80)
- Collection des actes de l'Assemblée des israélites, etc., p. 140.
- (81)
- GRAETZ, t. XI, P. 287.
- (82)
- Collection. etc.. p. 152.
- (83)
- Organisation civile et religieuse, etc., p 134.
- (84)
- Collection des procès-verbaux et décisions du grand Sanhédrin (1807), p. 101.
- (85)
- Rapport de M. FURTADO au nom de la Commission des Neuf.
- (86)
- Discours du Président du Sanhédrin, M. SINZHEIM.
- (87)
- Organisation civile et religieuse, etc., p.208.
- (88)
- Organisation civile et religieuse, etc., pp. 287-288.
- (89)
- Organisation civile et religieuse, etc., pp. 314-328.
- (90)
- GRAETZ, Hist. des juifs, t. XI, p. 287.
- (91)
- Ier Livre les Mach., I, 3.
- (92)
- Correspondance de Napoléon, t. XIII, pièce n° 12.226, p. 716.
- (93)
- Discours de M. FURTADO (Collection des procès-verbaux et décisions du Sanhédrin, pp. 99-100.)
- (94)
- MALO, Histoire des juifs, p. 445.
- (95)
- Le rabbin DRACH, Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t. I, pp. 266, 276.
- (96)
- GRAETZ, Hist. des juifs, t. XI, p. 622.
- (97)
- Collection des actes de l'Assemblée des israélites de France et du royaume d'Italie, convoquée à Paris en 1806, pp. 238-239.
- (98)
- Collection des actes de l'Assemblée des israélites en 1806, pp. 151, 170-171, 173.
- (99)
- Législation criminelle du Talmud. Organisation de la magistrature rabbinique, autorité légale de la mischnah, ou traduction critique talmudique synhedrin et makhoth et des deux passages du traité Edjoth par le Dr J.-J.-M. RABBINOWICZ. I VOl. g. in-8, XXXVI, 231 p., Paris, imprimé par ordre du gouvernement à l'Imprimerie nationale, 1876. — La traduction en français du Talmud de Jérusalem a été faite par Moïse SCHWAB, Paris, Maisonneuve et Cie.
(100) Paroles mêmes de Jésus-Christ, en saint Matthieu, XVII, 11.
(101) Malachie, IV, 6 — Saint Jean Chrysostome, saint Jean Damascène et Théodoret expliquent ainsi ce texte: « Elie tournera les cœurs des pères, c'est-à-dire des juifs qui sont les ancêtres, vers les chrétiens qui sont leur postérité, et les cœurs de ceux-ci vers leurs ancêtres, de telle sorte qu'ils n'aient plus qu'un même amour et qu'une même foi. » (CORN. LAPIERRE, Comment. sur Malachie, t. XIV, p. 617.)
(102) Voir plus haut, pages 74-77.
(103) Discours de M. AVIGDOR, Organisation des israélites, etc., pp. 314-315.
(104) Mémorial le Sainte-Hélène, t. IV, p. 209, par le comte de LAS CASES. Réimpression de 1828, Lecomte, libraire, Paris.
(105) THIERS, Histoire de la Révolution, t. I, pp. 108-109.
(106) « C’était un corps éminemment religieux qui, sous la protection des lois, dans un état chrétien, s'installait avec tout le cortège des cérémonies judaïques. Dans l'histoire de l'Empire, cet événement est peut-être un de ceux qui méritent le plus de fixer l'attention. Les juifs semblent avoir été jetés au milieu des nations pour marquer par leurs vicissitudes les progrès de la raison humaine. Quel progrès immense n'avait-il pas dû s'opérer en France pour que l'on pût voir dans son sein ressusciter avec toute sa pompe l'assemblée la plus respectée de l'antique Jérusalem ! » (BÉDARRIDE, Les juifs en France, pp. 414-415.)
(107) Collection des actes de l'Assemblée des israélites en 1806, p. 239.
(108) Voir la Valeur de l'Assemblée qui prononça la peine de mort contre Jésus-Christ, par les abbés LÉMANN. (Lecoffre éditeur Paris.)
(109) Saint Marc, XIV, 65.
(110) Saint Matthieu, XXVII, 41; saint Marc, XV, 31.
(111) Les sanhédrites convoqués par Napoléon ont failli à toutes leurs traditions en acceptant cette convocation. « Le Sanhédrin, ce grand Consistoire, ne pouvait se tenir que dans la ville de Jérusalem, en un lieu qu'on appelait Liscat-hagazit ou le conclave de pierre, et qui étaitjoignant au Temple ou plutôt une partie du Temple même. » (LÉON DE MODÈNE, Cérémonies des juifs, supplément, p. 44.) — Conformément à la Mischna, le Sanhédrin avait son local dans un des bâtiments du Temple, dans la salle Gasitz, et plus tard vers la 40e année avant la ruine du Temple, dans un local situé près du mont Moriah. » (Sanhédr., II, 2. Middoth, 5, 4. — Abod. Sar., fol. 8, b.)
(112) LACORDAIRE, Discours sur la vocation de la nation française
(113) BÉDARRIDE, Les juifs en France, pp. 502-503.
(114) Voir l'Entrée des israélites, etc., p. 206.
(115) Cantic., II, 15.
(116) DRACH, Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t. I, p. 520.
(117) Genèse, XLI, 20.
(118) Le centaure Nessus, frappé d'une flèche vénéneuse par Hercule, remit à Déjanire, avant de mourir, une tunique imprégnée de son sang empoisonné.
(119) Tragédies de SOPHOCLE: les Trachiniennes.
(120) LACORDAIRE: 64e conférence « Des signes de la chute dans l'humanité. »
(121) Saint Matthieu VI, 33.
(122) Saint Matthieu, XII, 28.
(123) Saint Luc, XVII, 21.
(124) Id., XVIII, 17.
(125) OZANAM, la Civilisation chrétienne chez les Francs, t. II, 366, 373-374.
(126) Cum tradiderit regnum Deo et Patri (1ere Ep. ad Corinth., XV, 24).
(127) LACORDAIRE, De l'influence de la vie surnaturelle sur la vie privée et sur la vie publique. (Conférences de Toulouse.)
(128) Livre des Proverbes, chap. XIV, 134.
(129) Saint Matthieu, chap. XIII, 32.
(130) Amos, IX, 8, 9.
(131) PASCAL, Pensées sur la Religion, art. IX et art. XIII.
(132) LACORDAIRE, Lettres à un jeune homme.
(133) Ipse autem transiens per melium illorum, ibat. (LUC. V, 30.)
(134) IIe Epître aux Corinthiens, III, 14, 15.
(135) LACORDAIRE, De l'influence de la vie surnaturelle sur la vie privée et sur la vie publique. (Conférences de Toulouse: 6e conférence.)
(136) J'en ai la conviction profonde: sans le funeste événement du seizième siècle, la situation du monde serait actuellement tout autre qu'elle n'est... Le cœur s'attriste à la vue de l'événement désastreux qui vint rompre cette précieuse unité et détourner le cours de notre civilisation. On ne peut, sans angoisse, faire cette réflexion, que l'apparition du Protestantisme coïncida précisément avec l'instant où les nations européennes, recueillant enfin le fruit d'efforts inouïs, se présentaient à l'univers pleines d'énergie et d'éclat (BALMÈS, le Protestantisme comparé au Catholicisme, t. II.)
(137) Zacharie, chap. IV.
(138) DESCHAMPS, les Sociétés secrètes, t. II, PP. 99-101.
(139) DESCHAMPS, les Sociétés secrètes, t. II, PP. 34, 89-90.
(140) Ier Livre des Rois, chap. XXVIII.
(141) L'infidélité des rois a été résumée dans ce tableau, réquisitoire éloquent: « Sans parler des princes qui se sont faits protestants pour s'emparer des biens et de l'autorité de l'Eglise, qui a plus compromis les droits et affaibli l'honneur du Saint-Siège que Louis XIV ? qui en a été l'adversaire plus implacable que les parlements de Louis XV ? qu'étaient-ce que Catherine II, Frédéric II, Joseph II, sinon des ennemis déclarés de l'Eglise ? Où en étaient, à l'égard du vicaire de Jésus-Christ, les gouvernements de France, d'Espagne, de Portugal, de Naples, lorsque conjointement avec d'autres puissances ils menaçaient Clément XIV des derniers excès s'il ne supprimait dans l'Eglise un institut vénérable, dont le seul crime était d'avoir versé son sang et ses sueurs par tout l'univers pour la gloire de Dieu, et de s'être constamment montré le serviteur intrépide des clefs apostoliques ? N'est-il pas évident que le protestantisme, le jansénisme, le rationalisme étaient montés sur les trônes de l'Europe, et que de leurs marches mêmes une conspiration parricide s'était ourdie contre la papauté ? La Révolution française tomba comme un tonnerre au milieu de ces projets... »
(142) LACORDAIRE, Lettre sur le Saint-Siège.
(143) Voir, dans notre ouvrage l'Entrée des israélites dans la Société française, le § III du chapitre intitulé Prudence de l'Eglise, pp. 292-297.
(144) Le XIe chapitre de l'Epître aux Romains.
(145) BOSSUET, Disc. sur l'hist. univ. IIe partie, § 7, édit. de 1681. — Dans les éditions postérieures, on a mis « peut nous attirer au lieu de « nous attirera ».
(146) Isaïe, chap. III, 5, 8.
(147) LAMENNAIS, Essai sur l'indifférence en matière de religion, chap. X.
(148) Ezéchiel.
(149) Timon.
(150) THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. III.
(151) Mém. de Sainte-Hélène
(152) Livre de Judith, chap. II.
(153) Napoléon avait imaginé de créer des rois qui devaient être ses vassaux, conserver leur titre de princes français, et les dignités dont ils étaient revêtus en France. Ces rois devaient régner à titre héréditaire; mais, l'hérédité de leurs trônes étant subordonnée à l'hérédité du trône impérial, ils devaient avoir des appartements au Louvre, y résider souvent, former le conseil de la famille impériale, élire son successeur. Il disait, il l'a surtout répété plus tard, qu'il se sentait isolé en Europe, ce qui était vrai, car il avait réduit toutes les cours à conspirer en secret contre lui. De là sa résolution de donner des trônes à ses frères, afin de créer des points d'appui et des centres de correspondance au grand Empire. (DARESTE, Histoire de France, t. VIII.)
(154) M. DE METTERNICH, II, 378, 403.
(155) TAINE, le Régime moderne, pp. 102-103. — « Il résolut de ceindre l'Europe entière d'un littoral tout à lui, depuis la Hollande jusqu'aux Iles Ioniennes, d'où serait exclue l'Angleterre qui mourrait alors de faim, faute de débouchés pour ses manufactures et pour les produits de ses colonies. « Un décret daté de Berlin, puis un autre de Milan, plus terrible encore, déclarèrent prisonnier de guerre tout Anglais trouvé dans les pays occupés, et de bonne prise tous navires, marchandises, magasins appartenant à des sujets britanniques. Ordre fut donné de repousser tous bâtiments provenant des ports anglais: puérilité gigantesque, qui portait un coup funeste à une foule d'intérêts, et tournait la guerre contre les peuples, plus difficiles à vaincre que les rois. De là, des pillages, des confiscations et un espionnage organisé dans toute l'Europe, la violation des magasins et celle des correspondances, la ruine des villes commerçantes et la nécessité d'un despotisme auquel n'avait pas été réduit le régime de la Terreur. » (CANTU, t. XVIII.)
(156) « Je voulais être un Washington couronné; mais je n'y pouvais raisonnablement parvenir qu'au travers de la dictature universelle; je l'ai prétendue. » (Mémorial, 30 novembre 1815.)
(157) « Je veux régner sur la mer comme sur la terre, et disposer de l'Orient comme de l'Occident... En somme, avec ma France, l'Angleterre doit finir naturellement par n'en plus être qu'un appendice: la nature l'a faite une de nos îles, comme celle d'Oléron ou la Corse... (Mémorial, paroles de Napoléon, 24 mars 1816.)
(158) Il annonce que « la résistance des Anglais va le forcer conquérir l’Europe. » (THIERS, IV, 249.)
(159) Livre de l'Ecclésiastique, chap. XXIV, 22.
(160) CANTU, Hist. univ., t XVIII, P. 189. — DÉZOBRY, Dictionnaire, au mot CODE.
(161) DARESTE, Histoire de France.
(162) TAINE, le Régime moderne, t. I, PP. 345-346.
(163) TAINE, le Régime moderne, t. I, PP. 345-346.
(164) MOLLIEN, Mémoires, t. III, 427
(165) Mme DE RÉMUSAT, Mémoires, II; 32, 29.
(166) Mme DE RÉMUSAT, Mémoires, I, 109; II, 247; I, 179, notes inédites par le comte de Chaptal.
(167) Souvenirs du feu duc de Broglie, I, 230.
(168) TAINE, le Régime moderne, I, 85-86.
(169) POUJOULAT, la Révolution française, 629-630.
(170) CANTU, Hist. univ., t. XVII, 269.
(171) TAINE, le Régime moderne, t. I, 75.
(172) TAINE, le Régime moderne, t. I, 349-350, 351-352.
(173) Mémorial.
(174) CANTU, Hist. univ., t. XVIII. PP. 271, 287.
(175) WEISHAUPT
(176) DESCHAMPS, les Sociétés secrètes, t. I, p. 257.
(177) COQUILLE, les Juifs (article du journal l'Univers, 14 avril 1888).
(178) Sermon pour le deuxième dimanche de l'Avent.
(179) Archives israélites, 1841, p. 140.
(180) Collection des actes de l'assemblée des israélites, convoquée à Paris en 1806, p. 276.
(181) Osée, III, 4.
(182) Evêque de Nancy et député aux Etats généraux. (Voir le 1er volume de la Prépondérance juive, ses origines (1789-1791), chap. V.)
(183) Complétant le prophète Osée, le prophète Azarias avait annoncé: Il se passera beaucoup de temps pendant lequel Israël sera sans vrai Dieu, sans prêtres, sans docteurs et sans Loi (IIe Livre des Paralip., XV, 3.)
(184) Livre Caphtor, fol. 121.
(185) Mischna, Tr. Sanhédr., ch. X, § 3.
(186) ISAAC ABOAB, dans son Candelabrum lucis, cité par Buxtorf: Les Preuves du Talmud, p. 70.
(187) BASNAGE, t. III, ch. XXX, n° 16.
(188) Lire, sur cette matière, les explications péremptoires du rabbin Drach, dans l'Harmonie entre l'Eglise et la Synagogue, t. I.
(189) Lettre d'un humoristique sur les rabbins. (Archives israélites, année 1841, p. 19.)
(190) KONIG, Dictionnaire de Théologie catholique, traduit de l'allemand par Goschler.
(191) Leçons sur le culte, p 442.
(192) P. 12 et seq.
(193) Déclaration des députés juifs, séances des 4, 7 et 12 août 1806.
(194) Collection des actes de l'Assemblée des israélites de France et du royaume d'Italie, convoquée à Paris en 1806, pp. 285-287.
(195) MALVEZIN, Histoire des juifs de Bordeaux, pp. 299-301 — GRAETZ.
(196) Consulter, dans notre premier volume de la Prépondérance juive, le chapitre premier: « Initiative dangereuse du philosophisme dans l'ouverture d'un concours à Metz en faveur des juifs », puis, dans notre ouvrage la Religion de combat, le chapitre Ve du IXe livre: « L'Eglise à aimer en mère et à traiter en reine », § II et § III.
(197) MICHELET, Histoire de France.
(198) Putredo ossium, invidia. (Prov., XIV, 30.)
(199) Rien n'est plus vrai ! Qui est-ce qui a fait condamner à mort Jésus ? c'est cette maudite passion. En effet: Pilate avait compris du premier coup, dit l'Evangile, que c'était par envie qu'ils le lui livraient. Mais il avait à faire à trois sortes de personnes rongées par cette passion: 1° Les pharisiens, c'est-à-dire les faux dévots du judaïsme; 2° les docteurs ou savants de la Synagogue, et 3° les pontifes et les prêtres destinés au ministère du Temple. Ces trois groupes ne pouvaient plus supporter le divin fils de Marie. Voilà que tout le monde court après lui, se disaient-ils mutuellement dans leur rage concentrée qui faisait explosion au milieu de leurs conciliabules, tout le monde court après lui ! Les pharisiens ne pouvaient supporter qu'il fût estimé plus saint qu'eux-mêmes. Les savants de la Synagogue ne pouvaient supporter que sa doctrine fût plus appréciée que la leur; les prêtres ne pouvaient supporter qu'on eût pour lui seul plus de vénération que pour eux tous. Il faut qu'il meure; le prétexte fut bien vite trouvé, il viole la loi de Moïse — Vous ne le croyez pas, vous, gouverneur romain ? Eh bien, il a voulu se faire roi, il s'est déclaré contre César, et, devant cette accusation, la lâcheté de Pilate le leur abandonna. Ils furent maîtres alors d'assouvir leur haine, toute leur haine. Voilà comment la Passion a pu avoir lieu.
(200) Mgr DUPANLOUP, évêque d'Orléans (Introd. au livre de Louis XVII, par M. DE BEAUCHESNE.)
(201) CANTU.
(202) Homère, dans l'Odyssée, dit d'Ulysse: « μειδησε δε σαρδανιον, mais il rit d'un ris sardonien.
(203) Mme DACIER, trad. de l’Odyssée. — BESCHERELLE, Dictionnaire national, au mot SARDONIQUE.
(204) Deutéron., XXIX
(205) Proverbes, XVIII, l9.
(206) Psaume CXXXII.
(207) KELLER, Histoire de France, t. I.
(208) LACORDAIRE, Conférence sur l'autorité.
(209) TAINE, la Révolution, t. I. — Le jacobin Duport résuma la compétence géographique des Sectes en ces mots: « La division de la France en carrés à peu près égaux serait la plus belle et la plus utile des opérations. »
(210) Les voici, ces convoitises « La jalousie des communes les unes contre les autres était ardente et croissait avec leur importance: l’attribution des fonctionnaires, des tribunaux, des évêchés, des garnisons, à certaines villes, était le grief de toutes les autres, et les plus favorisées se tenaient malheureuses qu'au-dessus d'elles dominât la capitale de la province. La division de cette province en plusieurs départements ouvrait à ces villes, qu'humiliait le second rang, la chance d'occuper le premier sur une part de l'ancien territoire; la division du département en districts fournissait aux petites villes l'espoir d'obtenir, dans la distribution faite à nouveau de tous les services, quelques-uns des avantages enviés par elles. Il n'était pas jusqu'au tracé des cantons qui n'excitât les moindres bourgades à briguer le titre de chef-lieu et à obtenir sur une étendue de deux lieues carrées la suprématie. Peu importait à ces cités, grandes ou petites, que, pour leur faire une principauté à leur taille, on brisât en morceaux l'ancienne unité des provinces. » (La Fin d'une province, par Etienne LAMY, ancien député, article du Correspondant, 10 août 1892.) Cet article montre bien le mal que l'envie allait causer à la France dans la suppression des provinces.
(211) ODILON-BARROT, de la Centralisation et de ses Effets.
(212) Mgr BAUDRY, Pensées.
(213) Mot de M. de Beust, premier ministre de l'empire d'Autriche.
(214) Isaïe, ch. LI, 1.
(215) Mémoires du chancelier PASQUIER, par le duc d’AUDIFFRET-PASQUIER, t. I.
(216) TAINE, la Révolution, p. 221.
(217) Ibid., p. 225.
(218) Univers israélite, dec. 1872.
(219) Ce fut M. Crétet, successeur de M. Champagny, qui fut chargé par l'Empereur du rapport et des mesures concernant ce changement de noms. (Arch. nat., S. secr., AF. IV, 328. dr. 2310. Rapport de M. Crétet à Napoléon, 18 mai 1808.)
(220) De la Démocratie en Amérique, t. II, pp. 87-90.
(221) HALPHEN, Recueil des Lois, préface, p. XLII, P. 301.
(222) BÉDARRIDE, les Juifs en France, p. 423.
(223) GRAETZ, Hist. des juifs, t. XI, p. 302.
(224) Fable du Coq et du Renard.
(225) MALO, Histoire des juifs, pp.308-310; p.340.
(226) Il avait proposé à son Conseil d'Etat d'annuler toutes les hypothèques prises par les juifs faisant l'usure et de défendre à ceux-ci, pendant dix ans, tout droit semblable sur les biens de leurs débiteurs: il désirait encore qu'à dater du 1er janvier 1807 les juifs, qui ne posséderaient pas une propriété, fussent soumis à une patente et ne pussent pas jouir des droits de citoyen. (Correspondance de Napoléon Ier. Pièce n° 9930. Note pour le grand juge, 6 mars 1806.)
(227) Arch. nat. S. Int. BB. 16.639. M. Champagny, min. de l'intér. au min. de la justice, 26 juin 1806; S. Secr AF IV. 300 dr. 2151. Rapport de M. Champagny à Napoléon, 17 juillet 1806.
(228) Arch. nat. S. Secr. AF. IV. 300. dr. 2150. Observations de l'archichancelier au Conseil d'Etat, juin 1807.
(229) Arch. nat. S. Adm. F. 19. 1838. Rapport du chef du secr. gén. au min. de l'Int., 11 octobre 1810.
(230) Ibid.
(231) HALLEZ, les Juifs en France.
(232) Il est absolument injuste et faux d'assimiler les mesures prises par l'Empereur à celles qu’on prenait sous l'ancien régime. « Sous l'ancien régime, tout est calculé pour maintenir les juifs en dehors de la société; on leur défend d'acquérir des terres; on leur ferme l'accès de toutes les professions honorables, on respecte toutes leurs lois nationales, même les plus opposées à la civilisation moderne; on leur laisse leurs tribunaux. Et si l'on prend des précautions pour prévenir ou réprimer leurs fraudes et leur usure, c'est après les avoir en quelque sorte forcés de chercher une ressource dans ces honteuses spéculations. Ici, le procédé est tout contraire: non seulement l'on ouvre aux juifs toutes les professions honnêtes, mais on fait tout pour les y attirer par la double influence des peines et des récompenses. Non seulement on ne veut pas les exclure de la société civile mais on ne néglige rien pour leur faire sentir le besoin et leur inspirer le désir de s'y confondre. On prend encore des précautions contre leurs fraudes et contre leurs habitudes de trafic illégitime; mais c'est parce que ces habitudes sont le plus grand obstacle à leur fusion dans l'unité nationale, et qu'elles n'ont plus même pour excuse une sorte de nécessité. » (HALLEZ, les Juifs en France, pp. 222-223)
(233) HALÉVY, Histoire des juifs.
(234) Voir ci-dessus pages 73-81.
(235) FAUCHILLE, La Question juive en France sous le premier Empire, p. 61.
(236) Voir plus haut, page 50.
(237) GRAETZ, Hist. des juifs, t. XI.
(238) Arch. nat., S. secr. AF. IV. 300. dr. 2150. Rapport de M. Maret, mars 1808.
(239) GRAETZ, Hist. des juifs, t. XI, p. 301. — Arch. israélites 1831. p. 366.
(240) Archives israélites, année 1841; pp. 79-88.
(241) La Prépondérance juive, première partie, Ses origines (l789-1791), pp. 218-220.
(242) Ibid. Le tableau de ces assauts se trouve aux pages 164-167.
(243) LÉON HALÉVY, Histoire des juifs modernes.
(244) Arch. nat., Sect. du Secr. AF, IV, 1290, n° 190. Lettre de M. de Montalivet à Napoléon, mars 1811.
(245) Arch. nat., Sect. adm. F/19. 1838. Rapports du ministre de l'Intérieur à Napoléon, 21 septembre 1808 et 13 mars 1811.
(246) Arch. nat., AF, IV, 630. dr. 5383, n° 12. Rapport du ministre de la Guerre, duc de Feltre, adressé à Napoléon le 10 juin 1812, approuvé par l'empereur le 9 juillet 1812.
(247) DESCHAMPS, les Sociétés secrètes, t. II, liv. II, chap. VII, n° 6: « La Révolution à cheval et ses complices en Europe. »
(248) « L'Ordre maçonnique considérait l'empereur Napoléon Ier comme un instrument destiné à renverser toutes les nationalités européennes: après ce gigantesque déblai, il espérait réaliser plus facilement son plan d'une république universelle. » Ibid.
(249) Id. n° 7: « Napoléon abandonné par les sociétés secrètes, 1809-1815. »
(250) JANSSEN, Zeit und Lebensbilder, 3e édit., Herder, Fribourg, pp. 23-24.
(251) DESCHAMPS, les Sociétés secrètes, t. II, liv. II, chap. VII, n° 7: « Napoléon abandonné par les sociétés secrètes, 1809. » — CANTU Hist. univ., t. XVIII, p. 287.
(252) GRAETZ, Histoire des juifs, t. XI, p. 302.
(253) La Prépondérance juive, première partie, Ses origines, chap. VI et VII.
(254) ALZOG, Histoire de l'Eglise, t. III, p. 437.
(255) Il avait une armée admirable pour la tenue et l'ensemble cent soixante généraux de division, trois cent quarante généraux de brigade, cent dix aides de camp. La moitié de l'Europe lui fournissait des soldats, et sa volonté ne trouvait plus de limites. Voici l'effectif de l'armée qu'il emmena en Russie: 60.000 Polonais, 20.000 Saxons, 30.000 Autrichiens, 30.000 Bavarois, 22.000 Prussiens, 20.000 Westphaliens, 8.000 Wurtembergeois, 8.000 de Baden, 4.000 de Darmstadt, 2.000 de Gotha et Weimar, 5.000 de Wurtemberg et Franconie, 5.000 de Mecklembourg et autres, 20.000 Italiens, y compris les Napolitains, 4.000 Espagnols et Portugais, 10.000 Suisses, 250.000 Français. En tout, 498.000 hommes. Napoléon avait donné rendez-vous à Dresde aux rois ses vassaux. On vit réunis: François II d'Autriche, Frédéric-Guillaume de Prusse, les rois de Bavière et de Wurtemberg, Jérôme, roi de Westphalie, et les Grands-Ducs de la Confédération, pléiade éclatante, gravitant autour de ce nouveau soleil. Napoléon les regardait comme ses créatures, et disait quand on lui annonçait des rois: Qu'ils attendent. (CANTU, Histoire universelle, t. XVIII.)
(256) CÉSAR CANTU, Histoire universelle, t. XVIII.
(257) CÉSAR CANTU, Histoire universelle, t. XVIII.
(258) Le comte DE SÉGUR, cité par ROHRBACHER, Histoire de l'Eglise, t. XXVIII, p. 155.—DARESTE, Histoire de France, t. VIII p. 518. —L'anecdote du chapitre précédent n'atténue en rien ce récit: l'une est une nouvelle, l'autre est le burin de l'histoire.
(259) Hist. univ., t. XVIII.
(260) « Les juifs ne demandèrent même pas la révocation du décret impérial qui, pendant quatre ans encore, devait, sous le règne de la Charte constitutionnelle, les placer sous une loi d'exception. Ils attendirent patiemment le terme où cette ordonnance, suspensive de droits qu'on ne pouvait plus leur contester, devait tomber aux acclamations de la France entière. (HALÉVY, Histoire des juifs, pp. 315-316.)
(261) The Rothschilds, by JOHN REEVES, Londres, 1887. — Revue les Deux Mondes, 1888: les Grandes Fortunes en Angleterre.
(262) Mémoires du général baron de Marbot, t. I, chap. XXXI
(263) The Rothschilds, by JOHN REEVES. — Revue des Deux Mondes 1888.
(264) Isaïe, XXI, 11.
(265) The Rothschilds, by JOHN REEVES.
(266) Ibid.
(267) MAYNARD
(268) CHATEAUBRIAND, Congrès de Vérone.
(269) Rothschild, 1848 (Paris, chez l'éditeur, rue Colbert-Vivienne, 4).
(270) Les Anglais ont défendu Grouchy contre Napoléon. « L'Empereur laisse les Prussiens lui échapper après leur défaite de Ligny, et donne une fausse direction au maréchal Grouchy chargé de les poursuivre avec 33.000 hommes. Par suite de ce mouvement mal ordonné, Grouchy, pendant qu'on se bat à Waterloo, est à Wavre, où il livre un combat inutile au corps prussien de Thielemann, laissant Blücher libre de se porter au secours de Wellington. A chaque instant, pendant ces journées, Napoléon se montra négligent, inactif, inabordable et plus semblable à un Darius qu'à un Alexandre » (SEELEY, Histoire de Napoléon Ier.)
(271) CHATEAUBRIAND, Congrès de Vérone.
(272) The Rothschilds, by JOHN REEVES. — Revue des Deux Mondes, 1888.
(273) The Rothschilds, by JOHN REEVES. — Revue des Deux Mondes, 1888.
(274) EUGÈNE DE MIRECOURT, les Contemporains: Rothschild.
(275) CHATEAUBRIAND: Négociations, colonies espagnoles, LXXVII.
(276) Les gladiateurs avaient toujours dit, dans leur salut à César: Te morituri..., les chrétiens y substituèrent fièrement: Te judicaturi. !
(277) LACORDAIRE, 43e conférence: « Des efforts du rationalisme pour dénaturer la vie de Jésus-Christ. »
(278) D'après l'étymologie hébraïque, Magdala, domaine de Galilée qui a fourni à Madeleine son nom, signifie magnificence.
(279) DÉZOBRY.
(280) THIERS, Histoire du Consulat et de l’Empire; TAINE, Les Origines de la France contemporaine : le Régime moderne.
(281) Personarum acceptio non est apud eum. (Ephés., VI, 9.)
(282) Premier livre des Machab., I.
(283) Isaïe, chap. XLV.
(284) Voir plus haut pages 57-63.
(285) En effet, dans une fine critique, M. Sainte-Beuve rappelle ce premier élan de Chateaubriand. La première préface, dit-il, du Génie du Christianisme se terminait par ces mémorables paroles: « Je pense que tout homme qui peut espérer quelques lecteurs rend un service à la société en tâchant de rallier les esprits à la cause religieuse; et, dut-il perdre sa réputation comme écrivain, il est obligé en conscience de joindre sa force, toute petite qu'elle est, à celle de cet homme puissant qui nous a retirés de l'abîme. « Celui à qui toute force a été donnée pour pacifier le monde, à qui tout pouvoir a été confié pour restaurer la France, a dit, comme autrefois Cyrus: Allez, rebâtissez le Temple de Jéhovah.
« A cet ordre du libérateur, tous les fils du peuple choisi, et jusqu'aux moindres d'entre eux, doivent rassembler des matériaux pour hâter la reconstruction de l'édifice. Obscur israélite, j'apporte aujourd'hui mon grain de sable. » Voilà ce que l'obscur israélite, encore obéissant, disait en présentant son tribut au nouveau Cyrus, et Cyrus de son côté l'entendit. (SAINTE-BEUVE, Etude littéraire sur Chateaubriand.)
(286) BOSSUET, Discours sur l'Histoire universelle, Iere partie, époque VII. — IIe partie, chap. VI.
(287) JOSÈPHE, Antiq. Jud., XI, 1. 2.
(288) Etendu sur un lit de douleur, courbé sous la main vengeresse de Dieu, que ses contemporains eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher de reconnaître, le corps dévoré avant la mort par la pourriture et les vers, Hérode, âgé de soixante-dix ans, le cœur encore plein de haine contre Dieu et contre les hommes, voulut couronner par un dernier forfait une vie remplie de crimes et d'horreur. Il ordonna sous peine de mort aux juifs des principales familles de son royaume, aux chefs des différentes tribus, de venir le trouver à Jéricho. Puis, les ayant fait enfermer dans le nouvel hippodrome, il commanda, par un raffinement de cruauté inouïe, qu'aussitôt qu'il aurait rendu l'âme, on les fît mourir tous en masse en les perçant de traits, afin qu'à sa mort tout le pays fût jeté dans la consternation, et que son trépas fût pleuré par un deuil universel. (JOSÈPHE, Antiquit., lib. XVII, cap. VIII; et Bell. Jud., lib. I, cap. XXI.)
(289) STANISLAS GIRARDIN, Journal et Mémoires, III, Visite du premier Consul à Ermenonville.
(290) Cyrus fut la figure du Christ, lorsqu'il délivra les israélites de la captivité de Babylone, qui était le type du royaume de Satan.
(291) La nouvelle inscription de Cyrus découverte à Babylone, dite Brique de Cyrus, jette sur son caractère religieux un jour inattendu. Les historiens l'avaient représenté jusqu'ici comme un monothéiste fervent, un destructeur des idoles, un fidèle sectateur de la doctrine de Zoroastre. Or, il résulte de l'inscription nouvelle que non seulement il ne fut pas persécuteur des idolâtres, mais qu'il prit part à leur culte et accepta leurs idées, au moins dans une certaine mesure. La politique l'emporta en lui sur le zèle religieux (VIGOUROUX, la Bible et les Découvertes modernes, t. IV, p. 556.)