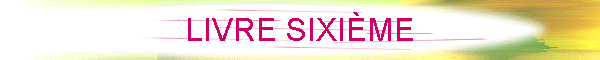|
|
|
|
LIVRE SIXIÈME.AUGUSTIN A TRENTE ANS
Sainte Monique retrouve son fils à Milan. Assiduité dAugustin aux prédications de saint Ambroise. Son ami Alypius. Projet de vie en commun avec ses amis. Sa crainte de la mort et du jugement.
SAINTE MONIQUE SUIT SON FILS A MILAN. ELLE SE REND A LA DÉFENSE DE SAINT AMBROISE. OCCUPATIONS DE SAINT AMBROISE. ASSIDUITÉ DAUGUSTIN AUX SERMONS DE SAINT AMBROISE. NÉCESSITÉ DE CROIRE CE QUE LON NE COMPREND PAS ENCORE. ALYPIUS ENTRAÎNÉ AUX SANGLANTS SPECTACLES DU CIRQUE. ALYPIUS SOUPÇONNÉ DUN LARCIN. INTÉGRITÉ DALYPIUS. ARDEUR DE NEBRIDIUS A LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ. SES ENTRETIENS AVEC ALYPLUS SUR LE MARIAGE ET LE CÉLIBAT. SA MÈRE NOBTIENT DE DIEU AUCUNE RÉVÉLATION SUR LE MARIAGE DE SON FILS. PROJET DE VIE EN COMMUN AVEC SES AMIS. LA FEMME QUIL ENTRETENAIT ÉTANT RETOURNÉE EN AFRIQUE, IL EN PREND UNE AUTRE. SA CRAINTE DE LA MORT ET DU JUGEMENT.
CHAPITRE PREMIER.SAINTE MONIQUE SUIT SON FILS A MILAN.
1. O mon espérance dès ma jeunesse, où donc vous cachiez-vous à moi? où vous étiez-voui retiré? Nest-ce pas vous qui maviez fait si différent des brutes de la terre et des oiseaux du ciel? Vous maviez donné la lumière qui leur manque, et je marchais dans la voie ténébreuse et glissante; je vous cherchais hors de moi et je ne trouvais pas le Dieu de mon coeur. Javais roulé dans la mer profonde, et jétais dans la défiance et le désespoir de trouver jamais la vérité. Et déjà javais auprès de moi ma mère. Elle était accourue, forte de sa piété, me suivant par mer et par terre, sûre de vous dans tous les dangers. Au milieu des hasards de la mer, elle encourageait les matelots mêmes qui encouragent dordinaire les novices affronteurs de labîme, et leur promettait lheureux terme de la traversée, parce que, dans une vision, vous lui en aviez fait la promesse. Elle me trouva dans le plus grand des périls, le désespoir de rencontrer la vérité. Et cependant, quand je lui annonçai que je nétais plus manichéen, sans être encore chrétien catholique, elle ne tressaillit pas de joie, comme à une nouvelle imprévue: son âme ne portait plus le deuil dun fils perdu sans espoir; mais ses pleurs coulaient toujours pour vous demander sa résurrection; sa pensée était le cercueil où elle me présentait à Celui qui peut dire : « Jeune homme, je te lordonne, lève- toi! » afin que le fils de la veuve, reprenant la vie et la parole, fût rendu par vous à sa mère (Luc VII, 14, 15). Son coeur ne fut donc point troublé par la joie en apprenant quune si grande quantité de larmes navait pas en vain coulé. Sans être encore acquis à la vérité, jétais du moins soustrait à lerreur. Mais certaine que vous nen resteriez pas à la moitié du don que vous aviez promis tout entier, elle me dit avec un grand calme, et dun coeur plein de confiance, quelle était persuadée en Jésus-Christ, quavant de sortir de cette vie, elle me verrait catholique fidèle. Ainsi elle me parla : mais en votre présence, ô source des miséricordes, elle redoublait de prières et de larmes afin quil vous plût daccélérer votre secours et dilluminer mes ténèbres; plus fervente que jamais à léglise, et suspendue aux lèvres dAmbroise, à la source « deau vive qui court jusquà la vie éternelle (Jean IV, 14); » elle laimait comme un ange de Dieu, elle savait que cétait lui qui, me réduisant aux perplexités du doute, avait décidé cette crise, dangereux, mais infaillible passage de la maladie à la santé.
CHAPITRE II.ELLE SE REND A LA DÉFENSE DE SAINT AMBROISE.
2. Ma mère ayant apporté aux tombeaux des martyrs, selon lusage de lAfrique, du pain, du vin et des gâteaux de riz, le portier de léglise lui opposa la défense de lévêque; elle reçut cet ordre avec une pieuse soumission, et je ladmirai si prompte à condamner sa coutume plutôt quà discuter la défense (Saint Augustin, de venu évêque, imita saint Ambroise et attaqua cette coutume dont abusait lintempérance. (Voir lett. 22 à Aurélien de Carthage, et lett. 29 à Alypius.). Lintempérance ne livrait aucun assaut à son esprit, et lamour du vin ne lexcitait pas à la haine de la vérité, comme tant de personnes, hommes (406) et femmes, pour qui les chansons de sobriété sont le verre deau qui donne des nausées à livrogne. Lorsquelle apportait sa corbeille remplie des offrandes funèbres, elle en goûtait et distribuait le reste, ne se réservant que quelques gouttes de vin, autant que lhonneur des saintes mémoires en pouvait demander à son extrême sobriété. Si le même jour célébrait plus dun pieux anniversaire, elle portait sur tous les monuments un seul petit flacon de vin trempé et tiède, quelle partageait avec les siens en petites libations; car elle satisfaisait à sa piété et non à son plaisir. Sitôt quelle eut appris que le saint évêque, le grand prédicateur de votre parole, avait défendu cette pratique même aux plus sobres observateurs, pour refuser aux. ivrognes toute occasion de se gorger dintempérance dans ces nouveaux banquets funèbres trop semblables à la superstition païenne, elle y renonça de grand coeur, et au lieu dune corbeille garnie de terrestres offrandes, elle sut apporter aux tombeaux des martyrs une âme pleine des voeux les plus épurés; se réservant de donner aux pauvres selon son pouvoir, il lui suffit de participer, dans ces saints lieux, à la communion du corps du Seigneur, dont les membres, imitateurs .de sa croix, ont reçu la couronne du martyre. Il me semble toutefois, Seigneur mon Dieu, et tel est le sentiment de mon coeur en votre présence, quil neût pas été facile dobtenir de ma mère le retranchement de cette pratique, si la défense en eût été portée par un autre moins aimé delle quAmbroise, quelle chérissait comme linstrument de mon salut; et lui laimait pour sa vie exemplaire, son assiduité à léglise, sa ferveur spirituelle dans lexercice des bonnes oeuvres; il ne pouvait se taire de ses louanges en me voyant, et me félicitait davoir une telle mère. Il ne savait pas quel fils elle avait en moi, qui doutais de toutes ces grandes vérités, et ne croyais pas quon pût trouver le chemin de la vie.
CHAPITRE III.OCCUPATIONS DE SAINT AMBROISE.
3. Mes gémissements et mes prières ne vous appelaient pas encore à mon secours; mon esprit inquiet cherchait et discutait sans repos. Et jestimais Ambroise lui-même un homme heureux suivant le siècle, à le voir honoré des plus hautes puissances de la terre : son célibat seul me semblait pénible. Mais tout ce quil nourrissait despérance, tout ce quil avait de luttes à soutenir contre les séductions de sa propre grandeur, tout ce quil trouvait de consolations dans ladversité, de charmes dans la voix secrète qui lui parlait au fond du coeur, tout ce quil goûtait de savoureuses joies en ruminant le pain de vie, je nen avais nul pressentiment, nulle expérience, et lui ne se doutait pas de mes angoisses et de la fosse profonde où jallais tomber. Il métait impossible de lentretenir de ce que je voulais, comme je le voulais; une armée de gens nécessiteux me dérobait cette audience et cet entretien il était le serviteur de leurs infirmités. Sils lui laissaient quelques instants, il réconfortait son corps par les aliments nécessaires et son esprit par la lecture. Quand il lisait, ses yeux couraient les pages dont son esprit perçait le sens; sa voix et sa langue se reposaient. Souvent en franchissant le seuil de sa porte, dont laccès nétait jamais défendu, où lon entrait sans être annoncé, je le trouvais lisant tout bas et jamais autrement. Je masseyais, et après être demeuré dans un long silence (qui eût osé troubler une attention si profonde ?) je me retirais, présumant quil lui serait importun dêtre interrompu dans ces rapides instants, permis au délassement de son esprit fatigué du tumulte de tant daffaires. Peut-être évitait-il une lecture à haute voix, de peur dêtre surpris par un auditeur attentif em quelque passage obscur ou difficile, qui le contraignit à dépenser en éclaircissement ou en dispute, le temps destiné aux ouvrages dont il sétait proposé lexamen; et puis, la nécessité de ménager sa voix qui se brisait aisément, pouvait être encore une juste raison de lecture muette. Enfin, quelle que fût lintention de cette habitude, elle ne pouvait être que bonne en un tel homme. 4. Il métait donc impossible dinterroger à mon désir votre saint oracle qui résidait dans son coeur, sauf quelques demandes où il ne fallait quun mot de réponse. Cependant mes vives sollicitudes épiaient un jour de loisir où elles pussent sépancher en lui, elles ne le trouvaient jamais. Sans doute, je ne laissais jamais passer le jour du Seigneur sans lentendre expliquer au peuple avec certitude la parole de vérité ( II Tim. II, 15), et je massurais de plus en (407) plus que lon pouvait démêler tous ces noeuds de subtiles calomnies que ces imposteurs ourdissaient contre les divines Ecritures. Mais quand jeus appris, quen croyant lhomme fait à votre image, vos fils spirituels, à qui votre grâce a donné une seconde naissance au sein de lunité catholique, ne vous croyaient point pour cela limité aux formes du corps humain, quoique je ne pusse alors concevoir le plus léger, le plus vague soupçon dune substance spirituelle; néanmoins jeus honte, dans ma joie, davoir, tant dannées durant, aboyé, non pas contre la foi catholique, mais contre les seules chimères de mes pensées charnelles dautant plus téméraire et impie, que je censurais en maître ce que je devais étudier en disciple. O très-haut et très-prochain, très-caché et très-présent, Et re sans parties plus ou moins grandes, tout entier partout, et tout entier nulle part, vous nêtes point cette forme corporelle, et pourtant vous avez fait lhomme à votre image, lhomme qui de la tête aux pieds tient dans un espace.
CHAPITRE IV.ASSIDUITÉ DAUGUSTIN AUX SERMONS DE SAINT AMBROISE.
5. Ne sachant donc de quelle manière votre image pouvait résider dans lhomme, ne devais-je pas frapper à la porte et demander comment il fallait croire, loin de mécrier dans linsolence de mon erreur : Voilà ce que vous croyez? Jétais dautant plus vivement rongé du désir intérieur de tenir la certitude, que, jouet et dupe de vaines promesses, javais plus longtemps, à ma honte, débité comme certains tant de peut-être, avec toute la puérilité de lerreur et de la passion : jen ai vu clairement depuis la fausseté. Certain aussi de les avoir tenus pour certains, jétais déjà certain de leur incertitude, lors même que jélevais contre votre Eglise mes aveugles accusations; et sans être sûr quelle enseignât la vérité, je savais bien quelle nenseignait pas ce que ma témérité lui reprochait. Ainsi je me sentais confondre et changer, et je me réjouissais, ô mon Dieu, que votre Eglise unique, corps de votre Fils unique, où, tout enfant, on mit sur mes lèvres le nom du Christ, ne se nourrît pas de bagatelles puériles, et que nul article de sa pure doctrine ne vous fît cette violence, ô Créateur de toutes choses, de vous resserrer, sous forme humaine, dans un espace limité, si large et si vaste quil pût être! 6. Je me réjouissais encore que lancienne Loi et les Prophètes ne me fussent plus proposés à lire du même oeil qui my faisait remarquer tant dabsurdités, quand je reprochais à vos saints les sentiments que je leur prêtais. Et jaimais à entendre Ambroise recommander souvent, au peuple, dans ses sermons, cette règle suprême « La lettre tue et lesprit vivifie (II Cor. III, 6). » Et, lorsquen soulevant le voile mystique, il découvrait lesprit là où la lettre semblait enseigner une erreur, il ne disait rien qui me déplût, quoique je ne susse pas encore sil disait la vérité. Je retenais mon coeur sur le penchant de ladhésion, de peur du précipice; et cette suspension même métouffait. Je voulais être aussi sûr de ce qui échappait à ma vue que de sept et trois sont dix. Je nétais pas, il est vrai, assez insensé pour croire que je pusse ici me tromper; mais je voulais avoir la même compréhension de toute vérité, soit corporelle et éloignée de mes sens, soit spirituelle, quoique ma pensée ne sût rien se représenter sans corps. Or, je devais croire pour guérir, pour que les yeux de mon esprit, dégagés de leur voile, pussent sarrêter en quelque sorte sur votre vérité éternelle, sans révolution et sans éclipse. Mais trop souvent celui qui a passé par le mauvais médecin nose plus se fier même au bon. Ainsi mon âme souffrante, que la foi seule pouvait guérir, de peur dêtre trompée par. la foi, se refusait à sa guérison. Elle résistait à ce puissant remède préparé par vos mains, et que vous prodiguez à lunivers avec souveraine efficace.
CHAPITRE V.NÉCESSITÉ DE CROIRE CE QUE LON NE COMPREND PAS ENCORE.
7. Toutefois, je préférais dès lors la doctrine catholique, jugeant quelle commande avec plus de modestie et entière sincérité, de croire ce qui nest point démontré (soit quon ait affaire à qui ne peut porter la démonstration, soit quil ny ait point de démonstration possible), tandis que leurs téméraires promesses de science, appât dérisoire à la crédulité, ne sont quun ramas de fables et dabsurdités (408) quils ne peuvent soutenir, et dont ensuite ils imposent la créance. Et votre main miséricordieuse et douce, ô Seigneur! prenant et façonnant mon coeur peu à peu, je remarquais quelle infinité de faits je croyais, dont je navais été ni témoin, ni contemporain; tant dévénements dans lhistoire des nations, tant de récits de lieux, de villes, dactions, contés par des amis, des médecins, par tous les hommes, quil faut admettre sous peine de rompre toutes les relations de la vie. Une foi inébranlable ne massurait-elle pas des auteurs de ma naissance? et que pouvais-je en savoir, si je ne croyais au témoignage? Ainsi vous mavez persuadé que, loin de blâmer ceux qui ajoutent foi à vos Ecritures, dont vous avez si puissamment établi lautorité chez presque tous les peuples du monde, les incrédules seuls sont répréhensibles, et ne doivent point être écoutés quand ils nous disent Doù savez-vous si ces livres ont été communiqués au genre humain par lEsprit du vrai Dieu, qui est la vérité même? Et cest précisément là ce quil me fallait croire, puisque, dans ces luttes sophistiques de questions captieuses, dans ces conflits de philosophes dont javais lu les livres, rien navait pu déraciner en moi la croyance que vous êtes, tout en ignorant ce que vous êtes, ni me faire douter que la conduite des choses humaines appartînt à votre Providence. 8. Ma foi, à cet égard, était, il est vrai, tantôt plus forte, tantôt plus faible; mais toujours ai-je cru que vous êtes, et que vous prenez souci de nous, quoique je ne susse que penser de votre substance, ou de la voie qui conduit, qui ramène à vous. Ainsi donc, impuissante à trouver la vérité par raison pure, notre faiblesse a besoin de lappui des saints Livres, et je commençai dès lors à croire que vous nauriez point investi cette Ecriture dune autorité si haute et si universelle, sil ne vous avait plu dêtre cru, dêtre cherché par elle. Quant aux absurdités où je me choquais dordinaire, quelques explications plausibles données devant moi men faisaient déjà rapporter linconnu étrange à la profondeur des mystères. Et son autorité mapparaissait dautant plus vénérable et plus digne de foi, que, soffrant à la main de tout lecteur, elle nen conservait pas moins dans la profondeur du sens la majesté de ses secrets; accessible par la nudité de lexpression, par labaissement du langage, et toutefois exerçant les coeurs les plus méditatifs; recevant tous les hommes en son vaste sein, nen faisant passer quun petit nombre jusquà vous à travers le fin tissu de son voile, mais beaucoup plus néanmoins que si, au faite dautorité où elle est élevée, elle ne rassemblait le genre humain dans le giron de son humilité sainte. Ainsi je méditais, et vous veniez à moi. Je soupirais, et vous prêtiez loreille. Je flottais, et vous me gouverniez. Jallais par la voie large du siècle, et vous ne mabandonniez pas.
CHAPITRE VI.MISÈRE DE LAMBITION.
9. Jaspirais aux honneurs, aux richesses, au mariage, et jétais votre risée. Et je trouvais dans ces désirs mille épines douloureuses; et vous métiez dautant plus propice que vous me rendiez plus amer ce qui nétait pas vous. Voyez mon coeur, ô Seigneur! qui mavez inspiré ces souvenirs et cette confession. Que désormais sattache à vous mon âme que vous avez dégagée des gluants appâts de la mort! Quelle était sa misère! Et vous ne cessiez de piquer sa plaie vive, afin quau mépris de tout elle se convertît à vous, qui êtes au-dessus de tout, sans qui rien ne serait; quelle se convertît et guérît. Quelle était la grandeur de mon mal, et quelle fut, pour me le faire sentir, lhabileté de votre traitement, alors que je me disposais à prononcer un panégyrique de lempereur, où je devais débiter force mensonges qui eussent été accueillis par des applaudissements complices! et mon coeur était haletant de soucis, jétais possédé de la fièvre des pensers dévorants, quand, passant par une rue de Milan, japerçus un pauvre, aviné, je crois, et en joyeuse humeur. Je soupirai, et, madressant à quelques amis qui se trouvaient avec moi, je déplorai nos laborieuses folies. Tous nos efforts, si pénibles, et tels que ceux dont jétais alors consumé, traînant sous laiguillon des passions cette charge de misère, de plus en plus lourde à mesure quon la traîne, avaient-ils dautre but que cette sécurité joyeuse, où ce mendiant nous avait précédés, où peut-être nous narriverions jamais ? Quelques pièces dargent mendiées lui avaient suffi pour acquérir ce que je poursuivais dans ces âpres défilés, par mille sentiers dangoisse, la joie dune félicité temporelle. (409) Il navait pas, sans doute, une joie véritable; mais lobjet de mon ambitieuse ardeur était bien plus faux encore. Il était du moins sûr de sa joie, et jétais soucieux. Il était libre; moi, rongé dinquiétudes. Que si lon meût demandé mon choix entre la joie ou la crainte, il neût pas été douteux; et si de nouveau lon eût offert à mon choix dêtre tel que cet homme, ou tel que jétais alors, jeusse préféré dêtre moi avec mon fardeau de sollicitudes et de craintes, mais par aveuglement, et non par rectitude. Devais-je donc me préférer à lui, pour être plus savant, si ma science ne me donnait pas plus de joie, et si je nen usais que pour plaire aux hommes, non pas afin de les instruire, mais uniquement de leur plaire? Cest pourquoi vous brisiez mes os avec la verge de votre discipline. 10. Loin donc de mon âme ceux qui lui disent: Il y a joie et joie. Ce mendiant trouvait la sienne dans livresse, et tu cherchais la tienne dans la gloire. Et quelle gloire, Seigneur, celle qui nest pas en vous? Mensonge de joie mensonge de gloire: seulement, cette gloire était plus captieuse à mon esprit. La nuit allait cuver son ivresse, et moi javais dormi, je métais levé, jallais dormir et me lever avec la mienne, combien de jours encore? Oui, il y a joie et joie. Celle des saintes espérances est infiniment distante de la vaine allégresse de ce malheureux. Mais alors même, grande était la distance de lui à moi. Plus heureux que moi, il ne se sentait point daise, quand les soucis me déchiraient les entrailles; et il avait acheté son vin en souhaitant mille prospérités aux coeurs charitables, tandis que cétait au prix du mensonge que je marchandais la vanité. Je tins alors à mes amis plus dun discours semblable , et mes réflexions sur mon état étaient fréquentes, et je le trouvais alarmant; et jen souffrais, et cette affliction redoublait le malaise. Et si quelque prospérité semblait me sourire, javais peine à avancer la main; voulais-je la saisir, elle était envolée.
CHAPITRE VII.SON AMI ALYPIUS.
11. Tel était le sujet ordinaire de nos plaintes entre amis, et principalement de mes entretiens intimes avec Alypius et Nebridius. Alypius, né dans la même cité, dune des premières familles municipales, était plus jeune que moi. Il avait suivi mes leçons à mon début dans notre ville natale et puis à Carthage; et il maimait beaucoup, parce que je lui paraissais savant et bon. Et moi je laimais à cause du grand caractère de vertu quil développait déjà dans un âge encore tendre. Cependant le gouffre de limmoralité et des spectacles frivoles, béant à Carthage, lavait englouti dans le délire des jeux du cirque. Il y était misérablement Plongé, lorsque je professais en public lart oratoire, mais il nassistait pas encore à mes cours, à cause de certaine mésintelligence élevée entre son père et moi. Jappris avec douleur cette pernicieuse passion ; jallais perdre, peut-être avais-je déjà perdu ma plus haute espérance. Et je navais, pour lavertir ou le réprimer , ni le droit dune bienveillance amicale, ni lautorité dun maître. Je croyais quil partageait à mon égard les sentiments de son père; mais il nen était rien. Car, loin de sen inquiéter, il me saluait et venait même à mon auditoire mécouter quelques instants et se retirait. 12. Et néanmoins, il métait sorti de lesprit de lentretenir, pour le conjurer de ne pas sacrifier une aussi belle intelligence à laveugle entraînement de ces misérables jeux. Mais vous, Seigneur, qui ne lâchez jamais les rênes dont vous gouvernez vos créatures, vous naviez pas oublié quil devait être, entre vos enfants, lun des premiers ministres de vos mystères. Et pour que lhonneur de son redressement vous revînt tout entier, vous men fîtes linstrument, mais linstrument involontaire. Un jour que je tenais ma séance ordinaire, il vint, me salua, prit place entre mes disciples, et se mit à mécouter avec attention. Et par hasard, la leçon que javais entre les mains me parut demander, pour son explication, une comparaison empruntée aux jeux du cirque, qui dût jeter sur mes paroles plus dagrément et de lumières, avec un assaisonnement de raillerie piquante contre les esclaves dune telle manie. Vous savez, mon Dieu, que je ne songeais nullement alors à en guérir Alypius. Mais il saisit le trait pour lui, ne le croyant adressé quà lui seul un autre men eût voulu, lui sen voulut à lui-même ; excellent jeune homme, et qui men aima encore de plus vive amitié! Naviez-vous pas déjà dit depuis longtemps, dans vos Ecritures : « Reprends le sage et il taimera (Prov. IX, 8)? » Et néanmoins ce ne fut (410) pas moi qui le, repris; mais vous, à qui, soit de gré, soit à notre insu, nous servons tous dinstruments selon lordre de votre sagesse et de votre justice. Ce fut vous qui fîtes de mon coeur et de ma langue des charbons ardents pour brûler et guérir le mal dont se mourait cette âme de précieuse espérance. Que celui-là taise vos louanges qui ne considère pas vos miséricordes; elles parlent en votre honneur du fond de mes moelles. Javais dit, et aussitôt Alypius sélança hors de labîme où un aveugle plaisir lavait précipité; sa magnanime résolution secoua son âme et en fit tomber toutes les ordures du cirque, où il ne revint jamais depuis. Bientôt après, triomphant de la résistance de son père, il emporta la permission de me prendre pour maître. Redevenu mon disciple, il sengagea avec moi dans les superstitions des Manichéens, aimant en eux cet extérieur de continence quil croyait naturel et vrai. Mais cette continence était loin de leur coeur; ce nétait quun piége tendu aux âmes généreuses ( Prov. VI, 26) qui natteignant pas encore aux profondeurs de la vertu, se laissent prendre à la superficie où glissent son ombre et sa trompeuse image.
CHAPITRE VIII.ALYPIUS ENTRAÎNÉ AUX SANGLANTS SPECTACLES DU CIRQUE.
13. Nourri par ses parents dans lenchantement des voies du siècle, loin de les délaisser, il mavait précédé à Rome pour y apprendre le droit; et là, il fut pris dune étrange passion pour les combats de gladiateurs, et de la façon la plus étrange. Il avait pour ces spectacles autant daversion que dhorreur, quand un jour, quelques condisciples de ses amis, au sortir de table, le rencontrent, et malgré lobstination de ses refus et de sa résistance, lentraînent à lamphithéâtre avec une violence amicale, au moment de ces cruels et funestes jeux. En vain il sécriait: « Vous pouvez entraîner mon corps et le placer près de vous, mais pourrez-vous ouvrir à ces spectacles mon âme et mes yeux? Jy serai absent, et je triompherai et deux et de vous.» Il eut beau dire, ils lemmenèrent avec eux, curieux peut-être déprouver sil pourrait tenir sa promesse. Ils arrivent, prennent place où ils peuvent; tout respirait lardeur et la volupté du sang. Mais lui, fermant la porte de ses yeux, défend à son âme de descendre dans cette arène barbare; heureux sil eût encore condamné ses oreilles! car, à un incident du combat, un grand cri sétant élevé de toutes parts, il est violemment ému, cède à la curiosité, et se croyant peut-être assez en garde pour braver, et vaincre même après avoir vu, il ouvre les yeux. Alors son âme est plus grièvement blessée que le malheureux même quil a cherché dun ardent regard, il tombe plus misérable que celui dont la chute a soulevé cette clameur: entré par son oreille, ce cri a ouvert ses yeux pour livrer passage au coup qui frappe et renverse un coeur plus téméraire que fort, dautant plus faible quil plaçait sa confiance en lui-même au lieu de vous. A peine a-t-il vu ce sang, il y boit du regard la cruauté. Dès lors il ne détourne plus loeil; il larrête avec complaisance; il se désaltère à la coupe des furies, et sans le savoir, il fait ses délices de ces luttes féroces; il senivre des parfums du carnage. Ce nétait plus ce même homme qui venait darriver, cétait lun des habitués de cette foule barbare; cétait le véritable compagnon de ses condisciples. Que dirai-je encore? il devint spectateur, applaudisseur, furieux enthousiaste, il remporta de ce lieu une effrayante impatience dy revenir. Ardent, autant et plus. que ceux qui lavaient entraîné, il entraînait les autres. Et cest pourtant de si bas que votre main puissante et miséricordieuse la retiré, et vous lui avez appris .à ne point sassurer en lui, mais en vous, bien longtemps après néanmoins.
CHAPITRE IX.ALYPIUS SOUPÇONNÉ DUN LARCIN.
14. Ce souvenir restait dans sa mémoire comme un préservatif à lavenir. Semblable avertissement lui avait été déjà donné, lorsquil était mon disciple à Carthage. Cétait vers le milieu du jour; il se promenait au Forum, pensant à une déclamation quil devait prononcer selon la coutume dans les exercices de lécole, quand surviennent les gardes du palais qui larrêtent comme voleur. Vous laviez permis, mon Dieu, sans doute afin quil apprît, devant être un jour si grand, combien il importe que lhomme, juge de lhomme, ne prononce pas sur le sort de son semblable avec une crédulité téméraire. (411) Il se promenait donc seul, devant le tribunal, avec ses tablettes et son stylet, lorsquun jeune écolier, franc voleur, secrètement muni dune hache, sans être aperçu de lui, sapproche des barreaux de plomb en saillie sur les devantures de la voie des Orfèvres, et se met à les couper. Au bruit de la hache, on sécrie à lintérieur et on envoie des gens pour saisir le coupable. Entendant leurs voix, celui-ci prend la fuite et jette son instrument, de peur dêtre surpris armé. Alypius qui ne lavait pas vu entrer, le voit sortir et fuir rapidement. Il sapproche pour sinformer; étonné de trouver une hache, il sarrête à la considérer. On laperçoit, seul, tenant loutil dont le bruit avait donné lalarme. On larrête, on lentraîne, on appelle tous les habitants du voisinage, on le montre en triomphe comme un voleur pris en flagrant délit quon va livrer au juge. 15. Mais la leçon devait se borner là. Vous vîntes aussitôt, Seigneur, au secours de son innocence, dont vous étiez le seul témoin. Comme on le menait à la prison ou au supplice, il se trouva à la rencontre un architecte, spécialement chargé de la conservation des bâtiments publics. Les gens qui le tiennent sont charmés quà leur passage vienne précisément soffrir celui qui dordinaire les soupçonnait des larcins commis au Forum ; il en allait enfin connaître les auteurs. Or, cet homme avait plus dune fois vu Alypius chez un sénateur quil allait souvent saluer. Il le reconnaît, lui prend la main et, le tirant à part, lui demande la cause de ce désordre, et apprend ce qui sest passé. La foule sémeut et murmure avec menace; larchitecte commande quon le suive. On passe devant la maison du jeune homme coupable. A la porte se trouvait un enfant, trop petit pour être retenu dans sa révélation par la crainte de compromettre son maître, quil avait accompagné au Forum. Alypius le voit et le désigne à larchitecte, qui, montrant la hache à lenfant, lui demande à qui elle est: à nous, répond à linstant celui-ci. On linterroge de nouveau; tout se découvre. Ainsi, le crime retomba sur cette maison, à la confusion de la multitude, qui déjà triomphait dAlypius. Dispensateur futur de votre parole, et juge de tant daffaires en votre Eglise, il sortit de ce danger avec plus dinstruction et dexpérience.
CHAPITRE X.INTÉGRITÉ DALYPIUS. ARDEUR DE NEBRIDIUS A LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ.
16. Je lavais rencontré à Rom e, où il sunit à moi damitié si étroite quil me suivit à Milan pour ne point se séparer de moi, et aussi pour utiliser sa science du droit, suivant le désir de ses parents plutôt que le sien. Eprouvé déjà par trois emplois, où son désintéressement navait pas moins étonné les autres quil nétait surpris lui-même de la préférence quon pouvait accorder à lor sur la probité, une dernière tentative contre sa fermeté avait mis en oeuvre tous les ressorts de la séduction et de la terreur. Il remplissait à Rome les fonctions dassesseur, auprès du comte des revenus dItalie, quand un sénateur, puissant par ses bienfaits et son crédit, accoutumé à ne pas trouver dobstacles, voulut se permettre je ne sais quoi de contraire à la loi. Alypius sy oppose. On lui promet une récompense, quil dédaigne; on essaie de menaces, quil foule aux pieds ; tous admirant cette constance qui ne pliait pas devant un homme, bien connu pour avoir mille moyens dêtre utile ou de nuire; cette fermeté dâme également indifférente au désir de son amitié et à la crainte de sa haine. Le magistrat lui-même, dont Alypius était le conseiller, quoique opposé à cette injuste prétention, nosait cependant refuser hautement; mais sexcusant sur lhomme juste, il alléguait sa résistance; et sil fléchissait, Alypius était en effet décidé à résigner ses fonctions. Son amour pour les lettres, seul, faillit le séduire; il eût pu, avec le gain du prétoire, se procurer des manuscrits; mais il consulta la justice et prit une résolution meilleure, préférant le véto de léquité au permis de loccasion. Cela nest rien sans doute, mais « qui est fidèle dans les petites choses lest dans les grandes; » et rien ne saurait anéantir cet oracle sorti de la bouche de votre vérité: « Si vous navez pas été fidèle dispensateur dun faux trésor, qui vous confiera le véritable? Si vous navez pas été fidèle dépositaire du bien dautrui, qui vous rendra celui qui est à vous (Luc, XVI, 10-12)? » Tel était lhomme si étroitement lié avec moi, et comme moi chancelant, irrésolu sur le genre de vie à suivre. 17. Et Nebridius aussi qui avait abandonné (412) son pays, voisin de Carthage, et Carthage même, son séjour ordinaire, et le vaste domaine de son père, et sa mère qui ne songeait pas à le suivre il avait tout quitté pour venir à Milan vivre avec moi dans la poursuite passionnée de la vérité et de la sagesse. Il soupirait comme moi, il flottait comme moi, ardent à la recherche de la vie bienheureuse, profond dans lexamen des plus difficiles problèmes. Voilà donc trois bouches affamées, exhalant entre elles leur mutuelle indigence, et attendant de vous leur nourriture au temps marqué. Et, dans lamertume dont votre miséricorde abreuvait notre vie séculière, considérant le but de nos souffrances, nous ne trouvions plus que ténèbres. Nous nous détournions en gémissant, et nous disions : Jusques à quand? Et tout en le répétant, nous poursuivions toujours, parce quil ne nous apparaissait rien de certain que nous pussions saisir en lâchant le reste.
CHAPITRE XI.VIVES PERPLEXITÉS DAUGUSTIN.
18. Et je ne pouvais, sans un profond étonnement, repasser dans ma mémoire tout ce long temps écoulé depuis la dix-neuvième année de mon âge, où je métais si vivement épris de la sagesse, résolu dabandonner à sa rencontre les vaines espérances et les trompeuses chimères de mes passions. Et déjà jaccomplissais mes trente ans, embourbé dans la même fange, avide de jouir des objets présents, périssables, et qui divisaient mon âme. Je trouverai demain, disais-je; demain la vérité paraîtra, et je la saisirai. Et puis, Faustus va venir, il mexpliquera tout. O grands maîtres de lAcadémie ! on ne peut rien tenir de certain pour régler la vie. Mais non, cherchons mieux; ne désespérons pas. Voici déjà que les absurdités de lEcriture ne sont plus des absurdités; une interprétation différente satisfait la raison. Arrêtons-nous sur les degrés où, entant, mes parents mavaient déposé, jusquà ce que se présente la vérité pure. Mais où, mais quand la chercher? Ambroise na pas une heure à me donner, je nen ai pas une pour lire. Et puis, où trouver des livres? quand et comment sen procurer? à qui en emprunter? Réglons le temps; ménageons-nous des heures pour le salut de notre âme. Une grande espérance se lève. La foi catholique nenseigne pas ce dont laccusait la vanité de mon erreur. Ceux qui la connaissent condamnent comme un blasphème la croyance que Dieu soit borné aux limites dun corps humain; et jhésite à frapper pour quon achève de mouvrir? La matinée est donnée à mes disciples : que fais-je le reste du jour? pourquoi cette négligence? Mais trouverai-je un moment pour rendre visite à des amis puissants, dont le crédit mest nécessaire? pour préparer ces leçons que je vends? pour donner quelque relâche à mon esprit fatigué de tant de soins? 19. Périssent toutes ces vanités, périsse tout ce néant; employons-nous à la seule recherche de la vérité. Cette vie est misérable et lheure de la mort incertaine; si elle nous surprend, en quel état sortirons-nous dici? Où apprendrons-nous ce que nous y aurons négligé dapprendre? ou plutôt ne nous faudra-t-il pas expier cette négligence? Et si la mort allait trancher tout souci avec ce noeud de chair? Si tout finissait ainsi? Encore sen faut-il enquérir. Mais non; blasphème quun tel doute! Ce nest pas un rien, ce. nest pas un néant qui élève la foi chrétienne à cette hauteur dautorité par tout lunivers. Le doigt de Dieu naurait pas opéré pour nous tant de merveilles, si la mort du corps absorbait la vie de lâme. Que tardons-nous, que ne laissons-nous là lespoir du siècle, pour nous appliquer tout entier à chercher Dieu et la vie bienheureuse? . Mais attends encore; nest-il plus de charme dans ce monde? a-t-il perdu ses puissantes séductions? nen détache pas ton coeur à la légère. Il serait honteux de revenir à lui après lavoir quitté. Vois, à quoi tient-il que tu narrives à une charge honorable? Que pourrais-tu souhaiter après? Nai-je pas en effet des amis puissants? Quel que soit mon empressement à limiter mes espérances, je puis toujours aspirer à une présidence de tribunal; et je prendrai une femme dont la fortune sera suffisante à mon état, et là se borneront mes désirs. Combien dhommes illustres et dignes de servir dexemples, ont vécu mariés, et fidèles à la sagesse! 20. Ainsi disais-je; et les vents contraires de mes perplexités jetaient mon coeur çà et là; et le temps passait; et je tardais à me convertir à vous, Seigneur mon Dieu; je différais de jour en jour de vivre en vous, et je ne différais pas un seul jour de mourir en moi-même. Aimant la vie bienheureuse, je la redoutais dans son (413) séjour, et en la fuyant je la cherchais. Je croyais que je serais trop malheureux dêtre à jamais privé des embrassements dune femme; et le remède de votre miséricorde, efficace contre cette infirmité, ne venait pas à ma pensée, faute den avoir fait lépreuve; car jattribuais la continence aux propres forces de lhomme, et cependant je sentais ma faiblesse. Jignorais, insensé, quil est écrit : « Nul nest chaste, si vous ne lui en donnez la force ( Sagesse, VIII, 21). » Et vous me leussiez donnée, si le gémissement intérieur de mon âme eût frappé à votre oreille; si ma foi vive eût jeté dans votre sein tous mes soucis.
CHAPITRE XII.SES ENTRETIENS AVEC ALYPLUS SUR LE MARIAGE ET LE CÉLIBAT.
21. Alypius me détournait du mariage, et me représentait sans cesse que ces liens ne nous permettraient plus de vivre assurés de nos loisirs, dans lamour de la sagesse, comme nous le désirions depuis longtemps. Il était dune chasteté dautant plus admirable, quil avait eu commerce avec les femmes dans sa première jeunesse; mais il sen était détaché, avec remords et mépris, pour vivre dans une parfaite continence. Et moi je lui opposais lexemple dhommes mariés qui étaient demeurés dans la pratique de la sagesse, le service de Dieu, la fidélité aux devoirs de lamitié. Mais que jétais loin dune telle force dâme ! Esclave de cette fièvre charnelle dont jétais dévoré, je traînais ma chaîne, dans une mortelle ivresse, et je tremblais quon ne vînt la rompre, et ma plaie vive, frémissante sous lanneau secoué, repoussait la parole dun bon conseiller, la main dun libérateur. Que dis-je? le serpent, par ma bouche, parlait à Alypius; ma langue formait les noeuds et semait dans sa voie les doux piéges où son pied innocent et libre allait sembarrasser. 22. Ce lui était un prodige de me voir, moi quil estimait, pris à lappât de la volupté, jusquà lui avouer même, dans nos conversations, quil me serait impossible de garder le célibat; et pour me défendre contre son étonnement, je lui disais que ce plaisir quil avait ravi au passage, et dont un vague souvenir lui rendait le mépris si facile, navait rien de comparable aux délices de cette liaison dans laquelle je vivais. Que si la sanction du mariage venait à légitimer de telles jouissances, quel sujet aurait-il donc dêtre surpris de mon impuissance à mépriser une telle vie? Il finissait par la désirer lui-même, cédant moins aux sollicitations du plaisir quà celles de la curiosité. li voulait savoir, disait-il, quel était enfin ce bonheur sans lequel ma vie, qui lui plaisait, ne me paraissait plus une vie, mais un supplice. Libre de mes fers, son esprit sétonnait de mon esclavage, et de létonnement il se lais. sait aller au désir den faire lessai, pour tomber peut-être de cette expérience daims la servitude même qui létonnait, parce quil voulait se fiancer à la mort, et que lhomme qui aime le péril y tombe (Eccli. III, 27). Car nous nétions, lun et lautre, que faiblement touchés des devoirs qui donnent seuls quelque dignité au mariage, la continence et léducation des enfants. Pour moi, je nen aimais guère que lenivrante habitude dassouvir cette insatiable concupiscence dont jétais la proie; et lui allait trouver la captivité dans son étonnement de ma servitude. Voilà où nous en étions, jusquà ce que votre grandeur, fidèle à notre boue, prit en pitié notre misère, et vint à notre secours par de merveilleuses et secrètes voies.
CHAPITRE XIII.SA MÈRE NOBTIENT DE DIEU AUCUNE RÉVÉLATION SUR LE MARIAGE DE SON FILS.
23. Et lon pressait activement laffaire de mon mariage. Javais fait une demande; jétais accueilli; ma mère sy employait avec zèle, dautant que le mariage devait me conduire à leau salutaire du baptême; elle sentait avec joie que je men approchais chaque jour davantage; et ma profession de foi allait accomplir ses voeux et vos promesses. Mais lorsque, à ma prière et selon linstinct de son désir, elle vous suppliait, de laccent le plus passionné du coeur, de lui révéler en songe quelque chose de cette future alliance, vous navez jamais voulu lentendre. Elle voyait de vaines et fantastiques images rassemblées par la vive préoccupation de lesprit; elle me les racontait avec mépris; ce nétait plus cette confiance qui lui attestait limpression de votre doigt. Certain goût ineffable lui donnait, disait-elle, le discernement (414) de vos révélations et des songes de son âme. On pressait néanmoins mon mariage; la jeune fille était demandée, mais il sen fallait de deux années quelle fût nubile; et comme elle me plaisait, on prit le parti dattendre.
CHAPITRE XIV.PROJET DE VIE EN COMMUN AVEC SES AMIS.
24. Nous étions plusieurs amis ensemble, qui, dégoûtés des turbulentes inquiétudes de la vie humaine, objet habituel de nos réflexions et de nos entretiens, avions presque résolu de nous retirer de la foule pour vivre en paix. Notre plan était de mettre en commun ce que nous pourrions avoir, de faire une seule famille, un seul héritage, notre sincère amitié faisant disparaître le tien et le mien, le bien de chacun serait à tous, le bien de tous à chacun; nous pouvions être dix dans cette communauté, et plusieurs. dentre nous étaient fort riches; Romanianus, en particulier, citoyen de notre municipe, quune tourmente daffaires avait jeté à la cour de lempereur, et mon intime ami dès lenfance. Il était le plus ardent à presser ce dessein, et il nous le persuadait avec dautant plus dautorité, quil avait la prépondérance de la fortune. Nous avions décidé que deux dentre nous seraient chargés, comme magistrats annuels, de ladministration des affaires, les autres vivant en repos. Mais quand on vint à demander sites femmes y consentiraient, plusieurs étant déjà mariés, et nous aspirant à lêtre, largile si bien façonné de cette illusion nouvelle éclata entre nos mains, et nous en rejetâmes les débris. Et nous voilà retombés dans nos soupirs, dans nos gémissements, dans les voies du siècle larges et battues, et notre coeur roulait le flot de ses pensées devant léternelle stabilité de votre conseil ( Ps. XXXII, 2). Du haut de ce conseil, riant de nos résolutions, vous prépariez les vôtres, attendant le temps propre pour nous donner la nourriture, et pour ouvrir la main quil allait combler nos âmes de bénédiction ( Ps CXLIV, 15, 16.).
CHAPITRE XV.LA FEMME QUIL ENTRETENAIT ÉTANT RETOURNÉE EN AFRIQUE, IL EN PREND UNE AUTRE.
25. Cependant mes péchés se multipliaient; et quand on vint arracher de mes côtés, comme un obstacle à mon mariage, la femme qui vivait avec moi, il fallut déchirer le coeur où elle avait racine, et la blessure saigna longtemps. Mais elle, à son retour en Afrique, vous fit voeu de renoncer au commerce de lhomme. Elle me laissait le fils naturel quelle mavait donné. Et moi malheureux, incapable dimiter une femme, impatient de cette attente de deux années pour obtenir la main qui métait promise, nétant point amoureux du mariage, mais esclave de la volupté, je trouvai une autre femme, comme pour soutenir et irriter la maladie de mon âme, en lui continuant cette honteuse escorte de plaisirs jusquà lavènement de lépouse. Ainsi la blessure dont la première séparation mavait navré, ne guérissait pas: mais après de cuisantes douleurs, elle tournait en sanie: et le mal, plus languissant, nen était que plus désespéré.
CHAPITRE XVI.SA CRAINTE DE LA MORT ET DU JUGEMENT.
26. Louange à vous! gloire à vous! ô source des miséricordes. Je devenais de jour en jour plus déplorable, et vous plus prochain. Vous avanciez déjà la main qui allait me retirer et me laver de cette boue, et je ne men doutais pas. Et rien ne me rappelait du fond de labîme des voluptés charnelles que la crainte de la mort et de votre jugement futur, si profonde en mon coeur que tant de doctrines contraires navaient jamais pu len bannir. Et je discutais avec Alypius et Nebridius les raisons finales des biens et des maux, leur avouant que, dans mon esprit, Epicure eût obtenu la palme, si javais pu cesser de croire à la survivance de lâme après la mort, et à la rémunération des oeuvres quEpicure nadmit jamais. Si nous étions immortels, leur disais-je, vivant dans une perpétuelle volupté des sens, sans aucune crainte de la perdre, pourquoi ne serions-nous pas heureux? Et que nous faudrait-il encore? Et je ne voyais pas que cette pensée même témoignait de ma misère et de la profondeur de mon naufrage; aveugle, je napercevais pas la lumière de cette beauté chaste et (415) pure quil faut embrasser sans passion, invisible au regard de la chair, visible seulement à loeil intérieur. Et, malheureux, je ne concevais pas de quelle source coulait en moi ce plaisir que la présence de hies amis me faisait trouver au récit de ces honteuses misères. Car, au sein même des joies charnelles, je neusse pu vivre heureux, même selon lhomme sensuel dalors, sans ces amis que jaimais et, dont je .me sentais aimé sans intérêt. O voies tortueuses! malheur à lâme téméraire qui, en se retirant de vous, espère trouver mieux que vous! Elle se tourne, elle se retourne en vain, sur le dos, sur les flancs, sur le ventre; tout lui est dur. Et vous seul êtes son repos. Et vous voici! et vous nous délivrez de nos lamentables erreurs! et vous nous mettez dans votre voie, et vous nous consolez et dites : « Courez, je vous soutiendrai; je vous conduirai au but, et là, je vous soutiendrai encore. (416)
|