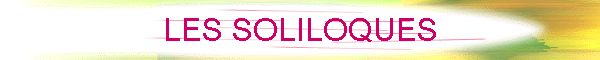|
|
|
|
TRAITÉS PHILOSOPHIQUES.
LES SOLILOQUES
ou Connaissance de Dieu et de l'âme humaine.
OEUVRES COMPLÈTES TOME III p. 125-155
Cette traduction anonyme a été revue et corrigée par M. l'abbé RAULX
CHAPITRE PREMIER. PRIÈRE A DIEU.
CHAPITRE II. CE QU'IL FAUT AIMER.
CHAPITRE III. CONNAISSANCE DE DIEU.
CHAPITRE IV. QU'EST-CE QU'UNE CONNAISSANCE CERTAINE ?
CHAPITRE V. UNE MÊME SCIENCE PEUT EMBRASSER DES CHOSES DIFFÉRENTES.
CHAPITRE VI. PAR QUELS SENS INTÉRIEURS. L'AME APERÇOIT DIEU.
CHAPITRE VII. JUSQUES A QUAND LA FOI, L'ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ SERONT NÉCESSAIRES.
CHAPITRE VIII. CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR CONNAÎTRE DIEU.
CHAPITRE IX. L'AMOUR DE NOUS-MÊMES.
CHAPITRE X. L'AMOUR DU CORPS ET DES CHOSES EXTÉRIEURES.
CHAPITRE XIII. COMMENT ET PAR QUELS DEGRÉS ON PARVIENT A LA SAGESSE.
CHAPITRE XIV. C'EST LA SAGESSE ELLE-MÊME QUI GUÉRIT LES YEUX POUR LES RENDRE CAPABLES DE VOIR.
CHAPITRE XV. COMMENT ON CONNAIT LÂME. CONFIANCE EN DIEU.
CHAPITRE PREMIER. DE L'IMMORTALITÉ DE L'HOMME.
CHAPITRE II. LA VÉRITÉ EST ÉTERNELLE.
CHAPITRE IV. PEUT-ON CONCLURE L'IMMORTALITÉ DE LAME DE LA DURÉE DU VRAI ET DU FAUX?
CHAPITRE V. QU'EST-CE QUE LE VRAI ?
CHAPITRE VI. DOÙ VIENT LA FAUSSETÉ ET OU RÉSIDE-T-ELLE?
CHAPITRE VII. DU VRAI ET DE CE QUI LUI RESSEMBLE.
CHAPITRE VIII. CE QUI CONSTITUE LE VRAI OU LE FAUX:
CHAPITRE IX. QUE SONT LE FAUX, LE TROMPEUR ET LE MENTEUR?
CHAPITRE X. IL Y A DES CHOSES VRAIES, PRÉCISÉMENT PARCE QU'ELLES SONT FAUSSES.
CHAPITRE XI. VÉRITÉ DANS LES SCIENCES. QU'EST-CE QUE LA FABLE? QU'EST-CE QUE LA GRAMMAIRE?
CHAPITRE XII. DE COMBIEN DE MANIÈRES CERTAINES CHOSES EXISTENT DANS UNE AUTRE.
CHAPITRE XIII. CONCLUSION EN FAVEUR DE L'IMMORTALITÉ DE LAME.
CHAPITRE XIV. EXAMEN DE LA CONCLUSION PRÉCÉDENTE.
CHAPITRE XV. NATURE DU VRAI ET DU FAUX.
CHAPITRE XVI. PEUT-ON DONNER AUX CHOSES EXCELLENTES LES NOMS DES CHOSES MOINDRES?
CHAPITRE XVII. Y A-T-IL QUELQUE CHOSE D'ENTIÈREMENT FAUX OU D'ENTIÈREMENT VRAI?
CHAPITRE XVIII. LES CORPS SONT-ILS VÉRITABLEMENT?
CHAPITRE XIX. L'IMMORTALITÉ DE LA VÉRITÉ PROUVE L'IMMORTALITÉ DE LAME.
CHAPITRE XX. LA VÉRITÉ EST DANS TOUTES LES AMES, MÊME A LEUR INSU.
LIVRE PREMIER.
Augustin se propose d'acquérir la connaissance de Dieu et de soi-même. Il sollicite d'abord le secours du ciel. Après avoir reconnu l'excellence de la doctrine qu'il veut acquérir, il s'entretient avec lui-même des moyens d'augmenter la pureté de son âme, afin de pouvoir s'élever avec assurance jusqu'à la contemplation de Dieu. A la fin de ce livre, il établit que tout ce qui est vrai est immortel.
CHAPITRE PREMIER. PRIÈRE A DIEU.
1. Je cherchais depuis plusieurs jours à me connaître, ce qui pouvait faire mon bien, le mal que je devais éviter : j'avais agité longtemps dans mon esprit et avec moi-même, un grand nombre de pensées diverses; tout à coup une voix me dit: cette voix, était-ce moi, était-ce quelque chose d'étranger , quelque chose d'intérieur? je ne sais, et c'est surtout ce que je cherche à savoir; cette voix me dit donc Allons, tâche de trouver quelque chose; mais à qui confieras-tu tes découvertes, afin de pouvoir en faire d'autres? Augustin. Sans doute à la mémoire. La Raison. Est-elle assez vaste pour conserver fidèlement toutes tes pensées? A. Cela est difficile ou plutôt impossible. L. R. Il faut donc écrire; mais comment puisque ta santé se refuse à cette fatigue ? d'ailleurs, ces idées ne peuvent être dictées, elles exigent une profonde solitude. A. Tu
dis vrai, aussi je ne sais que faire. L. R. Demande vie et santé pour parvenir à ce que tu désires; écris tes idées, afin que cette création de ton esprit t'inspire plus d'ardeur pour le bien. Résume ensuite brièvement ce que tu auras aperçu, sans travailler à attirer une foule de lecteurs pour le moment : tes idées seront suffisamment développées pour le petit nombre de tes concitoyens. A. C'est ce que je ferai.
2. O Dieu, créateur de l'univers ! accordez-moi d'abord de vous bien prier, ensuite de me rendre digne d'être exaucé par vous, enfin d'être délivré (1) ; ô Dieu ! par qui toutes les choses qui n'auraient pas d'existence par elles-mêmes tendent à exister; ô Dieu ! qui ne laissez pas périr les créatures mêmes qui se détruisent l'une l'autre; ô Dieu ! qui avez créé de rien ce monde, que les yeux de tous les hommes regardent comme votre plus bel ouvrage;
1. Quoique converti depuis peu de temps, saint Augustin exprime dans ce passage la nécessité et la puissance de la grâce avec beaucoup de force, et cela dans un ouvrage purement philosophique et à une époque où d ne pouvait pas être encore familiarisé avec le langage de la théologie.
126
ô Dieu ! qui n'êtes pas l'auteur du mal et qui le permettez pour prévenir un plus grand mal; ô Dieu ! qui faites voir au petit nombre de ceux qui se tournent. vers la vérité que le mal lui-même n'est rien; ô Dieu ! qui donnez la perfection à l'univers même avec des défauts; ô Dieu ! dont les ouvrages n'offrent aucune dissonance, puisque ce qu'il y a de plus imparfait répond à ce qu'il y a de meilleur; ô Dieu ! qu'aime toute créature qui peut aimer, le sachant ou à son insu; ô Dieu ! en qui sont toutes choses et qui ne souffrez rien, ni de la honte, ni de la méchanceté,.ni des erreurs de quelque créature que ce soit; ô Dieu ! qui avez voulu que les coeurs purs connussent seuls la vérité (1) ; ô Dieu ! père de la vérité, père de la sagesse, père de la véritable et souveraine vie, père de la béatitude, père du bon et du beau, père de la lumière intelligible, père des avertissements et des inspirations qui dissipent notre assoupissement, père de Celui qui nous a enseigné à retourner vers vous !
3. Je vous invoque, ô Dieu de vérité! dans qui, de qui et par qui sont vraies toutes les choses qui sont vraies; ô Dieu de sagesse! dans qui, de qui et par qui sont sages tous les êtres doués de sagesse; ô Dieu véritable et souveraine vie ! dans qui, de qui et par qui vivent tous les êtres qui possèdent la véritable et souveraine vie; ô Dieu de béatitude ! en qui, de quiet par qui sont heureuses toutes les créatures qui jouissent de la félicité; ô Dieu, bonté et beauté! par qui, de qui et dans qui sont bonnes et belles toutes les choses qui possèdent la bonté et la beauté; ô Dieu, lumière intelligible! dans qui, de qui et par qui sont rendues intelligibles toutes les choses qui brillent à notre esprit; ô Dieu ! qui avez pour royaume ce monde intellectuel, que les sens ne peuvent apercevoir; ô Dieu ! qui gouvernez votre royaume par des lois dont nos empires terrestres portent l'empreinte; ô Dieu ! se détourner de vous c'est tomber; se convertir à vous c'est se relever; demeurer en vous c'est se conserver; ô Dieu ! se retirer de vous c'est mourir; retourner vers vous c'est revivre; habiter en vous c'est vivre; ô Dieu ! personne ne vous quitte , s'il n'est trompé; personne ne vous cherche, s'il n'est averti ; personne ne vous trouve s'il n'est purifié; ô Dieu ! vous abandonner c'est périr, vous être attentif c'est vous aimer, vous voir c'est vous posséder; ô Dieu ! c'est vers vous que la foi nous éveille,
1. Rét. liv. 1, ch. IV, n. 2
à vous que l'espérance nous élève, à vous que la charité nous unit; ô Dieu ! par qui nous triomphons de l'ennemi, je vous implore; ô Dieu! c'est à vous que nous devons de ne pas périr entièrement; c'est vous qui nous exhortez à veiller; c'est vous qui nous faites distinguer le bien du mal; c'est vous qui nous faites embrasser le bien et fuir le mal, c'est par votre secours que nous résistons à l'adversité; c'est par vous que nous savons bien commander et bien obéir ; c'est vous qui nous apprenez à regarder comme étrangères les choses que nous croyions autrefois nous appartenir, et comme nous appartenant celles que nous regardions autrefois comme étrangères; c'est vous qui empêchez en nous l'attachement aux plaisirs et aux attraits des méchants; c'est vous qui ne permettez pas que les vanités du monde nous rapetissent; c'est par vous que ce qu'il y a de plus grand en nous n'est pas soumis à ce qu'il y a d'inférieur; c'est par vous que la mort sera absorbée dans sa victoire (1) ; c'est vous qui nous convertissez, c'est vous qui nous dépouillez de ce qui n'est pas et qui nous revêtez de ce qui est; c'est vous qui nous rendez dignes d'être exaucés; c'est vous qui nous fortifiez; c'est vous qui nous persuadez toute vérité; c'est vous qui nous suggérez toute bonne pensée, qui ne nous ôtez pas le sens et qui ne permettez à personne de nous l'ôter ; c'est vous qui nous rappelez dans la voie; c'est vous qui nous conduisez jusqu'à la porte; c'est vous qui faites ouvrir à ceux qui frappent (2); c'est vous qui nous donnez le pain de vie; c'est par vous que nous désirons de boire à cette fontaine qui doit nous désaltérer à jamais (3); c'est vous qui êtes venu convaincre le monde sur le péché, sur la justice et sur le jugement (4); c'est par vous que ceux quine croient point n'ébranlent point notre foi; c'est par vous que nous improuvons l'erreur de ceux qui pensent que les âmes ne méritent rien auprès de vous; c'est par vous que nous ne sommes point assujétis aux éléments faibles et pauvres (5) ; ô Dieu ! qui nous purifiez et nous préparez aux récompenses éternelles, soyez-moi propice !
4. Ô Dieu ! qui êtes seul tout ce que je viens de dire, venez à mon secours; vous êtes la seule substance éternelle et véritable, où il n'y a ni discordance, ni confusion, ni changement, ni indigence, ni mort, mais souveraine
1 Cor. XV. 54. 2 Matth. VII, 8. 3. Jean, VI, 35. 4. Ib. XVI, 8. 5. Gal. IV, 9.
127
concorde, évidence souveraine, souveraine immutabilité, souveraine plénitude, souveraine vie. Rien ne manque en vous, rien n'y est superflu. En vous celui qui engendre et celui qui est engendré n'est qu'un (1) ; ô Dieu! c'est à vous que sont soumises toutes les créatures capables de soumission; c'est à vous qu'obéit toute âme bonne; d'après vos lois les pôles tournent, les astres poursuivent leur course, le soleil active le jour, la lune repose la nuit, et pendant les jours que forment les vicissitudes de la lumière et de l'obscurité; pendant les mois dus aux accroissements et aux décroissements de la lune; pendant les années que composent ces successions de l'été, de l'automne, du printemps et de l'hiver; pendant ces lustres où le soleil achève sa course; au milieu de ces orbes immenses que décrivent les astres pour revenir sur eux-mêmes, le monde entier observe, autant que la matière insensible en est capable, une constance invariable dans la marche et les révolutions du temps; ô Dieu ! c'est vous qui, par les lois constantes que vous avez établies, éloignez le trouble du mouvement perpétuel des choses muables, et qui, par le frein des siècles qui s'écoulent, rappelez ce mouvement à l'image de la stabilité; vos lois donnent à l'âme le libre arbitre, et selon les règles inviolables que rien ne peut détruire, assignent des récompenses aux bons, des châtiments aux méchants; ô Dieu ! c'est de vous que nous viennent tous les biens, c'est vous qui empêchez tous les maux de nous atteindre; ô Dieu ! rien n'est au-dessus de vous, rien n'est hors de vous, rien n'est sans vous; ô Dieu! tout vous est assujéti, tout est en vous, tout est avec vous; vous avez fait l'homme à votre image et à votre ressemblance, ce que connaît celui qui se connaît : exaucez, exaucez, exaucez-moi, ô mon Dieu, ô mon Seigneur, mon roi, mon père, mon Créateur, mon espérance, mon bien, ma gloire, ma demeure, ma patrie, mon salut, ma lumière, ma vie; exaucez, exaucez, exaucez-moi, à la manière que si peu connaissent. 5. Enfin, je n'aime que vous, je ne veux suivre que vous, je ne cherche que vous, je suis disposé à ne servir que vous; vous seul avez droit de me commander, je désire être à vous. Commandez, je vous conjure, prescrivez tout ce que vous voudrez; mais guérissez et ouvrez mon oreille pour que j'entende votre
1. Rét. livr. 1, ch. IV, n. 3.
voix; guérissez et ouvrez mes yeux, pour que je puisse apercevoir les signes de votre volonté. Eloignez de moi la folie, afin que je vous connaisse. Dites-moi où je dois regarder pour vous voir, et j'ai la confiance d'accomplir fidèlement tout ce que vous m'ordonnerez. Recevez, je vous en supplie, ô Dieu et père très-clément, ce fugitif dans votre empire. Ah ! j'ai souffert assez longtemps; assez longtemps j'ai été l'esclave des ennemis que vous foulez aux pieds; assez longtemps j'ai été le jouet des tromperies; je suis votre serviteur, j'échappe à l'esclavage de ces maîtres odieux : recevez-moi; pour eux je n'étais qu'un étranger, et quand je fuyais loin de vous, ils m'ont bien reçu. Je sens que j'ai besoin de retourner vers vous; je frappe à votre porte, qu'elle me soit ouverte; enseignez-moi comment on parvient jusqu'à vous. Je ne possède rien que ma volonté; je ne sais rien, sinon qu'il faut mépriser ce qui est changeant et passager, pour rechercher ce qui est immuable et éternel. C'est ce que je fais, ô mon Père ! parce que c'est la seule chose que je connaisse; mais j'ignore comment on peut arriver jusqu'à vous. Inspirez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi. Si c'est par la foi que vous trouvent ceux qui vous cherchent, donnez-moi la foi; si c'est parla vertu, donnez-moi la vertu; si c'est par la science, donnez-moi la science. Augmentez en moi la foi, augmentez l'espérance, augmentez la charité.
Oh ! que votre bonté est admirable et singulière !
6. Je vous désire, et c'est à vous que je demande encore les moyens de suivre ce désir. Si vous nous abandonnez, nous périssons; mais vous ne nous abandonnez point, parce que vous êtes le souverain bien, et personne ne vous a jamais cherché avec droiture sans vous trouver. Ceux-là vous ont cherché avec droiture à qui vous avez accordé la grâce de vous chercher avec droiture. Faites, ô Père ! que je vous cherche ; préservez-moi de l'erreur, et qu'en vous cherchant, je ne rencontre que vous. Si je ne désire plus que vous, faites, ô Père ! que je vous trouve enfin. S'il reste en moi quelques désirs d'un bien passager, purifiez-moi et rendez-moi capable de vous voir. Quant à la santé de ce corps mortel, comme je ne sais de quelle utilité elle peut être pour moi ou pour ceux que j'aime, je vous la confie entièrement, ô Père souverainement sage et souverainement bon ! et je vous [428] demanderai pour lui ce que vous m'inspirerez au besoin; seulement, ce que je sollicite de votre souveraine clémence, c'est de me convertir entièrement à vous, c'est de m'empêcher de résister à la grâce qui me porte vers vous: et tandis que j'habite dans ce corps mortel, faites que je sois pur, magnanime, juste, prudent; que j'aime parfaitement et que je reçoive votre sagesse; que je sois digne d'habiter et que j'habite, en effet, dans le royaume éternel, séjour de la suprême félicité. Ainsi soit-il (1).
CHAPITRE II. CE QU'IL FAUT AIMER.
7. Augustin. Je viens de prier Dieu. La Raison. Que veux-tu donc savoir? A. Tout ce que j'ai demandé. L. R. Résume-le en peu de mots. A. Je désire connaître Dieu et l'âme. L. R. Ne désires-tu rien de plus? A. Rien absolument. L. R. Eh bien ! commence à chercher. Mais, auparavant, explique à quel point doit être portée cette connaissance de Dieu que tu désires, pour que tu puisses dire : cela me suffit. A. J'ignore jusqu'à quel degré doit être portée cette connaissance pour que je puisse dire : cela me suffit, et je crois ne connaître rien comme je désire connaître Dieu. L. R. Que faisons-nous donc? Ne crois-tu pas qu'il faut d'abord savoir quelle connaissance de Dieu te suffira pour que tu t'arrêtes dans tes recherches lorsque tu y seras parvenu? A. Je le crois, mais je ne sais quel moyen employer. Qu'ai-je vu jamais de semblable à Dieu, et comment puis-je dire: je veux comprendre Dieu comme j'ai compris cet être? L. R. Tu ne connais pas encore Dieu; et comment sais-tu que tu ne connais rien de semblable à Dieu? A. Si je connaissais quelque être semblable à Dieu, sans doute je l'aimerais; mais je n'aime maintenant que Dieu et l'âme, et je ne connais ni l'un ni l'autre. L. R. Tu n'aimes donc pas tes amis? A. En aimant l'âme comment puis-je ne pas les aimer? L. R. Tu aimes donc aussi jusqu'aux plus vils insectes?
1. On peut rapprocher cette admirable prière, où se montrent avec tant de magnificence l'imagination et la tendresse de saint Augustin, de celle de Fénelon qui termine la première partie de la démonstration de l'existence de Dieu. On trouve dans toutes les deux le même enthousiasme, le même amour. Il y a plus d'abondance dans saint Augustin ; il y a plus de précision et peut-être un tour plus poétique dans Fénelon qui, du reste, ne fait souvent lui-même que reproduire quelques idées de ce grand Docteur.
A. J'ai dit que j'aimais l'âme et non pas les animaux. L. R. Ou tes amis ne sont pas des hommes, ou tu ne les aimes pas; car tout homme est un animal, et tu viens de dire que tu n'aimes pas les animaux. A. Mes amis sont des hommes et je les aime, non en tant qu'animaux, mais en tant qu'hommes, c'est-à-dire parce qu'ils possèdent une âme raisonnable, âme que j'aime même chez les voleurs. Il m'est permis, en effet, d'aimer la raison dans quelque être que ce soit, puisque je hais avec justice celui qui use mal de ce que j'aime. Aussi j'aime d'autant plus mes amis qu'ils font ou qu'ils désirent du moins faire meilleur usage de cette âme raisonnable.
CHAPITRE III. CONNAISSANCE DE DIEU.
8. La Raison. J'admets cela; cependant si quelqu'un te disait : Je te ferai connaître Dieu comme tu connais Alype, ne le remercierais-tu pas et ne répondrais-tu pas: Cela me suffit? Augustin. Je le remercierais, mais je ne dirais pas que cela suffit. L. R. Pourquoi, je te prie? A. Quoique je ne connaisse pas Dieu comme je connais Alype, cependant je ne connais pas parfaitement Alype. L. R. Crains donc qu'il ne soit peu séant de vouloir connaître Dieu complètement, tandis que tu ne connais pas parfaitement Alype. A. L'objection n'est pas fondée. En comparaison des astres, qu'y a-t-il de plus vil que mon souper? Cependant j'ignore ce que je souperai demain et je puis prétendre sans orgueil savoir quelle phase la lune nous offrira demain. L. R. Ainsi donc il te suffirait de connaître Dieu comme tu sais quelle phase la lune nous offrira demain? A. Cela ne me suffit pas, car je ne dois cette connaissance qu'à mes sens, et j'ignore si Dieu ou quelque cause cachée de la nature ne changera pas subitement l'ordre et le cours de la lune. Si cela arrivait, tout ce que j'aurais prévu se trouverait faux. L. R. Crois-tu que cela puisse arriver? A. Je ne le crois pas; mais je cherche à savoir, non à croire. Tout ce que nous savons, nous pouvons dire avec raison que nous le croyons; mais tout ce que nous croyons, nous ne le savons pas. L. R. Tu rejettes donc ici le témoignage des sens? A. Je le rejette entièrement. L. R. Et cet ami que tu as dit ne pas [129] connaître parfaitement, veux-tu le connaître par l'intelligence ou par les sens ? A. Ce que les sens m'ont fait connaître de lui, si l'on peut connaître quelque chose par les sens, n'a rien que de vil, et je ne leur en demande pas davantage; mais cette partie qui m'aime chez lui, ou qui plutôt constitue mon ami lui-même, je désire la connaître par mon intelligence. L. R. Peut-on la connaître autrement? A. D'aucune autre manière. L. R. Cet ami si intime et auquel tu es si attaché, tu ne crains donc pas de dire que tu ne le connais pas? A. Pourquoi ne le dirais-je pas? je regarde comme très juste cette loi de l'amitié, qui nous prescrit de n'aimer notre ami ni plus ni moins que nous-mêmes. Ainsi, comme je m'ignore moi-même, quelle injure puis je faire à mon ami en lui disant qu'il m'est encore inconnu , lorsque surtout, comme je le crois, il ne se connaît pas bien lui-même? L. R. Si ce que tu désires connaître est de nature à n'être aperçu que par l'esprit, tu n'aurais pas dû, lorsque je t'ai reproché ta présomption de vouloir connaître Dieu tandis que tu ne connaissais pas Alype, me donner pour exemple ton repas du soir et la lune, si ces choses, comme tu viens de le dire, rentrent dans le domaine des sens.
CHAPITRE IV. QU'EST-CE QU'UNE CONNAISSANCE CERTAINE ?
9. L. R. Mais laissons cela et maintenant réponds-moi.Si ceque Platon etPlotin ont ditde Dieu est vrai, ne te suffit-il pas de connaître Dieu comme ils le connaissaient? A. En admettant que ce qu'ils ont dit de Dieu soit vrai, ce n'est pas une nécessité de conclure qu'ils le connaissaient. Beaucoup parlent souvent et longuement de ce qu'ils ignorent, et moimême, tout ce que j'ai demandé dans ma prière, j'ai dit que je désirais le connaître; et je ne serais point réduit à le désirer si je le connaissais déjà; s'ensuit-il que je n'aie pas pu même parler de ces choses? J'en ai parlé, non comme comprises par mon intelligence, mais comme recueillies ous côtés par ma mémoire et comme embrassées autant que je l'ai pu par la foi ; mais la science est bien différente. L. R. Réponds-moi, je te prie. Ne sais-tu pas, du moins, ce que c'est qu'une ligne en géométrie? A. Je le sais très-certainement. L. R. Et en faisant cette proposition tu ne crains pas les académiciens ? A. Nullement. Ils ont voulu que le sage ne s'exposât jamais à l'erreur, mais je ne suis lias un sage; ainsi je ne crains pas d'affirmer (lue je sais les choses que j'ai apprises. Si, comme je le désire, je parviens à la sagesse, je ferai ce qu'elle me conseillera. L. R. Je ne rejette rien de ce que tu viens de dire ; mais pour continuer ma recherche, connais-tu ce qu'on appelle une sphère, comme tu connais ce que c'est qu'une ligne? A. Je le connais. L.R. Connais-tu ces deux choses également, ou connais-tu mieux l'une que l'autre? A. Je les connais également , car je ne me trompe pas dans l'idée ni de l'une ni de l'autre. L. R. Et ces idées te viennent-elles des sens ou de l'intelligence? A. Les sens ont été pour moi dans cette recherche comme un navire. Lorsqu'ils m'ont eu conduit au lieu que je voulais atteindre, je les ai quittés. Placé alors comme sur la terre, j'ai commencé à méditer, mais longtemps mes pieds ont chancelé. Aussi me paraît-il possible de naviguer plutôt sur la terre, que de comprendre la géométrie par les sens, quoiqu'ils puissent aider lorsqu'on commence l'étude de cette science. L. R. Tu ne crains donc pas d'appeler science la connaissance que tu peux avoir de ces choses? A. Non, si les stoïciens me le permettent. Au sage seul ils attribuent la science; et, je l'avoue, j'ai de cela les idées qu'ils ne refusent pas même à la folie. Cependant je ne les redoute en rien, et j'ai la science véritable des objets sur lesquels tu m'as interrogé. Mais continue je veux voir le but de tes questions. L. R. Ne te presse pas, nous avons du loisir ; écoute attentivement, pour ne rien accorder mal à propos. Je cherche à te faire trouver le bonheur dans la jouissance des choses qui sont à l'abri du sort, et, comme si c'était là une petite affaire, tu m'ordonnes de précipiter ma marche ? A. Que Dieu fasse comme tu dis. Interroge-moi à ta volonté et reprends-moi sévèrement, si je me permets rien de pareil à l'avenir.
10. L. R. N'est-il pas évident que tu ne peux pas partager une ligne en deux dans sa largeur? A. Cela est évident. L. R. Mais dans sa longueur? A. Il est clair qu'elle peut être coupée à l'infini. L. R. N'est-il pas aussi évident que parmi tous les cercles d'une sphère qui passeront dans une partie plus ou [130] moins éloignée du centre, il n'y en aura pas deux qui soient égaux entre eux? A. Cela est également évident. L. R. Qu'est-ce qu'une ligne et qu'est-ce qu'une sphère? Te paraissent-elles une même chose ou diffèrent-elles entre elles? A. Qui ne voit qu'elles diffèrent beaucoup? L. R. Mais si tu connais également ces deux. choses, et si cependant, comme tu lavoues, elles diffèrent. de beaucoup entre elles, il y a donc une science égale de choses différentes? A. Qui l'a jamais nié? L. R. Toi-même, il n'y a qu'un instant, lorsque je te demandais comment tu voulais connaître Dieu pour pouvoir dire : cette connaissance me suffit; tu m'as répondu que tu ne pouvais pas l'expliquer, parce que tu ne connaissais rien à la manière dont tu désires connaître Dieu ; ne connaissant rien de semblable à lui, que diras-tu donc maintenant? Une ligne et une sphère sont-elles semblables? A. Qui oserait le dire? L. R. Je t'avais demandé, non ce que tu pouvais connaître de semblable à Dieu, mais ce que tu pouvais connaître de la même manière que tu désires le connaître. Or, tu connais une ligne comme tu connais une sphère, quoiqu'une ligne ne soit pas la même chose qu'une sphère. Réponds-moi donc s'il te suffit de connaître Dieu comme tu connais cette figure géométrique, c'est-à-dire de ne pas plus douter de Dieu que tu ne doutes de cette sphère?
CHAPITRE V. UNE MÊME SCIENCE PEUT EMBRASSER DES CHOSES DIFFÉRENTES.
11. A. Permets : quoique tu me presses vivement et même que tu m'aies convaincu, je n'ose cependant dire que je voudrais connaître Dieu comme je connais ces figures géométriques. Car je vois ici des différences, non-seulement dans les choses, mais dans la science même. D'abord une ligne et une sphère ne diffèrent pas tellement entre elles, qu'elles ne soient du ressort d'une même science. Mais aucun géomètre ne s'est vanté de faire connaître Dieu. Ensuite, si là science de Dieu et de ces vérités géométriques était la même, j'éprouverais autant de plaisir, en les connaissant, que j'espère en trouver quand je connaîtrai Dieu; et cependant je méprise tellement cette première science, en comparaison de celle de Dieu, qu'il me semble parfois que si je le comprends et le vois comme il peut l'être, toutes les autres connaissances s'effaceront de ma mémoire. Déjà son amour permet à peine à ces idées de se présenter à mon esprit. L. R. Je conçois que tu éprouves beaucoup, beaucoup plus de plaisir dans la seule connaissance de Dieu que dans celle de ces autres vérités. Cette différence tient à la nature des choses conçues, non à l'intelligence qui conçoit; autrement tu n'aurais pas la même oeil pour voir la terre et l'étendue des cieux, puisque l'un de ces aspects te charme beaucoup plus que l'autre. Supposons que tes yeux ne te trompent pas; si on te demandait : Es-tu aussi certain de voir la terre que le ciel ? tu devrais répondre, je crois, que la certitude est égale, quoique tu n'éprouves pas la même joie à contempler la beauté de la terre que la grandeur et l'éclat du ciel. A. Cette comparaison m'ébranle, je l'avoue, et me détermine à convenir, qu'autant la terre diffère du ciel dans son genre, autant les vérités certaines des mathématiques diffèrent de l'intelligible majesté de Dieu.
CHAPITRE VI. PAR QUELS SENS INTÉRIEURS. L'AME APERÇOIT DIEU.
12. L. R. Tu fais bien dêtre ébranlé, et la raison qui s'entretient avec toi te promet de montrer aussi bien Dieu à ton esprit que le soleil se montre à tes yeux. L'esprit en effet a comme des yeux; ce sont les sens de l'âme; et les vérités certaines des sciences sont comme les objets qui ont besoin d'être éclairés par le soleil pour être vus, tels que la terre et les autres choses terrestres ; mais c'est Dieu lui-même qui éclair l'esprit. Pour moi, qui suis la raison, je suis dans les intelligences ce qu'est la faculté de voir dans les yeux; car avoir des yeux ce n'est pas regarder; et regarder ce n'est pas voir. Ainsi l'âme a besoin de trois choses d'avoir de bons yeux pour pouvoir s'en servir, de regarder et de voir. Or, de bons yeux, c'est l'esprit pur de la contagion des sens, c'est-à-dire guéri et affranchi de la cupidité des choses terrestres. Cet affranchissement, il lie peut se faire d'abord que par la foi. L'âme en effet ne peut voir qu'autant qu'elle est saine. Si donc elle ne croit pas qu'elle puisse voir jamais ce qu'on ne peut, lui montrer pendant qu'elle est encore [131] souillée de vices et malade, elle ne s'applique point à recouvrer la santé. Mais qu'elle croie sur parole qu'il en est ainsi, et qu'elle pourrait connaître Dieu si elle était guérie; qu'arrivera-t-il si elle désespère de sa guérison? Ne s'abat-elle point, ne se néglige-t-elle point complètement, et ne refuse-t-elle pas d'obéir aux prescriptions du médecin? A. C'est bien cela, car ces préceptes ne peuvent que paraître durs à l'âme malade. L. R. Il faut donc ajouter l'espérance à la foi. A. C'est mon avis. L. R. Et si l'âme croit que cette connaissance de Dieu est possible, une fois guérie, si elle espère sa guérison sans cependant aimer, sans désirer la lumière qui lui est promise, et pensant devoir se contenter des ténèbres qui lui sont devenues agréables par l'habitude, ne méprisera-t-elle pas aussi le médecin? A. Cela est incontestable. L. R. La charité est donc aussi nécessaire? A. Rien absolument n'est si nécessaire. L. R. Donc, sans ces trois vertus, aucune âme ne guérit et ne devient capable de voir, c'est-à-dire de connaître Dieu.
13. Et lorsqu'elle aura les yeux guéris, que lui restera-t-il à faire? A. Elle devra regarder. L. R. Le regard de l'âme, c'est la raison; mais comme il ne suffit pas toujours de regarder pour voir, le regard droit et vrai, c'est-à-dire celui qui fait voir, est appelé une vertu; car c'est une vertu que la raison droite et vraie. Or ce regard ne peut appliquer à la lumière les yeux, même guéris, sans ces trois vertus : la foi, pour croire, comme on l'enseigne, qu'on sera heureux en contemplant l'objet sur lequel doit se porter l'esprit ; l'espérance , pour compter voir Dieu, lorsqu'on se sera tourné convenablement vers lui ; la charité, pour désirer de le voir et de le posséder. C'est alors que ce regard parvient à voir Dieu, ce qui est sa fin; non qu'il ne subsiste plus alors, mais parce qu'il n'a plus rien à rechercher ; et c'est en cela que consiste la véritable perfection, ou la raison atteignant à sa fin, et méritant la vie heureuse. Or, cette vue de Dieu est un acte de l'intelligence qui est dans l'âme et suppose deux termes: ce qui conçoit et ce qui est conçu. Ainsi, dans la vue corporelle, il faut également deux termes 1'il qui voit, et l'objet visible; supprimez l'un ou l'autre, on ne peut rien voir.
CHAPITRE VII. JUSQUES A QUAND LA FOI, L'ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ SERONT NÉCESSAIRES.
14. Et lorsque l'âme sera parvenue à voir Dieu, c'est-à-dire à le contempler, examinons si ces trois vertus lui seront encore nécessaires. Comment la foi le serait-elle, puisque l'âme verra? ou l'espérance, puisqu'elle possédera ? Quant à la charité, loin de perdre alors, elle acquerra beaucoup. Car lorsque l'âme verra cette vraie et incomparable beauté, elle l'aimera davantage; et si un violent amour ne axe son regard sur cette beauté et ne l'empêche de s'en détourner, pour quelque objet que ce soit, elle ne pourra persévérer dans cette vision qui fait son suprême bonheur. Mais tant qu'elle est dans le corps, quelque parfaitement qu'elle voie, c'est-à-dire qu'elle conçoive Dieu; parce que les sens remplissent encore leurs propres fonctions, et que, s'ils ne sont pas capables de nous tromper, ils peuvent nous faire hésiter, on peut appeler foi la conviction qui leur résiste et gui, croit l'éternelle vérité. Ainsi encore, bien que dans cette vie l'âme soit déjà heureuse quand, elle a compris Dieu, comme elle reste assujettie à toutes les peines du corps, elle doit espérer qu'après la mort toutes ces souffrances disparaîtront. Ainsi l'espérance n'abandonne pas non plus l'âme tant qu'elle est sur la terre; mais lorsqu'après cette vie elle sera complètement recueillie en Dieu, la charité seule demeurera pour l'y fixer. On ne pourra pas dire qu'elle ait la foi, qu'elle croie ces vérités, puisqu'aucun témoignage trompeur ne cherchera, à l'en éloigner. Elle n'aura non plus rien à espérer, puisqu'elle possédera tous les biens avec sécurité. L'âme a donc besoin de trois choses : d'être purifiée, de regarder, de voir. Quant à ces trois vertus : la foi, l'espérance, la charité, elles sont toujours nécessaires. pour que lâme se purifie et regarde Dieu; elles le sont également pour qu'elle voie Dieu pendant cette vie; mais la charité suffira dans la vie future.
CHAPITRE VIII. CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR CONNAÎTRE DIEU.
15. Maintenant, apprends de moi, autant que le temps actuel le permet, par cette comparaison tirée des choses sensibles, comment tu peux t'élever jusqu'à la connaissance de Dieu. Dieu est intelligible; les axiomes des sciences dont nous venons de parler le sont aussi, et cependant ces deux connaissances diffèrent beaucoup. La terre est visible, ainsi que la lumière; mais la terre ne peut être vue, si elle n'est éclairée par la lumière: ainsi ces axiomes sur lesquels sont fondées les sciences, que chacun, dès qu'il les comprend, admet sans aucune espèce de doute, nous devons croire que nous ne pouvons les comprendre, si nous ne sommes éclairés par les rayons d'une autre lumière. De même donc que dans le soleil on peut distinguer trois choses: qu'il existe, qu'il est visible, qu'il éclaire; ainsi dans ce Dieu caché que tu veux comprendre, on peut discerner également trois choses : qu'il existe, qu'il est intelligible, et qu'il fait connaître les autres choses. Je ne crains pas de t'enseigner à concevoir Dieu et toi-même. Mais réponds-moi; comment as-tu admis ce que je t'ai dit; est-ce comme probable ou comme vrai? A. Seulement comme probable, et je dois avouer que j'ai conçu de plus hautes espérances; car, excepté ce qui regarde la ligne et la sphère, tu ne mas rien dit que j'ose prétendre connaître avec certitude. L. R. Il ne faut pas t'en étonner; rien ne t'a encore été présenté de manière que tu puisses te flatter de l'avoir véritablement compris.
CHAPITRE IX. L'AMOUR DE NOUS-MÊMES.
16. Mais qu'est-ce qui nous arrête? Mettons-nous en marche. Examinons cependant ce qui doit précéder toutes nos recherches, si nous sommes purs. A. A toi de t'en assurer, si tu peux porter quelque temps tes regards ou sur toi ou sur moi. Pour moi je répondrai à tes questions, si je vois quelque chose. L. R. Aimestu autre chose que la connaissance de Dieu et de toi-même? A. Je pourrais répondre, d'après le sentiment intérieur, que je n'aime rien davantage; mais je crois plus sûr de répondre que je l'ignore; car après m'être persuadé qu'aucune autre chose ne pourrait rri émouvoir,il m'est souvent arrivé, néanmoins, qu'une pensée entrait dans mon âme, et l'agitait beaucoup plus que je ne l'avais cru. Souvent aussi, quoique l'idée d'un événement n'ait excité aucun trouble dans mon esprit, cependant, lorsqu'il s'est accompli , il l'a troublé plus que je ne le croyais. Mais il me semble en ce moment qu'il n'y a que trois choses qui puissent m'émouvoir : la crainte de perdre ceux que je chéris, la crainte de la douleur et celle de la mort. L. R. Tu aimes donc la vie que mènent avec toi ceux qui te sont chers, ta santé propre et ta propre vie dans ce corps; autrement tu ne craindrais pas de les perdre? A. La chose est ainsi, je l'avoue. L. R. De ce que tes amis ne sont pas tous avec toi , de ce que ta santé n'est pas assez bonne, ne s'ensuit-il pas que ton âme éprouve quelque chagrin? N'est-ce pas une conséquence de ce que tu viens d'avancer? A. C'est vrai , je ne le puis nier. L. R. Et si tout à coup tu te sentais réellement guéri; si tu voyais tous tes amis intimes jouir avec toi d'un noble loisir, ne te laisserais-tu pas aller à quelques mouvements de joie? A. Oui, à quelques mouvements; comment même pourrais-je me contenir?comment pourrais-je dissimuler une telle joie, si, comme tu le dis, ces heureux événements se produisaient tout à coup? L. R. Tu es donc encore agité par toutes les maladies et les passions de l'âme. Et quelle n'est pas la témérité de ton esprit, de vouloir contempler le soleil des intelligences? A. Tu raisonnes contre moi, comme si je ne sentais pas combien ma santé a fait de progrès, combien de vices se sont éloignés, combien il m'en reste encore à détruire. Fais que j'obtienne une complète victoire.
CHAPITRE X. L'AMOUR DU CORPS ET DES CHOSES EXTÉRIEURES.
17. L. R. Ne vois-tu pas quelquefois les yeux du corps, même en bonne santé, se blesser et s'éloigner de la lumière du soleil afin de se tourner vers l'obscurité? Et toi, tu songes aux progrès que tu as faits, tu ne songes pas à ce que tu veux voir; cependant je discuterai avec toi ces progrès. Ne désires-tu [133] aucunes richesses ? A. Non, et ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai trente-trois ans, et il y en a près de quatorze que j'ai cessé de les désirer; et si quelque hasard me les offrait, je n'y verrais qu'un moyen de fournir à mes besoins et aux besoins d'autrui. Un ouvrage de Cicéron a suffi pour me persuader qu'on ne doit pas les désirer, et que si elles viennent, on doit en user avec beaucoup de sagesse et de prudence. L. R. Et les honneurs? A. J'avoue que je n'ai cessé de les désirer que depuis peu et presque dans ces derniers jours. L. R. Ne désires-tu pas une femme? Parfois ne voudrais-tu pas la voir belle, chaste, réglée, lettrée ou capable d'être facilement instruite par toi-même; et puisque tu méprises les richesses, apportant une dot simplement suffisante pour ne pas troubler ton repos, surtout si tu espères et si tu es certain qu'elle ne te fera jamais éprouver aucune peine? A. Sous quelques traits que tu me la représentes, fût-elle comblée de tous les dons, il n'est rien que je sois aussi résolu d'éviter que le commerce d'une femme. Car il n'est rien, je le sens, qui abatte davantage l'essor de l'esprit que les caresses d'une femme et cette union des corps qui est de l'essence du mariage. C'est pourquoi, si c'est un des devoirs du sage, ce que je n'ai point encore examiné, de chercher à avoir des enfants, celui qui s'unit à une femme dans ce seul but me paraît plus digne d'être admiré que d'être imité ; car il y a plus de danger dans cette tentative que de bonheur à y réussir. Aussi je me suis obligé assez justement et assez utilement, je crois, pour la liberté de mon âme, à ne désirer, à ne rechercher, à ne prendre aucune femme. L. R. Je ne te demande pas en ce moment à quoi tu t'es obligé; mais si tu luttes encore ou si tu as vaincu la cupidité; il est question , en effet, de la santé de tes yeux. A. Je ne recherche plus, je ne désire plus rien de ce genre, je ne m'en souviens même qu'avec horreur et mépris; que veux-tu davantage ? Et cette heureuse disposition d'esprit s'accroît chaque jour; car plus s'augmente l'espérance de voir cette beauté suprême pour laquelle je soupire si vivement, plus toutes mes affections, tous mes plaisirs se concentrent en elle. L. R. Et la délicatesse des mets? t'occupe-t-elle beaucoup? A. Ceux dont j'ai résolu de m'abstenir ne me tentent nullement. Quant à ceux que je ne me suis pas retranchés, j'avoue que je ne puis en user sans quelque plaisir ; mais il est de telle nature qu'après les avoir vus et goûtés, je puis m'en priver sans aucune peine. Lorsqu'ils ne sont pas sous mes yeux, aucun désir ne vient mettre obstacle à mes pensées. Mais ne m'interroge pas d'avantage, soit sur le manger et le boire, soit sur le plaisir du bain, et sur les autres voluptés du corps; je n'en désire que ce qui petit être utile à ma santé.
CHAPITRE XI. LES BIENS EXTÉRIEURS DOIVENT PLUTÔT ÊTRE ACCEPTÉS QUE RECHERCHÉS EN VUE DES BIENS VÉRITABLES.
18. L. R. Tu as déjà fait des progrès considérables; cependant les défauts que tu conserves sont un grand obstacle pour voir cette lumière éternelle. Mais je vais employer un moyen qui tue semble facile pour bien m'assurer s'il ne nous reste plus de cupidité à dompter, ou si nous n'avons fait aucun véritable-progrès, et si la racine des vices que nous croyons détruits ne subsiste pas encore. Réponds à cette question : Si tu étais persuadé de ne pouvoir vivre dans l'étude de la sagesse avec tes amis les plus chers, sans une fortune considérable pour fournir à tous vos besoins, ne désirerais-tu pas, ne souhaiterais-tu pas les richesses? A. J'en conviens. L. R. Et si tu étais persuadé que tu amèneras à la sagesse un grand nombre de personnes, mais à la condition de recevoir des honneurs, une autorité plus considérable; si tu voyais aussi que tes amis ne sont capables de mettre un frein à leur cupidité ni de se convertir entièrement à la recherche de Dieu , qu'autant qu'ils recevraient eux-mêmes des honneurs et qu'ils ne pourraient y parvenir que dans le cas où tu serais élevé en gloire et en dignité : ne devrais-tu pas aspirer et travailler énergiquement à les obtenir? A. La chose serait ainsi que tu le dis. L. R. Je ne te parle plus de femme; car il est possible que peut-être il n'y ait jamais une telle nécessité d'en prendre une. Cependant, si elle devait avoir assez de patrimoine pour fournir, et fournir de grand coeur aux besoins de tous ceux que tu désirerais réunir auprès de toi dans un doux loisir; si de plus elle joignait à cette fortune une naissance assez illustre pour te faire obtenir facilement ces honneurs, que tu as [134] reconnu pouvoir être nécessaires, te serait-il permis de dédaigner tous ces avantages? A. Quand oserais-je former une telle espérance ?
49. L. R. Tu me réponds comme si je cherchais en ce moment ce que tu espères. Je ne cherche pas à connaître quel bien ne te charme pas quand il t'est refusé, mais quel bien pourrait te séduire si on te l'offrait. Autre chose est la cupidité détruite, autre chose est la cupidité endormie. C'est dans ce sens que certains philosophes ont dit que les vicieux étaient tous des insensés, à la manière d'un bourbier dont on ne sent les exhalaisons fétides que lorsqu'on 1e remue. Il est fort différent que la cupidité cède à l'absence de tout espoir ou soit détruite par la pureté du coeur. A. Je ne puis te répondre. Jamais, néanmoins, tu ne me persuaderas que par la disposition d'esprit dans laquelle je suis maintenant je ne doive juger que j'ai fait quelque progrès. L. R. Je crois que la chose te paraît ainsi, parce que tout en croyant pouvoir désirer les biens dont nous venons de parler, tu ne les désirerais pas pour eux-mêmes , mais pour autre chose. A. C'est précisément ce que je voulais dire; car lorsqu'autrefois j'ai désiré les richesses, je les ai désirées précisément pour être riche; et les honneurs, dont je t'ai avoué que le désir a régné jusqu'à présent dans mon âme, je les ai recherchés pour je ne sais quel éclat qui charmait mon imagination, et je n'ai jamais souhaité dans une femme, -lorsque je me suis occupé du mariage, que de pouvoir réunir la volupté à la bonne réputation. J'avais alors pour tous ces biens une véritable passion : maintenant je les méprise tous; et si, pour parvenir à ceux que je désire, il faut passer par ces biens inférieurs, je ne les recherche point pour en jouir, mais je les supporte (1). L. R. Tu as parfaitement raison, car je ne crois pas que l'on puisse appeler cupidité la recherche d'un bien qu'on ne souhaite qu'en vue d'un autre bien.
1. Il y a, dans la manière ingénue avec laquelle saint Augustin avoue ses dispositions présentes par rapport aux différents objets des affections humaines, quelque chose du charme que l'on éprouve à la lecture de ses Confessions. On sent qu'il ne dissimule rien et que sa franchise est égale à sa sagacité. Ce qu'il ajoute sur les dispositions nécessaires pour connaître la vérité, est incontestable, et c'est ce que Pascal a indiqué dans ses Pensées avec cette éloquence mâle et impérieuse qui le caractérise : « J'aurais bientôt quitté ces plaisirs, dites-vous, si j'avais la foi ; et moi je vous dis que vous auriez bientôt la foi si vous aviez quitté ces plaisirs ; or, c'est à vous à commencer. Si je pouvais, je vous donnerais la foi; je ne le puis, ni par conséquent éprouver la vérité de ce que vous dites; mais vous pouvez bien quitter ces plaisirs et éprouver si ce que je vous dis est vrai. » On peut ajouter que dans l'ordre même naturel toute personne vouée aux études philosophiques a pu en faire l'expérience. Que sont pour la plupart des gens du monde ces vérités sublimes qui transportent le véritable philosophe? ou des absurdités, ou des connaissances sans aucune valeur, de pures chimères. Mais guérissez ce mondain de l'amour effréné des plaisirs, apprenez-lui à rentrer en lui-même, à vivre de la véritable vie, c'est-à-dire de la vie intellectuelle et morale, et tout à coup ces vérités qu'il méconnaissait, qu'il osait traiter d'absurdes, reprendront à ses yeux l'évidence qui les accompagne, et sur son coeur l'empire qui leur est naturel.
CHAPITRE XII. IL NE FAUT RIEN DÉSIRER QUE CE QUI CONDUIT AU SOUVERAIN BIEN, RIEN CRAINDRE QUE CE QUI EN ÉLOIGNE.
20. L. R. Mais, je te le demande : pourquoi désires-tu que ceux que tu aimes vivent et vivent avec toi? A. Afin que nous puissions chercher unanimement à connaître Dieu et nos âmes car celui qui est parvenu d'abord à la découverte de la vérité, y conduit les autres sans fatigue. L. R. Et si tes amis ne voulaient pas s'occuper de cette recherche?A. Je les déterminerais à le vouloir. L. R. Mais qu'arriverait-il si tu ne pouvais parvenir à les persuader, ou parce qu'ils croiraient connaître déjà la vérité, ou parce qu'ils penseraient qu'elle est impossible à découvrir, ou parce qu'ils seraient détournés de cette recherche par la cupidité et les soins des choses terrestres? A. Je les supporterais le mieux que je pourrais, et ils feraient de même de leur côté. L. R. Mais si leur présence était pour toi un obstacle et que tu ne pusses le changer; ne travaillerais-tu pas, n'aspirerais-tu pas à t'en séparer, plutôt que de vivre ainsi avec eux? A. J'en conviens, la chose est ainsi que tu le dis. L. R. Tu ne désires donc pour elles-mêmes, ni la vie ni la présence de tes amis, mais afin de parvenir à la sagesse? A. Je l'avoue. L. R. Mais quoi 1 et ta propre vie, si tu étais sûr qu'elle est un obstacle à l'acquisition de la sagesse, désirerais-tu la conserver? A. Je la sacrifierais volontiers. L. R. Mais si tu savais que tu peux parvenir à la sagesse, soit en abandonnant ce corps mortel, soit en y restant uni, est-ce ici ou dans une autre vie que tu chercherais plutôt à jouir du bien que tu aimes? A. Si je savais qu'il ne m'arrivera rien de pire que mon état actuel, rien qui me fit descendre du point auquel je suis parvenu, je ne m'en inquiéterais pas. [135] L. R. Ainsi tu ne redoutes maintenant la mort, que dans la crainte de tomber dans une pire situation ' qui te prive de la connaissance de Dieu? A. Je crains non-seulement d'être privé de cette connaissance, si je suis parvenu à en .obtenir quelqu'une, mais aussi que toute voie me soit fermée pour arriver à ce que j'ambitionne encore; j'espère, toutefois, -conserver ce que je possède déjà. L. R. Si donc tu désires cette vie, ce n'est pas non plus pour elle-même, mais en vue de la sagesse? A. Cela est vrai.
21. L. R. Il reste la douleur du corps qui te trouble peut-être, par sa violence. A. Je ne la redoute si fort, non plus, que parce qu'elle m'empêche de rechercher la vérité. J'étais tourmenté ces jours derniers par un violent mal de dents, et je ne pouvais trouver dans mon esprit que les choses que je savais déjà; j'étais incapable de rien apprendre, ce qui aurait demandé toute mon attention; cependant il me semblait que si la lumière de la vérité se révélait à moi, je ne sentirais plus la douleur, ou que sûrement je la supporterais comme rien. Mais quoique je n'aie jamais éprouvé de souffrances plus aiguës; en réfléchissant toutefois combien elles pourraient être plus vives, je suis forcé d'embrasser l'opinion de Cornélius Celsus (1) qui dit que le souverain bien est la sagesse, et le souverain mal la douleur du corps. La raison qu'il en donne ne me paraît pas mauvaise. Puisque nous sommes composés, dit-il, de deux parties, c'est-à-dire d'une âme et d'un corps, et que la première partie, lâme, est la plus parfaite, le souverain bien doit être la perfection de la première partie; le souverain mal, ce qu'il y a de plus mauvais dans la seconde. Or, la sagesse est ce qu'il y a de plus parfait dans l'âme, comme la
1. Aulus Cornélius Celsus avait embrassé dans ses études le cercle entier des connaissances de son temps. Quintilien, liv. XII, chap. 11, après avoir parlé de Caton le Censeur, de Varron et de Cicéron, qui, à l'exemple de Platon et d'Aristote, écrivirent sur presque toutes les sciences, ajoute que Cornélius Celsus y avait joint l'art militaire, l'agriculture et la médecine. Dans le livre X chap. 1er, il le désigne comme ayant suivi les principes des sceptiques et entame un écrivain au style élégant et soigné. Il est vrai que dans l'endroit où il parle de tous les objets qu'il avait embrassés, il le considère comme un homme d'un génie médiocre, s'il faut réellement lire mediocri vir ingenio et non medicus acri vir ingenio, comme un savant l'a conjecturé avec quelque probabilité. Quoi qu'il en soit, tous les ouvrages de Cornélius Celsus sont perdus, à l'exception de ses huit livres sur la médecine. Quant à la maxime que saint Augustin cite de lui et qui se trouvait probablement dans quelques-uns de ses traités philosophiques, le saint docteur promet de l'examiner plus bas, et cependant il n'en est plus question, ni dans les deux livres des Soliloques, ni même dans le livre de l'Immortalité de l'âme.. Nous croyons qu'un plus mûr examen la lui eût fait modifier. La première partie de cette maxime est sans doute incontestable, mais la seconde est fondée sur une raison qui n'est que spécieuse. Lâme étant plus excellente que le corps, si la sagesse qui fait sa perfection est pour l'homme le souverain bien, l'état de désordre de cette même âme sera aussi pour lhomme le plus grand mal qu'il puisse éprouver. Sans doute les maux du corps dans cette vie peuvent troubler la félicité de l'homme, parce que l'âme humaine dépend du corps, depuis le péché originel, de manière à ne pas pouvoir en arrêter les impressions; mais, indépendamment de ce que, même dès cette vie, cette loi souffre des exceptions, ce mal, quoique très-réel; ne peut se comparer à celui qui résulte de l'état de désordre de lâme ; il n'est pour l'homme qu'un état d'épreuve et peut contribuer à assurer son éternelle félicité.
douleur, ce qu'il y a de pire dans le corps. On peut en conclure, je pense, sans crainte de se tromper, que le souverain bien de l'homme est la sagesse; le souverain mal, la douleur. L. R. C'est ce que nous examinerons plus tard; car la sagesse à laquelle nous nous efforçons de parvenir. nous donnera peut-être d'autres enseignements. Si, au contraire, elle nous montre la vérité de: ce que tu viens de dire, nous adopterons sans hésitation cette proposition sur le souverains bien et le souverain mal.
CHAPITRE XIII. COMMENT ET PAR QUELS DEGRÉS ON PARVIENT A LA SAGESSE.
22. Ce que nous cherchons maintenant, c'est de connaître de quelle manière tu dois aimer la sagesse, que tu désires voir et posséder sans aucun voile et par un chaste embrassement, faveur qu'elle n'accorde qu'à un petit nombre de ses amants les plus dévoués. N'est-il pas vrai que si tu aimais une belle femme, c'est avec justice qu'elle rejetterait ton amour, si elle percevait que tu en aimes une autre qu'elle? Peux-tu donc te flatter que la chaste beauté de la sagesse , se montre à ton -regard, si elle n'est le Seul objet de ton amour? A. Malheureux que je suis! Pourquoi faut-il être encore privé de l'objet de mes recherches et éprouver le cruel tourment de désirer sans jouir? Déjà je l'ai montré, je n'aime que la sagesse, puisqu'on n'aime point toutes les choses qu'on n'aime pas pour elles-mêmes. C'est la seule sagesse que j'aime pour elle : tous les autres biens, la vie, le repos, les amis, je ne les désiré ou je ne crains de les perdre qu'à cause d'elle (1).
1. C'est ici un des principes les plus importants de la morale, un de ceux sur lesquels saint Augustin a le plus insisté dans ses différents ouvrages. Dieu, la vérité et la vertu qu'il n'en faut pas séparer, doivent seuls être recherchés pour eux-mêmes; tous les autres biens ne peuvent être désirés que comme des moyens d'arriver au bien par excellence. Il en est de même du mal : on ne doit en craindre qu'un seul, le péché, la séparation de Dieu. Tous les autres maux naturels ne doivent être évités que comme portant obstacle à notre union avec Dieu, à la contemplation de la vérité et de la beauté souveraine : ces principes constituent le véritable stoïcisme chrétien, qui diffère essentiellement de celui du paganisme, en ce que la force que celui-ci voulait trouver dans l'homme, le stoïcisme chrétien nets cherche qu'en Dieu. Sénèque, dans quelques endroits de ses ouvrages, veut faire son Sage si excellent, qu'il devient un véritable rival de la divinité ; c'est là le délire de l'orgueil. Le sage chrétien, au contraire, sait que la vertu vient de Dieu. et qu'il ne peut se perfectionner que par l'union la plus intime avec la divinité. C'est ce que saint Augustin lui-même a exprimé avec tant d'énergie dans le sermon 121, ont ces paroles de saint Jean lEvangéliste : Le monde a été fait par lui, en disant : Amando Deum dii efficemur; en aimant Dieu, nous devenons des dieux.
136
Quelle mesure peut avoir en moi cet amour de l'éternelle beauté? Non-seulement je ne l'envie pas aux autres, mais je désire qu'un grand nombre le recherchent avec moi, y aspirent avec moi, le possèdent avec moi , en jouissent avec moi: amis d'autant plus intimes que cette sagesse se donnera davantage à chacun de nous.
23. L. R. Tels doivent être les amants de la sagesse; tels sont ceux que recherche cette amie vraiment pure dont l'union est sans tache. Mais il n'est pas qu'une seule voie pour conduire à elle 1. Chacun, suivant sa pureté et sa force, embrasse plus ou moins complètement ce bien souverain et parfait. Elle est comme une lumière ineffable et incompréhensible qui éclaire notre intelligence; apprenons de la lumière sensible comment cette union s'opère. Il y a des yeux si sains et si forts que, tout en s'ouvrant, ils se tournent sans aucune hésitation vers le soleil; la lumière fait, pour ainsi dire, leur santé; ils n'ont pas besoin de maître, un simple avertissement peut leur suffire. A ceux-là il suffit de croire, d'espérer et d'aimer. Mais d'autres sont éblouis de l'éclat de cette beauté qu'ils désirent si vivement de voir, et n'ayant pu le soutenir, ils retombent souvent avec plaisir dans les ténèbres. Quoiqu'on puisse regarder comme sains les yeux de ces derniers, il est dangereux de vouloir leur montrer ce dont ils ne peuvent soutenir encore la vue; il faut donc les exercer auparavant et nourrir sans le satisfaire leur amour pour la lumière. Il faut d'abord leur montrer les choses qui ne brillent point par elles-mêmes et qui ne peuvent être vues que par une lumière étrangère , tels que des vêtements, un mur, ou d'autres objets semblables; ensuite ce qui réfléchit avec plus de vivacité cette lumière étrangère, comme l'or, l'argent ou d'autres objets pareils dont l'éclat cependant ne peut blesser les yeux; alors peut-être on leur fera doucement apercevoir .les feux terrestres et les astres, la lune, l'éclat
1. Réf. livr. I, chap. IV, n. a.
de l'aurore et la clarté du jour naissant. Par ce moyen, chacun, suivant sa santé, pourra, plus tôt ou plus tard , en suivant tous ces degrés, ou en en négligeant quelques-uns, parvenir à voir le soleil sans hésitation et avec un grand plaisir. C'est un semblable procédé que suivent les maîtres habiles à l'égard de ceux qui chérissent la sagesse et dont les yeux, déjà ouverts, n'ont pas encore assez de force pour la contempler.
L'emploi d'une bonne méthode , c'est de nous y faire parvenir avec ordre ; y arriver sans ordre serait le fruit d'un bonheur à peine croyable. Mais nous avons assez écrit aujourd'hui, je pense. Il faut ménager la santé.
CHAPITRE XIV. C'EST LA SAGESSE ELLE-MÊME QUI GUÉRIT LES YEUX POUR LES RENDRE CAPABLES DE VOIR.
24. A. Et un autre jour : Je t'en prie, fais-moi connaître cet ordre si tu le peux, mène, conduis-moi où tu veux, par le chemin que tu voudras, de la manière que tu voudras; commande-moi les choses les plus dures, les plus ardues, pourvu qu'elles soient en ma puissance et que je ne puisse douter qu'elles ne me conduisent où je désire d'arriver. L. R. Je n'ai qu'une seule chose à te commander, je n'en connais point d'autre : c'est de fuir entièrement toutes les choses sensibles et d'avoir grand soin, tant que nous sommes dans ce corps mortel, que les ailes de ton esprit ne soient point arrêtées par la glu de ce monde, car nous avons besoin de toute leur force et de toute leur activité pour nous envoler des ténèbres jusques à la pure lumière; cette lumière ne daigne se montrer à ceux qui sont encore enfermés dans la prison du corps, qu'autant qu'ils sont capables de voler dans les airs, quand cette prison se brise ou se dissout. Ainsi, lorsque tu seras dans une telle disposition, que rien de terrestre ne te plaise, crois-moi, au même moment, au même instant, tu verras ce que tu désires. A. Quand cela arrivera-t-il? Je te le demande, car je ne pense pas pouvoir mépriser souverainement toutes les choses terrestres, avant d'avoir vu cette beauté éternelle devant laquelle tout s'avilit.
L. R. L'oeil du corps pourrait dire également : Je n'aimerai plus les ténèbres lorsque [137] j'aurai vu le soleil. Ceci semble d'abord être dans l'ordre, et néanmoins, il en est bien autrement. Si l'il aime les ténèbres, c'est qu'il n'est pas sain, il ne peut voir le soleil avant d'être guéri. Ainsi l'âme se trompe souvent en se flattant et en se vantant d'avoir la santé ; et parce qu'elle ne voit pas encore, elle croit avoir le droit de se plaindre. Mais la suprême beauté sait quand elle doit se montrer; elle remplit l'office de médecin , et connaît ceux qui sont sains, plus qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Pour nous, nous croyons savoir à quelle hauteur nous nous sommes élevés du fond de l'abîme ; mais nous ne pouvons ni penser, ni sentir où nous étions plongés, combien nous étions descendus, et nous nous regardons comme sains parce que nous sommes un peu moins malades. Ne vois-tu pas avec quelle sorte de sécurité nous affirmions hier que nous n'étions plus esclaves d'aucune passion, que nous n'aimions que la sagesse et que nous ne cherchions ni ne voulions d'autres biens que pour elle ? Combien te paraissaient honteux, méprisables, horribles et exécrables les plaisirs de l'amour quand nous parlions du désir d'une épouse? Mais cette nuit, lorsque nous veillions ensemble , lorsque nous nous entretenions des mêmes idées, tu as senti bien autrement que tu ne l'avais présumé, combien l'image de ces plaisirs, de ces cruelles voluptés a agi sur toi. L'impression a été beaucoup, beaucoup moins vive qu'elle n'a coutume de lêtre ; elle était cependant bien différente de ce que tu avais cru : ainsi le médecin intérieur t'a fait voir et de quel mal tu étais guéri par ses soins et combien il te restait encore à guérir.
26. A. Tais-toi, je te prie, tais-toi; pourquoi me tourmenter? Pourquoi descendre et pénétrer si avant dans mon âme ? Je ne cesse de pleurer, je ne puis plus rien promettre, je n'ose plus me flatter de rien; ne m'interroge point là-dessus. Tu dis avec raison que celui que je désire voir connaît seul si je suis pur. Qu'il fasse ce qu'il lui plaît; qu'il se montre à moi quand il le voudra, je me confie tout entier à ses soins et à sa clémence. J'ai fini par croire qu'il ne cesse de secourir ceux qui sont ainsi disposés envers lui. Je ne dirai rien sur la santé de mon âme que je n'aie aperçu cette éternelle beauté. L. R. C'est ainsi que tu dois agir; mais sèche tes larmes et fortifie ton coeur. Tu as beaucoup pleuré, et cette maladie de poitrine n'a fait que s'aggraver. A. Tu veux que je mette un terme à mes larmes, tandis que je ne vois point de terme à ma misère ? Tu m'ordonnes d'avoir égard à la santé de mon corps, tandis que je suis infecté de la contagion du vice? Mais, je t'en prie, si tu as quelque pouvoir sur moi, essaye de me conduire par quelque sentier plus court, afin que dans le voisinage de cette lumière, dont je puis, si j'ai fait quelque progrès , supporter l'éclat au moins à une certaine distance, mes yeux n'aient plus que de la répugnance pour les ténèbres que j'ai quittées; et toutefois, puis-je dire avoir quitté des ténèbres qui osent encore flatter mon aveuglement?
CHAPITRE XV. COMMENT ON CONNAIT LÂME. CONFIANCE EN DIEU.
27. L. R. Terminons, 5'il te plaît, ce premier livre, et nous essayerons dans le second de suivre le chemin qui nous paraîtra convenable. Ton indisposition exige un exercice modéré. A. Je ne te permettrai pas de terminer ce livre si tu ne me fais connaître quelque chose de ce voisinage de la lumière, afin que je m'en occupe avec attention. L. R. Le médecin intérieur t'en fournit le moyen, car je ne sais quel éclat m'invite et m'entraîne. Ainsi écoute avec attention. A. Conduis-moi, je te prie , entraîne-moi où tu voudras L. R. Ne dis-tu pas que tu veux connaître avec certitude l'âme et Dieu? A. C'est là toute mon affaire. L. R. Ne cherches-tu rien autre ? A. Rien autre. L. R. Quoi ! ne veux-tu pas comprendre la vérité ? A. Comme si je pouvais connaître Dieu et l'âme sinon par la vérité? L. R. Tu dois donc connaître d'abord ce qui te sert à connaître tout le reste. A. Je n'en disconviens pas. L. R. Ainsi examinons premièrement si les mots vérité et vrai te semblent exprimer deux choses ou seulement une seule: A. Il me semble que ce sont deux choses. Autre est la chasteté, et autre est d'être chaste: ainsi du reste. Je crois de même qu'autre chose est la vérité, autre chose est ce qui est appelé vrai. L. R. Laquelle (le ces deux choses regardes-tu comme supérieure? A. Je pense que c'est la vérité : ce n'est pas ce qui est chaste qui fait la chasteté ; c'est par la chasteté qu'on est chaste : de même ce qui est vrai l'est par la vérité.
137
28. L. R. Et lorsqu'un homme chaste Nient à mourir, -penses-tu que la chasteté meure avec lui? A. Nullement. L. R. La vérité ne périt donc pas non plus lorsque périt ce qui est vrai? A. Comment peut périr quelque chose de vrai ? je ne le conçois pas. L. R. Je m'étonne que tu me fasses cette question. Ne voyons-nous pas une foule de choses périr devant nos yeux? Car tu ne penses pas, sans doute, que cet arbre est un arbre sans qu'il soit véritablement un arbre, ou qu'il ne peut périr. Quand même tu ne croirais pas au témoignage des sens et quand tu pourrais répondre que tu ignores entièrement si c'est un arbre; cependant tu ne nieras pas, je présume, que, si cet arbre existe, c'est un arbre véritable. Car ce jugement vient de l'intelligence et non des sens. En effet, si c'est un faux arbre, il n'est pas un arbre; et s'il est un arbre, il est nécessairement un arbre véritable. A. Je t'accorde cela. L. R. Ne m'accorderas-tu pas aussi qu'il est de la nature de cet arbre de naître et de mourir? A. Je ne puis le nier. L. R. Tu dois en conclure que quelque chose de vrai peut périr. A. Je n'en disconviens pas. L. R. Mais réponds-moi de nouveau. Ne te paraît-il pas que la vérité ne périt point quand périssent des choses vraies, comme la chasteté ne meurt point par la mort d'un homme chaste? A. Je te (accorde aussi et j'attends avec impatience ce que tu cherches à établir. L. R. Sois doncattentif. A. Je le suis-.
29. L. R: Ne crois-tu pas vraie cette proposition : tout ce qui existe doit être quelque part? A. Rien ne me paraît aussi nécessaire à admettre. L. R. Et tu avoues-que la vérité existe? A. Je l'avoue.-L: R. Nous devons donc chercher où elle est. Elle n'est point dans l'espace, à moins d'estimer qu'il y ait dans l'espace autre chose que des corps ou que la vérité soit un corps. A. Je ne crois ni l'un ni l'autre. L. R. Où donc crois-tu la vérité? En admettant son existence nous ne pouvons admettre qu'elle ne soit nulle part. A. Si je savais où elle est,. je ne chercherais peut-être plus rien. L. R. Peux-tu au moins connaître où elle n'est pas? A. Si tu me le rappelles, peut-être le pourrai-je. L. R. La vérité n'est pas certainement dans les,choses mortelles; en effet, ce qui est dans quelque sujet ne peut subsister si le sujet ne subsiste. Or la vérité subsiste lors même que périssent les choses vraies; nous l'avons admis. Donc la vérité n'est pas dans les choses mortelles. Cependant la vérité existe et elle n'est pas nulle part. Il y a donc des choses immortelles. Mais il n'y a rien de vrai si la vérité ne s'y trouve. Il s'ensuit donc qu'il n'y a de vrai que ce qui est immortel. Et tout faux arbre n'est pas un arbre; un faux bois n'est pas du bois; l'argent faux n'est pas de l'argent; enfin tout ce qui est faux n'est pas. Or tout ce qui n'est pas vrai est faux. Rien n'est donc véritablement que ce qui est immortel. Réfléchis en toi-même et avec soin sur ce petit argument, afin de voir s'il ne renferme pas quelque principe que tu puisses contester. Car si ce raisonnement te paraît juste, nous avons presque achevé notre travail; ce qui paraîtra peut-être mieux dans le livre suivant.
30. A. Je te remercie, et puisque nous sommes dans le silence, j'examinerai attentivement avec moi, et par conséquent avec toi, ce nouveau raisonnement; pourvu qu'aucun nuage ténébreux ne s'y oppose et ne vienne encore me charmer, ce que je redoute extrêmement. L. R. Ne cesse pas d'avoir confiance en Dieu et abandonne-toi à lui aussi entièrement que tu le pourras. Ne désire point d'être à toi ni indépendant; mais reconnais-toi plutôt l'esclave du Maître le plus clément et le plus généreux. Il ne cessera pas alors de t'attirer vers lui et ne permettra pas qu'il arrive rien qui ne te soit utile, même à ton insu. A. J'écoute, je crois,et, autant que je le puis, j'obéis, je prie beaucoup pour obtenir beaucoup de forces. Désires-tu davantage ? L. R. C'est bien pour le moment, tu feras ensuite tout ce que la vue de Dieu te prescrira.
LIVRE DEUXIÈME.
Saint Augustin, dans ce second livre, traite longtemps avec lui-même de la vérité et de la fausseté. Après avoir établi l'éternelle durée de la vérité, il conclut que l'âme de l'homme, qui en est le siège, est immortelle.
CHAPITRE PREMIER. DE L'IMMORTALITÉ DE L'HOMME.
1. A. Notre ouvrage a été interrompu assez longtemps; l'amour est impatient et ne cesse de répandre des larmes jusqu'à ce qu'il possède ce qu'il aime : ainsi commençons le livre second. L. R. Commençons. A. Croyons que Dieu nous soutiendra. L. R. Croyons-le sans aucun doute, si cette croyance est en notre pouvoir. A. C'est Dieu lui-même qui est notre pouvoir. L. R. Prie-le donc aussi brièvement et aussi parfaitement que tu le pourras. A. O Dieu qui êtes toujours le même 1 faites que je me connaisse, faites que je vous connaisse. Telle est ma prière. L. R. Toi qui veux te connaître, sais-tu que tu existes? A. Je le sais. L. R. D'où le sais-tu ? A. Je l'ignore. L. R. Sens-tu que tu es un être simple ou composé? A. Je l'ignore. L. R. Sais-tu que tu es en mouvement? A. Je l'ignore. L. R. Sais-tu que tu penses? A. Je le sais. L. R. Il est donc vrai que tu penses? A. Cela est vrai. L. R. Sais-tu que tu es immortel? A. Je l'ignore. L. R. De toutes les choses que tu avoues ignorer, quelle est celle que tu désires savoir la première? A. Ce serait d'apprendre si je suis immortel. L. R. Tu aimes donc à vivre? A. Je l'avoue. L. R. Et quand tu auras appris que tu es immortel, cela te suffira-t-il? A. Ce sera beaucoup en soi, mais ce sera peu pour moi. L. R. Ce peu, néanmoins, ne te fera-t-il pas grand plaisir? A. Très-grand plaisir. L. R. Ne verseras-tu plus de larmes? A. Plus du tout. L. R. Mais quoi ! S'il est prouvé que dans cette vie immortelle tu ne pourras connaître que ce que tu connais maintenant, pourrais-tu comprimer tes pleurs? A. Au contraire, je pleurerai alors pour obtenir de ne plus exister (1). L. R. Tu ne chéris donc pas l'existence pour l'existence même, mais pour la science? A. J'accorde cette conséquence. L. R. Et si cette connaissance devait te rendre malheureux? A. Je ne pense pas que la chose soit possible d'aucune manière. Mais si la connaissance rend malheureux, personne ne peut être heureux; car je ne suis malheureux aujourd'hui que par l'ignorance; et si la science rend aussi malheureux, c'est une éternelle misère. L. R. Je vois maintenant tout ce que tu désires; si tu penses que personne ne peut être malheureux par la science, tu en conclus qu'il est probable que le savoir doit rendre heureux. Or personne ne peut être heureux s'il n'est vivant; personne n'est vivant s'il n'est. Tu désires donc exister, vivre et savoir : exister pour vivre, vivre pour savoir . Tu sais donc aussi que tu existes, tu sais que tu vis, tu sais que tu comprends. Mais tout cela durera-t-il toujours ou rien ne survivra-t-il? Une partie subsistera-t-elle à jamais, tandis que l'autre périra? Et si tout doit exister éternellement, tout pourra-t-il diminuer ou s'accroître? Voilà ce que tu veux savoir. A. Cela est vrai. L. R. Si donc nous;prouvons que nous vivrons toujours, il s'ensuit que nous existerons toujours. A. C'est évident. L. R. Il ne restera plus qu'à connaître si l'intelligence doit. toujours subsister.
1. Rousseau a dit dans Emile : « Si l'on nous offrait l'immortalité sur la terre, qui est-ce qui voudrait de ce triste présent ? »
140
CHAPITRE II. LA VÉRITÉ EST ÉTERNELLE.
2. A. J'aperçois cette marche aussi manifeste que rapide. L. R. Sois donc attentif, afin de :pouvoir répondre à mes interrogations avec exactitude et fermeté. A. Me voici. L. R. Si ce monde doit toujours durer, n'est-il pas vrai que le monde durera toujours? A. Qui peut en douter? L. R. Et s'il ne doit pas toujours durer, n'est-il pas également vrai qu'il ne durera pas toujours ? A. Je l'accorde. L. R. Et s'il doit périr, ne sera-t-il pas vrai, après sa ruine, que le monde a péri? Car il continue à exister tant qu'il n'est pas vrai qu'il ait cessé d'exister. Il répugne donc qu'il ait fini, et qu'il ne soit pas vrai qu'il ait fini ? A. Je l'accorde aussi. L. R. Ensuite, te semble-t-il possible qu'il existe quelque chose de vrai si la vérité n'existe pas? - A. Je ne le crois pas possible. L. R. Ainsi la vérité subsistera lors même que le monde viendrait à périr ? A. Je ne puis le nier. L. R. Et si la vérité même venait à cesser d'être, ne serait-il pas vrai que la vérité a cessé d'être ? A. Qui peut le nier ? L. R. Mais rien ne saurait être vrai si la vérité n'existe. A. Je viens de l'accorder. L. R. La vérité ne pourra donc jamais cesser d'être? A. Continue comme tu as commencé, car il n'y a rien de plus vrai que cette conséquence.
CHAPITRE III. SI LA FAUSSETÉ DOIT TOUJOURS DURER, ET SI ELLE NE PEUT EXISTER SANS ÊTRE PERÇUE, IL S'ENSUIT QU'IL EXISTERA TOUJOURS UNE AME QUELCONQUE POUR LA PERCEVOIR.
3. L. R. Je te prie maintenant de répondre à cette question : Crois-tu que c'est l'âme qui sent ou le corps? A. Je crois que c'est l'âme. L. R. Est-ce que l'intelligence te semble appartenir à l'âme ? A. Cela me paraît ainsi. L. R. A l'âme seule ou à quelqu'autre substance? A. Dieu excepté, l'âme seule me paraît intelligente. L. R. Examinons maintenant la question suivante : Si quelqu'un te disait que ce mur n'est pas un mur, mais un arbre, qu'en penserais-tu? A. Je croirais que ses sens ou les miens se trompent, ou bien qu'il appelle arbre ce que j'appelle un mur. L. R. Et si ce mur lui apparaît sous limage d'un arbre et à toi sous l'image d'un mur, ces deux apparences ne pourront-elles pas être vraies? A. Nullement, car une seule et même chose ne saurait être à la fois un arbre et un mur; et quoique la même chose paraisse différente à tous les deux, il est néces. s aire qu'un de nous soit trompé par une fausse apparence. L. R. Mais si ce n'était ni un mur, ni un arbre, et que vous fussiez tous les deux dans l'erreur? A. La chose est possible. L. R. C'est un cas que tu avais oublié plus haut. A. Je l'avoue. L. R. Mais si vous reconnaissez l'un et l'autre que la chose est différente de ce qu'elle vous paraît, serez-vous encore dans l'erreur? A. Non. L. R. Une apparence peut donc être fausse, et celui qui voit cette apparence, ne pas se tromper? A. C'est possible. L. R. Il faut donc reconnaître que se tromper ce n'est pas voir de fausses apparences, mais y donner son assentiment? A. C'est une chose évidente. L. R. Mais le faux, pourquoi est-il faux? A. Parce qu'il est différent de ce qu'il paraît. L. R. Si donc il n'est pas d'être à qui le faux se montre, il n'existera rien de faux? A. C'est une conséquence rigoureuse. L. R. Il n'y a donc pas de fausseté dans les choses, mais dans les sens; or celui-là ne se trompe pas qui ne donne pas son assentiment à de fausses apparences : ce qui prouve qu'autre chose sont les sens et qu'autre chose nous sommes nous-mêmes; car lorsque les premiers se trompent , nous pouvons résister à l'erreur. A. Je n'ai rien à opposer à ce que tu dis. L. R. Mais lorsque l'âme se trompe, oseras-tu avancer que tu n'es pas trompé? A. Comment l'oserai-je? L. R. Or sans l'âme il n'y a point de sens, et sans les sens point de fausseté. L'âme est donc cause ou complice de l'erreur? A. Ce qui précède me force d'admettre cette conséquence-là.
4. L. R. Réponds-moi maintenant à ceci Te paraît-il possible qu'il n'existe point de fausseté? A. Comment la chose me paraîtrait-elle possible, lorsque nous éprouvons une si grande difficulté à trouver la vérité? Il serait plus absurde de dire qu'il n'existe point de fausseté que de nier toute vérité. L. R. Crois-tu que celui qui ne vit pas puisse sentir? A. La chose est impossible. L. R. Il en ressort que l'âme vivra toujours. A. Tu me [141] conduis trop rapidement vers ces grands horizons ; allons pas à pas, je te prie. L. R. Si tout ce que tu m'as accordé est exact, je crois que tu ne dois pas douter de cette conséquence. A. Elle est trop, précipitée, te dis-je, et je suis plus porté à croire que je t'ai accordé trop légèrement quelque chose, que de me regarder comme certain de l'immortalité de l'âme. Cependant développe cette conclusion et montre-moi comment elle résulte de ce que je t'ai accordé. L. R. Tu as reconnu qu'il ne pouvait point y avoir de fausseté sans les sens, et que la fausseté ne pouvait point ne pas exister; les sens existent donc toujours. Mais il n'y a point de sens sans l'âme; l'âme est donc immortelle. Elle ne peut sentir sans vivre ; elle vivra donc toujours.
CHAPITRE IV. PEUT-ON CONCLURE L'IMMORTALITÉ DE LAME DE LA DURÉE DU VRAI ET DU FAUX?
5. A. O épée de plomb ! Tu pourrais conclure que l'homme est 'immortel, si je t'avais accordé que le monde ne peut pas exister sans homme et que le inonde est éternel. L. R. Tu es bien sur tes gardes : ce n'est pas toutefois peu de chose d'avoir établi que la nature ne peut pas exister sans une âme, à moins de supposer qu'il n'y aura point de fausseté dans la nature. A. Je reconnais la justesse de cette conséquence, mais je crois qu'il faut examiner plus attentivement si les principes que je t'ai accordés plus haut ne sont pas incertains ; car je vois que nous avons fait un grand pas vers l'immortalité de l'âme. L. R. As-tu suffisamment considéré si tu n'as rien accordé légèrement? A. Je le crois, mais je ne vois pas comment m'accuser de témérité. L. R. Il est donc démontré que la nature ne peut exister sans une âme vivante? A. Oui, mais dans ce sens seulement que des âmes peuvent naître et d'autres mourir. L. R. Mais si la fausseté n'existe plus dans la nature, ne s'ensuivra-t-il pas que tout sera vrai? A. Je reconnais cette conséquence. L. R. Dis-moi comment tu sais que ce mur est un mur véritable? A. Parce que l'image qu'il produit en moi ne me trompe pas. L. R. C'est-à-dire parce qu'il est tel qu'il te paraît. A.Oui. L. R. Si donc une chose est fausse parce qu'elle est différente de ce qu'elle paraît, et vraie parce qu'elle est comme elle paraît; en faisant abstraction de celui qui la voit, il n'y aura plus ni vérité ni fausseté. Niais s'il n'y a point de fausseté dans la nature, tout est vrai. Et comme rien ne peut paraître vrai ou faux qu'aux yeux d'une âme vivante; que le faux puisse ou ne puisse pas disparaître, l'âme subsiste également au milieu de la nature. A. Je vois que tu viens de donner une nouvelle force à la conséquence déjà tirée; mais nous n'y avons rien gagné. Car mon esprit n'est pas moins frappé de ce fait, que les âmes naissent et meurent, et que pour ne pas disparaître du monde, il n'est pas nécessaire qu'elles soient immortelles; il suffit qu'elles se succèdent.
6. L. R. Crois-tu que les choses corporelles, c'est-à-dire sensibles, puissent être comprises par l'intelligence? A. Je ne le crois pas. L. R. Que répondras-tu à cette question Dieu se sert-il des sens pour connaître quelque chose? A. Je n'ose rien affirmer témérairement sur ce sujet ; mais autant qu'il m'est permis de le conjecturer, Dieu ne se sert aucunement des sens. L. R. Nous pouvons donc conclure que l'âme seule peut sentir. A. Tire provisoirement cette conclusion, autant que la probabilité le permet. L. R. Réponds encore. Accordes-tu que ce mur, s'il n'est pas un vrai mur, ne soit pas un mur? A. Il n'y a point de proposition que je sois plus porté à reconnaître que celle-là. L. R. Et que s'il n'existe point un vrai corps, il n'existe point de corps du tout? A. Cela est encore évident. L. R. Ainsi donc, il n'y a de vrai que ce qui est tel qu'il paraît; rien de corporel ne peut être aperçu que par les sens; l'âme seule peut sentir; il n'y a point de corps s'il n'existe un vrai corps ; il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de corps s'il n'existe une âme. A. Tu me presses trop vivement et je n'ai rien à t'opposer.
CHAPITRE V. QU'EST-CE QUE LE VRAI ?
7. L. R. Examine cela avec plus d'attention. A. Je suis prêt. L. R. Voici certainement une pierre; c'est une pierre véritable si elle est telle qu'elle paraît; ce n'est pas une pierre si elle n'est pas véritable, et elle ne peut être aperçue que par les sens. A. J'en conviens. L. R. Il n'y a donc pas de [141] pierre dans les profondeurs de la terre, ni en général là où personne ne peut les apercevoir. Cette pierre n'existerait pas si nous ne l'apercevions pas; elle n'existera plus lorsque nous aurons quitté ces lieux et que nul autre ne l'apercevra; et, si l'on ferme exactement une bourse, quoiqu'elle contienne beaucoup, il n'y restera rien. Ce bois même n'est pas intérieurement du bois. En effet, tout ce qui est contenu dans l'intérieur de ce corps opaque échappe aux sens et par cela même n'existe pas; car s'il existait, il serait vrai; or, il ne peut rien y avoir de vrai que ce qui est tel qu'il le paraît; mais cet objet n'est pas aperçu, il n'est donc pas vrai. As-tu quelque chose à répondre? A. Je vois que tes conséquences naissent des principes que je t'ai accordés; mais elles sont tellement absurdes que je rejetterais plutôt un de ces principes à ton choix, que d'admettre qu'elles soient vraies. L. R. Je ne m'y oppose pas. Examine donc ce que tu veux dire. Veux-tu t'empêcher de reconnaître que les corps ne sont aperçus que par les sens , que l'âme seule sent , et qu'une pierre ou toute autre chose ne peut exister si elle n'est vraie ; ou bien veux-tu changer la définition du vrai? A. Examinons d'abord cette dernière question, je te prie.
8. L. R. Définis donc le vrai. A. Le vrai est ce qui paraît tel, qu'il est, à qui veut et peut le connaître. L. R. Ce que personne ne peut connaître ne sera donc pas vrai? Ensuite, si le faux est différent de ce qu'il paraît, et si cette pierre paraît une pierre à l'un et à l'autre du bois, la même chose sera donc à la fois vraie et fausse? A. Ce qui m'embarrasse le plus dans tes objections, c'est d'expliquer comment, si une chose ne peut être connue, il s'ensuit qu'elle ne soit pas vraie. Car, qu'une même chose soit à la fois vraie et fausse, c'est ce qui ne m'inquiète pas beaucoup. En effet, je vois que, comparée à la fois à différents objets, elle est en même temps plus grande et plus petite. Mais cela provient de ce que, en soi, rien n'est grand ou petit. Ces mots sont des termes de comparaison. L. R. Et si tu accordes que rien n'est vrai en soi, ne crains-tu pas qu'on ne puisse conclure que rien n'existe en soi ? Ce qui fait que ce bois est bois, le constitue en même temps bois véritable; et il est impossible qu'il existe en lui-même, c'est-à-dire sans que personne le connaisse, et qu'il ne soit pas bois véritable. A. Ainsi je dis, je définis et je ne crains pas que ma définition soit blâmée comme trop courte : Le vrai, à ce qu'il me semble, c'est ce qui est. L. R. II n'y aura donc rien de faux, car tout ce qui est vrai (1). A. Tu me jettes dans un grand embarras, et je ne vois pas ce que je puis te répondre. Ce qui fait que tout en voulant n'être instruit que par tes interrogations, déjà, cependant, je crains d'être interrogé.
CHAPITRE VI. DOÙ VIENT LA FAUSSETÉ ET OU RÉSIDE-T-ELLE?
9. L. R. Dieu, à qui nous nous sommes confiés, nous prête, sans aucun doute, son secours, et nous délivre de tous ces embarras, pourvu que nous croyons et que nous le priions avec ardeur. A. Je ne le ferai jamais plus volontiers que maintenant; car je ne me suis jamais trouvé dans une nuit si profonde. O Dieu ! notre Père, qui nous exhortez à vous prier et qui nous en faites la grâce lorsque nous vous prions, car nous vivons mieux alors et nous devenons meilleurs; exaucez-inoi. Je respire à -peine au milieu de ces ténèbres, tendez-moi une main secourable, montrez-moi votre lumière, rappelez-moi de mes erreurs, afin que, sous votre conduite, je rentre en moi-même et en vous. Ainsi soit-il ! L. R. Recueille toute ton attention et suis-moi autant que tu en es capable. A. Dis-moi, je te prie, s'il t'est survenu quelque pensée qui nous empêche de périr- au milieu de ces ténèbres? L. R. Recueille-toi. A. Je t'écoute et ne m'occupe de rien autre.
10. L. R. D'abord, qu'est-ce que le faux? Examinons de plus en plus. A. Je serais étonné qu'il fût autre chose que ce qui n'est pas tel qu'il paraît. L. R. Attention ! commençons par interroger les sens : Ce que les yeux aperçoivent ne peut sûrement être appelé faux, s'il n'y a quelque apparence de vrai. Par exemple, un homme que nous voyons en songe
1. Cette définition a été adoptée par Bossuet dans son Traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même. « Le vrai, c'est ce qui est, le a faux c'est ce qui n'est pas. On peut bien ne pas entendre ce qui est, mais jamais on ne peut entendre ce qui n'est pas; on croit quelquefois l'entendre, et c'est ce qui fait l'erreur. Mais en effet, . on ne l'entend pas puisqu'il n'est pas. » (Boss. édit. de Bar, tom.IV, pag. l8.) On pourra ajouter qu'il y a deux sortes d'existence: l'existence réelle et objective, et l'existence purement intellectuelle ou subjective. Ce n'est qu'en embrassant ces deux manières d'exister que la vérité peut être définie ce qui est. Si l'on restreignait cette définition aux êtres réels et objectifs, elle deviendrait fausse; car il y a, une infinité de vérités qui n'existent que dans la pensée et qui n'ont point do réalité extérieure.
143
n'est pas un homme véritable, mais il est faux parce qu'il a une apparence de vérité. Qui pourrait, en effet, après avoir vu un chien en songe, dire qu'il a vu un homme? Le chien est donc faux aussi, et précisément parce qu'il a quelque apparence de vérité. A. La chose est ainsi que tu le dis. L. R. Et si un homme éveillé voit un cheval et croit que c'est un homme, ne se trompe-t-il pas précisément parce qu'il y voit quelque ressemblance avec un homme? Car s'il n'aperçoit que l'image d'un cheval, il ne peut croire qu'il voit un homme? A. Je suis forcé d'en convenir. L. R. Nous appelons également faux l'arbre que nous voyons peint, fausse figure celle qui est reproduite dans un miroir, faux le mouvement des tours quand elles semblent marcher aux yeux du navigateur; ainsi, encore, la raine paraît faussement brisée dans l'eau : pourquoi? parce qu'il y a dans tout cela ressemblance avec la vérité. A. J'en conviens. L. R. Pour le même motif, nous nous trompons en voyant des jumeaux, des veufs, plusieurs impressions d'un même sceau , et d'autres choses pareilles. A. Je conçois cela et je l'accorde. L. R. La ressemblance aperçue par les yeux est donc la mère de la fausseté. A. Je ne puis le nier.
11. L. R. Tous ces objets, si je ne me trompe, peuvent être divisés en deux genres : à l'un se rattachent les choses égales; à l'autre les choses inégales. Les choses sont égales quand nous disons qu'elles se ressemblent également, comme il a été dit des jumeaux et des marques imprimées par le sceau. La ressemblance est entre les choses inégales, lorsqu'un objet moins bon est semblable à un meilleur objet. En effet, qui pourrait dire, en se regardant dans un miroir, qu'il est semblable à l'image qui s'y montre, et ne dirait pas plutôt qu'elle est semblable à lui ?Ce dernier genre comprend en partie ce que l'âme éprouve, en partie ce qui se voit. Or, ce que l'âme éprouve, elle l'éprouve dans ses sens, comme le mouvement de la tour, qui n'a rien de réel; ou en elle-même, par ce qu'elle a reçu des sens, comme les imaginations de ceux qui rêvent, peut-Être aussi de ceux dont la raison est en délire. Quant aux apparences que nous percevons dans les choses qui sont sous nos yeux, les unes sont exprimées et formées par la nature, les autres par les êtres animés. La nature forme des ressemblances inégales, soit par la naissance, soit par la réflexion; par la naissance, lorsque des enfants naissent semblables à leurs parents; par la réflexion, comme dans les miroirs; car, quoique ces miroirs soient presque tous l'ouvrage des hommes, ce ne sont pas eux qui tracent les images qui s'y reproduisent. Les ouvrages des êtres animés consistent dans des peintures, ou dans des imitations semblables; et l'on peut comprendre dans ce genre ce que font les démons, si toutefois ils font quelque chose. Les ombres mêmes des corps, parce qu'elles ne sont pas fort éloignées de ressembler aux corps, et de ne pouvoir être appelées de faux corps, doivent être considérées comme appartenant au jugement des yeux, et placées au nombre des choses que la nature produit par réflexion; car tout corps exposé à la lumière la réfléchit et produit une ombre en sens opposé. Trouves-tu à contredire? A. Non, mais je suis impatient de savoir où tu veux en venir.
12. L. R. Attendons encore avec patience , jusqu'à ce que les autres sens nous aient également enseigné que la fausseté consiste dans la ressemblance avec le vrai. Le sens de l'ouïe ne nous fournit guère moins d'espèces de ressemblances. C'est ainsi qu'entendant la voix d'un homme que nous ne voyons pas, nous le prenons pour un autre qui a une voix semblable; et parmi les similitudes inégales nous pouvons citer comme exemples l'écho, le tintement des oreilles, l'imitation du cri du merle et du corbeau que reproduisent certaines horloges, enfin les sons que croient entendre des hommes qui rêvent, ou qui sont en délire. Ces inflexions de voix que les musiciens désignent comme fausses prouvent avec une grande force cette même vérité; ce qui paraîtra mieux dans la suite. Il suffit maintenant de remarquer que ces mêmes inflexions se rapprochent beaucoup de celles qu'on appelle vraies. Suis-tu bien ces idées? A. D'autant plus volontiers que je n'ai point de fatigue à les comprendre. L. R. Ainsi, pour ne nous arrêter pas, crois-tu que l'on puisse distinguer par l'odeur un lys d'un autre lys; ou par la saveur, un miel qui a la saveur du thym, d'un autre miel qui a la même saveur, et qui est d'une autre ruche; ou par le toucher, la douceur des plumes d'un cygne de la douceur des plumes d'une oie? A. Je ne le crois pas. L. R. Et lorsque dans nos rêves nous croyons sentir, goûter ou toucher de tels [144] objets, ne sommes-nous pas trompés par la ressemblance des images, ressemblance d'autant plus imparfaite qu'elle est plus vaine? A. Tu dis vrai. L. R. Ainsi nous le voyons, que les choses soient égales, ou inégales: c'est la ressemblance qui séduit et trompe tous nos sens; et lors même que retenant notre consentement ou discernant les différences nous ne sommes pas trompés, nous appelons cependant fausses les choses que nous trouvons ressembler aux vraies. A. Je n'en puis douter.
CHAPITRE VII. DU VRAI ET DE CE QUI LUI RESSEMBLE.
13. L. R. Sois de nouveau attentif , et revenons sur les mêmes idées, afin de mieux marquer le but auquel nous nous efforçons d'atteindre. A. Me voici, dis-moi ce que tu voudras , j'ai résolu de supporter ces longs circuits et je ne crains point cette fatigue, dans l'espoir de parvenir enfin au but vers lequel je sais que nous tendons. L. R. Tu fais bien, mais réponds à cette question: Lorsque tu vois deux veufs tout à fait semblables, crois-tu que l'on puisse dire que l'un des deux est faux? A. Je ne le crois pas du tout; car si tous les deux sont des neufs, ce sont des eeufs véritables. L. R. Et lorsque nous apercevons une image réfléchie par un miroir, à quel signe jugeons-nous que c'est une fausse image? A. C'est qu'on ne peut la toucher, qu'elle ne fait point de bruit, qu'elle ne se meut pas, qu'elle ne vit pas; il y a aussi un grand nombre d'autres signes qu'il serait trop long d'indiquer. L. R. Je vois que tu ne veux pas être retardé, et il faut se conformer à ton impatience. Ainsi, pour ne pas tout rappeler, si ces hommes que nous apercevons en songe pouvaient vivre, parler, être touchés par ceux qui sont éveillés; s'il n'y avait aucune différence entre eux et ceux que, bien sains et bien éveillés, nous voyons et nous entretenons, pourrions-nous dire que ce sont de faux hommes? A. Comment aurait-on raison de le dire? L. R. Donc, s'ils étaient aussi vrais qu'ils paraissent semblables aux hommes véritables, s'il n'y avait aucune différence entre eux, et s'ils sont faux à cause des différences qui les rendent dissemblables , ne doit-on pas avouer. que la similitude est la mère de la vérité, et la dissimilitude celle de la fausseté? A. Je n'ai rien à te répondre, et je suis confus du consentement téméraire que j'ai accordé plus haut.
14. Tu as tort d'en être confus, comme si ce n'était pas pour ce motif-là même que nous avons choisi cette sorte d'entretien. Puisque nous ne parlons qu'entre nous, je veux qu'ils portent le nom de Soliloques; ce nom est nouveau, peut-être dur, mais assez propre à indiquer la chose. En effet, la vérité ne peut guère être recherchée avec plus de succès qu'en interrogeant et qu'en répondant; de plus il est difficile de trouver quelqu'un qui n'ait pas honte d'être convaincu dans la dispute; et il arrive presque toujours que les cris désordonnés de l'opiniâtreté font perdre la trace de la vérité, et il en résulte pour les esprits une peine tantôt dissimulée, et tantôt manifestée. Je crois donc que pour découvrir la vérité, avec l'aide de Dieu, il est très-sage et fort prudent que je t'interroge et que tu me répondes; et si tu t'es engagé témérairement, tu n'as pas à craindre de te rétracter ni de te dégager : tu ne pourrais autrement et tirer de ce défilé.
CHAPITRE VIII. CE QUI CONSTITUE LE VRAI OU LE FAUX:
15. A. Tu as raison, mais je ne vois pas bien ce que j'ai eu tort d'accorder. C'est peut-être d'avoir dit qu'on appelle faux ce qui a quelque ressemblance avec le vrai; et cependant je ne vois rien autre chose qui mérite le nom de faux, et je suis de nouveau forcé de reconnaître que les choses que l'on appelle fausses ne sont ainsi appelées que parce qu'elles diffèrent du vrai ; d'où l'on doit conclure que c'est la dissimilitude qui est la cause de la fausseté. Ainsi je suis dans le plus grand embarras, et mon esprit ne me présente rien qui vienne de causes opposées. L. R. Et si c'était la seule chose dans la nature qui existât ainsi? Ignores-tu qu'après avoir étudié un grand nombre d'espèces d'animaux , on ne trouve que le seul crocodile qui remue la mâchoire supérieure en mangeant (1) ? et ne sais-tu
1. Il faut pardonner à saint Augustin d'avoir adopté cette erreur puisqu'elle a été celle d'Aristote, de Pline et même de beaucoup de voyageurs modernes. Mais des observations plus exactes ont appris que dans le crocodile, la mâchoire supérieure, comme dans tous les animaux, est jointe aux autres os de la tête, et qu'aucune articulation ne la rend mobile.
145
pas que l'on ne peut presque rien trouver de tellement semblable à une chose qui n'en diffère sous quelques rapports ? A. Je conçois cela; mais lorsque je considère que ce que nous appelons faux possède quelque ressemblance et quelque différence avec le vrai, je ne puis apercevoir si c'est plutôt cette ressemblance ou cette différence qui lui mérite le nom de faux. Si je suppose que c'est la différence, il n'y aura rien qui ne puisse être appelé faux; car il n'y a point de chose qui ne diffère, sous quelques rapports, d'une autre que cependant nous disons vraie. Et, si je suppose que c'est la ressemblance qui fait qu'on appelle une chose fausse; comment répondre à l'exemple de ces neufs, qui sont vrais parce qu'ils sont exactement semblables , et de plus, comment réfuter celui qui me forcerait de convenir que toutes choses sont fausses, car je ne puis nier que toutes ne soient semblables sous quelque rapport? Et quand tu m'inspirerais le courage de lui répondre que c'est la similitude et la dissimilitude qui contribuent à la fuis à ce que l'on appelle une chose fausse, quel moyen me fourniras-tu de me tirer d'embarras? Il me pressera de nouveau d'avouer que toutes choses sont fausses, puisque toutes, ainsi qu'il a été dit plus haut, se ressemblent sous quelques rapports et diffèrent sous quelques autres. Il ne me resterait plus qu'à avancer qu'il n'y a de faux que ce qui est différent de ce qu'il paraît; mais je craindrais de rencontrer encore ces formidables écueils auxquels je me croyais échappé; car emporté par quelque tourbillon soudain , je serais de nouveau obligé de reconnaître que le vrai est ce qui est tel qu'il parait, d'où il suit qu'il ne peut y avoir rien de vrai, sans. quelqu'un qui le connaisse. Mais c'est ici que je dois craindre de heurter aux écueils cachés: ils sont véritables, quoique,je ne les voie pas. D'un autre côté, si je dis que le vrai est ce qui est, il s'ensuivra que le faux n'existe pas, ce qui répugne. Mes incertitudes reviennent ainsi , et je m'aperçois que je n'ai pas fait un pas en te suivant dans tes longues recherches.
CHAPITRE IX. QUE SONT LE FAUX, LE TROMPEUR ET LE MENTEUR?
16. L. R. Sois de nouveau attentif, car je ne puis me persuader que nous ayons inutilement imploré le secours divin. Je vois qu'après avoir étendu nos recherches autant que nous l'avons pu, leur résultat a été de conclure qu'on doit appeler faux ce qui veut paraître ce qu'il n'est pas, ou même qui veut paraître exister tandis qu'il n'existe pas. La première espèce de faux se divise en tromperie ou en mensonge. On appelle trompeur celui qui a le désir de tromper, ce qui ne peut se concevoir sans une âme; cette tromperie est quelquefois l'ouvrage de la raison, quelquefois de la nature; de la raison, comme dans les animaux raisonnables, tel que l'homme ; de la nature, comme dans les bêtes, tel que le renard. J'appelle mensonge l'espèce de tromperie de ceux qui feignent. Ils diffèrent du trompeur, en ce que tout trompeur cherche à tromper, tandis que tout menteur ne cherche pas à tromper. En effet, les mimes, les comédies, et un grand nombre de poèmes, sont pleins de mensonges, qui ont moins pour but de tromper que de plaire, et presque tous ceux qui plaisantent ont recours au mensonge. Mais on appelle trompeur, un homme faux, celui dont l'intention est de tromper. Quant à ceux qui n'ont pas pour but de tromper, mais qui emploient cependant la feinte, personne n'hésite à les désigner sous le nom de menteurs, ou du moins de gens qui feignent. As-tu quelque chose à objecter ?
17. A. Continue, je te prie, car maintenant peut-être as-tu commencé à m'enseigner, sur la fausseté, des choses qui ne sont pas fausses; mais j'attends que tu m'expliques quelle est cette espèce de faux qui consiste à se donner l'apparence de l'existence, tandis qu'on n'existe pas réellement. L. R. Que n'attends-tu un moment? Ce genre de faux est le même dont nous avons déjà indiqué plusieurs exemples. Est-ce que ton image peinte dans un miroir ne parait pas vouloir se présenter comme toi-même, et n'est-elle pas fausse précisément parce qu'elle n'est pas toi? A. La chose me semble ainsi. L. R. Est-ce que toute peinture, toute représentation, toute imitation de ce genre, n'a [146] pas pour objet de paraître la chose même à la ressemblance de laquelle elle est faite? A. Je suis forcé d'en convenir. L. R. Tu n'auras pas de peine à avouer que les images qui trompent les hommes endormis ou en délire sont du même genre? A. Il est sûr qu'aucun objet me cherche autant à se confondre avec la réalité telle qu'elle frappe les hommes raisonnables et éveillés; mais ces images sont précisément fausses, parce qu'elles cherchent à être ce qu'elles ne peuvent être. L. R. Qu'ai-je besoin de parler encore du vacillement des tours, de la rame plongée dans l'eau ou des ombres des corps? Ces phénomènes, je pense, doivent être jugés d'après la même règle, sans difficulté. A. Sans difficulté. L. R. Je ne parle pas des autres sens; car personne, en y réfléchissant, ne peut manquer d'apercevoir que nous appelons faux, dans les choses qui frappent nos sens, ce qui veut paraître exister tandis qu'il n'est pas.
CHAPITRE X. IL Y A DES CHOSES VRAIES, PRÉCISÉMENT PARCE QU'ELLES SONT FAUSSES.
18. A. Tu as raison; mais je m'étonne que tu veuilles distinguer du faux les poèmes, les plaisanteries et les autres fictions. L. R. Parce que autre chose est de vouloir paraître faux, autre chose est de ne pouvoir être vrai. Ainsi nous pouvons placer sur la même ligne que les ouvrages des peintres et des autres imitateurs de la nature, les oeuvres de l'esprit telles que les comédies, les tragédies, les mimes et d'autres de ce genre. Un homme peint, quoiqu'il soit fait pour ressembler à un homme, ne peut pas plus être un homme véritable que les peintures de la vie humaine renfermées dans les livres des comiques n'ont de réalité. Ces choses ne veulent pas être fausses, et ne le désirent aucunement; mais elles ont été forcées par une sorte de nécessité de suivre la volonté de l'artiste. A la vérité Roscius sur la scène représentait volontairement une fausse Hécube, tandis qu'il devait à la nature d'être un homme; mais volontairement aussi il était un vrai tragédien, puisqu'il remplissait le rôle qu'il avait choisi; il était aussi un faux Priam, quand il imitait Priam qu'il n'était pas. De là naît une merveille que personne ne peut s'empêcher de reconnaître. A. Quelle est-elle? L. R. N'est-ce pas que toutes ces choses ne sont vraies en partie qu'autant qu'elles sont en partie fausses, que le faux ne sert en elles qu'à mieux établir le vrai, et que si elles refusent d'être fausses elles ne peuvent devenir ce qu'elles veulent ou doivent être? En effet, comment ce Roscius, dont je viens de parler, serait-il un vrai tragédien, s'il ne consentait à être un faux Hector, une fausse Andromaque, un faux Hercule, et ainsi des rôles sans nombre qu'il a remplis? Comment une peinture pourrait-elle être véritable, si le cheval qu'elle représente n'était pas faux? Comment l'image véritable de l'homme pourrait-elle paraître dans un miroir, si elle n'était pas un faux homme? Mais pourquoi, si certains hommes, pour exprimer le vrai , ont besoin d'employer le faux, craignons-nous tant la fausseté et désirons-nous la vérité comme le plus grand bien? A. Je l'ignore, et je m'en étonne beaucoup; mais c'est peut-être parce que, dans ces exemples, il n'y a rien qui soit digne de notre imitation. En effet, pour remplir véritablement le rôle de notre vie, quel qu'il soit, nous ne devons point, comme les histrions, ni comme les images reproduites dans un miroir, ni comme les vaches d'airain de Myron, recourir et nous prêter à un rôle étranger, ni par conséquent -chercher à être faux; mais nous devons poursuivre cette vérité, qui n'a point deux faces différentes, qui ne se contredit jamais elle-même, et où le vrai ne se mêle point au faux. L. R. Les choses que tu recherches ont un caractère grand et divin; si néanmoins nous parvenons à les trouver, ne seras-tu pas obligé d'avouer que c'est d'elles qu'est formée et constituée cette vérité dont le nom sert à désigner tout ce qu'on appelle vrai, de quelque manière que ce soit? A. J'en conviens sans peine.
CHAPITRE XI. VÉRITÉ DANS LES SCIENCES. QU'EST-CE QUE LA FABLE? QU'EST-CE QUE LA GRAMMAIRE?
19. L. R. Maintenant réponds-moi, la science de la discussion est-elle vraie ou fausse ? A. Qui doute qu'elle soit vraie ? mais la grammaire aussi est vraie. L. R. L'est-elle autant que la science de la discussion ? A. Je ne vois pas ce qui peut être plus vrai que ce qui est vrai. L. R. Sans doute ce qui n'a [147] aucun mélange de faux, mélange qui te choquait, lorsque tu examinais comment certaines choses ne pouvaient être vraies, sans être en même temps fausses. Ignores-tu que toutes ces fictions et ces mensonges appartiennent à la grammaire? A. Je ne l'ignore pas; mais, comme je le pense, ce n'est pas la grammaire qui les rend fausses; elle se borne à faire connaître ce qu'elles sont. En effet, la fable est un mensonge composé pour l'utilité ou pour l'agrément. La grammaire est, au contraire, l'art de gouverner et de régler la voix articulée. Par une nécessité de sa nature, elle est forcée de recueillir toutes les fictions composées dans les langues humaines, et conservées par la mémoire et par l'écriture; ce n'est pas elle qui en est l'auteur, mais elle établit d'après elles des règles véritables. L. R. C'est très-bien; je n'examine pas maintenant si les distinctions et les définitions dont tu viens de te servir sont exactes; mais, je te demande si c'est la grammaire elle-même ou plutôt la science de l'argumentation qui prouve qu'elles le sont. A. Je ne nie pas que le pouvoir et la facilité de définir dont je me suis servi pour ces distinctions, n'appartiennent à l'art de la discussion.
20. L. R. La grammaire elle-même, si elle est vraie,-n'est-elle pas vraie en tant que science? Ce qu'ici nous appelons science, en latin disciplina, vient du verbe discere, apprendre, et signifie des règles qu'on a apprises. Or on ne peut dire de personne qu'il ignore ce qu'il a appris et retenu; de plus, personne ne sait le faux; donc toute science est vraie. A. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal fondé dans ce court raisonnement; ce qui m'embarrasse cependant, c'est la crainte de voir quelqu'un en conclure que les fables mêmes sont vraies; car nous les apprenons et nous les retenons. L. R. Le grammairien qui nous les enseignait ne nous commandait-il pas de les apprendre sans y croire? A. Oui, il nous pressait fort de les apprendre. L. R. A-t-il jamais insisté pour nous faire ajouter foi au vol de Dédale? A. Non, jamais; mais si nous n'apprenions pas bien la fable, à peine nous permettait-il de nous occuper d'autres choses. L. R. Tu nies donc qu'il soit vrai que ce soit là une fable, et que l'on parle ainsi de Dédale? A. Je ne nie aucunement cette vérité. L. R. Tu ne peux donc nier que tuas appris le vrai lorsque tu as appris cette fable. En effet, s'il était vrai que
Dédale eût vo.e dans les airs et si la chose était enseignée aux enfants, et admise par eux comme une fable, par cela même on leur enseignerait une fausseté, puisqu'on leur donnerait comme fable ce qui serait vrai. Il arrive ainsi, ce que nous regardions tout à l'heure comme extraordinaire, que la fable du vol de Dédale ne peut être vraie s'il n'est faux que Dédale ait volé. A. Je comprends cela, mais j'attends quelle conséquence nous en pourrons tirer. L. R. N'est-ce pas celle-ci, que nous avons raison d'établir, que la science ne peut être science si elle n'enseigne le vrai? A. Comment cela s'applique-t-il au sujet que nous traitons? L. R. Le voici: je veux savoir de toi ce qui fait que la grammaire est une science? Car ce qui fait qu'elle est une science fait en même temps qu'elle est vraie. A. Je ne sais que te répondre. L. R. Ne te parait-il pas que si dans la grammaire il n'y avait aucune définition, aucune distinction et distribution des genres et des parties, ce ne pourrait être une science?A. Je comprends maintenant ce que tu me dis, et mon esprit ne peut songer à aucune science sans y admettre des définitions, des divisions et des raisonnements, qui servent à déterminer la nature de chaque chose, à rendre- à chacune ce qui lui appartient sans rien confondre, sans rien lui enlever de ce qui la constitue, sans rien ajouter de ce qui lui est étranger, enfin tout ce qui forme ce que l'on appelle une science. L. R. N'est-ce pas aussi tout cela qui la rend vraie science? A. Je vois que c'est une conséquence de ce que je viens de dire.
21. L. R. Dis-moi maintenant quelle est la science qui enseigne à bien définir, à bien diviser, à bien distinguer? A. Il a été reconnu plus haut que c'est la science de l'argumentation. L. R. La grammaire a donc été constituée comme science et comme chose vraie par cette même science-de l'argumentation, puisque tu l'as défendue plus haut de tout reproche de fausseté. Or, ce que je dis de la grammaire, je pourrais le conclure également de toutes les sciences, car tu as avoué, et avec raison, que tu ne connaissais aucune science qui pût se passer de définition et de division; mais si ces sciences sont vraies, par là. même qu'elles sont des sciences, qui pourrait nier que c'est par la vérité même que toutes sont vraies? A. Je suis près de l'avouer, mais une chose m'embarrasse : c'est que nous [148] comptons au nombre de ces sciences l'art même de discuter. Je pense que c'est plutôt ce dernier art qui est vrai par ta vérité. L. R. Cette remarque est fort juste et prouve l'activité de ton attention; mais tu ne nieras pas, je présume, que cette science de disputer est vraie, par cela même qu'elle est une science. A. C'est là précisément ce qui m'embarrasse, car j'ai observé qu'elle était aussi une science, et que pour ce motif on devait la considérer comme vraie. L. R. Mais, enfin, penses-tu qu'elle pourrait être une science si elle n'employait les divisions et les définitions? A. Je n'ai rien à t'opposer. L. R. Mais si c'est là son office, elle est par elle-même une vraie science. Qui donc s'étonnera que la science par laquelle tout est vrai soit en elle-même ou par elle-même véritablement une vérité? A. Je ne vois plus rien qui s'oppose à ce que j'embrasse ce sentiment.
CHAPITRE XII. DE COMBIEN DE MANIÈRES CERTAINES CHOSES EXISTENT DANS UNE AUTRE.
22. L. R. Sois donc attentif à ce qu'il me reste à te dire. A. Parle, si tu as quelque chose à m'enseigner, que je puisse comprendre et que je sois porté à admettre. L. R. Nous savons qu'une choie est dans une autre de deux manières différentes. D'une première manière, quand elle peut en être séparée et transportée ailleurs ; ainsi, ce morceau de bois est dans ce lieu, le soleil est au levant. D'une seconde manière, quand une chose est tellement unie au sujet qu'elle ne peut en être séparée; ainsi,, dans ce même morceau de bois la nature et la forme que nous voyons, la lumière dans le soleil, dans le feu, la chaleur, la science dans l'âme, et ainsi des autres choses semblables. Crois-tu autrement?
A. Ce sont d'anciennes propositions qui nous ont été enseignées et que nous avons étudiées avec le plus grand soin dès les premières années de notre adolescence; ainsi, puisque tu m'interroges à ce sujet, je ne puis m'empêcher d'en admettre la vérité sans aucune hésitation. L. R. Allons plus loin : Ne reconnais-tu pas que ce qui est inséparable du sujet ne peut subsister, si le sujet ne subsiste? A. J'avoue également que cela est nécessaire; mais quiconque examinera la chose avec attention reconnaîtra qu'il est possible que le sujet subsistant, tout ce qui est dans le sujet ne subsiste pas. La couleur de notre corps peut s'altérer par la maladie et par l'âge, quoique le corps ne périsse pas encore. Cependant il n'en est pas ainsi de toutes les propriétés du sujet, mais seulement de celles qui ne sont pas absolument nécessaires à l'existence du sujet auquel elles appartiennent. Pour que ce mur existe, il n'est pas nécessaire que nous le voyions de telle couleur; qu'il vienne à blanchir ou à noircir par quelque accident, qu'il prenne d'autres couleurs encore, il ne cessera pas néanmoins d'être appelé et d'être réellement un mur. Mais si le feu manque de chaleur, il n'est plus feu, et nous ne pouvons appeler neige ce qui est privé de blancheur.
CHAPITRE XIII. CONCLUSION EN FAVEUR DE L'IMMORTALITÉ DE LAME.
23. Quant à ce que tu m'as demandé, s'il était possible que le sujet cessant d'exister, ce qui est dans le sujet continue à demeurer, quel est celui qui pourrait accorder ou admettre une telle proposition ? Il est tout à fait contraire à la vérité, il est même absurde que ce qui ne peut être que dans un sujet puisse exister, quand même ce sujet n'existerait pas. L. R. Nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. A. Que dis-tu? L. R. Ce que tu entends. A. Quoi ! est-il déjà évident que l'âme est immortelle? L. R. Si ce que tu m'as accordé est vrai, la chose est évidente, à moins que tu ne prétendes que l'âme, même en mourant, existerait encore. A. Je n'avouerai jamais une pareille proposition, et je dis que si l'âme meurt, elle n'existe plus; et ce qu'ont avancé quelques grands philosophes, que la substance qui donne la vie partout où elle se montre ne peut être sujette à la mort, ne m'éloigne pas de ce sentiment. Quoique la lumière éclaire tous les lieux où elle peut pénétrer et ne puisse admettre en elle les ténèbres, à raison de cette force puissante qui tient au principe des contraires, elle est sujette à s'éteindre, et le lieu qu'elle a éclairé devient obscur; ainsi cette lumière qui résistait aux ténèbres, et qui ne s'y mêlait d'aucune manière, leur a cédé l'empire en n'existant plus, comme elle le pouvait en s'éloignant. Ne puis-je [149] donc pas craindre que la mort ne soit au corps ce que les ténèbres sont au lieu, lorsque l'âme s'en éloigne ou s'y éteint comme la lumière ? Alors, loin d'être en sûreté contre la mort du corps, il faudrait désirer une espèce de mort qui en séparât l'âme toute vivante et la conduisît dans un lieu où elle ne pût s'éteindre, si toutefois il existe un tel lieu. Ou bien, si la chose est impossible, si l'âme est comme une lumière qui s'allume dans le corps et ne peut exister ailleurs, si toute mort est l'extinction de cette âme ou de la vie dans ce corps; il faut choisir, autant que la condition humaine le permet, un genre de vie où cette existence si courte puisse passer avec sécurité et tranquillité ; j'ignore au reste comment la chose serait possible, si l'âme devait mourir. Heureux ceux qui sont persuadés, soit par eux-mêmes, soit par une autorité quelconque, que la mort n'est pas à craindre, lors même que l'âme mourrait ! Quant à moi, malheureux ! aucune raison, aucun livre n'ont pu me le persuader encore.
24. L. R. Cesse de gémir, l'âme humaine est immortelle. A. Comment le prouves-tu? L. R. Par les principes que tu m'as accordés plus haut, et, je le pense, après un mûr examen. A. Je ne me rappelle point avoir répondu légèrement à aucune de tes questions; mais résume, je t'en prie ;voyons où nous sommes parvenus après tant de circuits, et ne m'interroge plus. Si tu te bornes en effet à rappeler ce que je t'ai accordé, pourquoi attendrais-tu de moi une nouvelle réponse ? Serait-ce pour retarder inutilement mon bonheur, si nous avons fait quelque heureuse découverte? L. R. Je ferai ce que tu désires; mais sois bien attentif. A. Parle, je suis attentif: pourquoi me tourmenter de cette manière? L. R. Si ce qui existe dans un sujet ne peut cesser d'exister, le sujet lui-même, par une conséquence nécessaire, ne peut cesser d'exister. Or, toute science est dans l'âme comme dans un sujet. Il est donc nécessaire que l'âme existe toujours si la science doit toujours exister. Mais la science n'est autre chose que la vérité, et la vérité, comme la raison nous l'a prouvé au commencement de ce livre, doit toujours exister. L'âme doit donc toujours exister, elle ne peut donc mourir; et pour nier avec quelque raison l'immortalité de l'âme , il faudrait prouver que parmi les principes posés plus haut tout n'est pas solidement établi.
CHAPITRE XIV. EXAMEN DE LA CONCLUSION PRÉCÉDENTE.
25. A. Je suis tenté de me livrer à la joie, mais deux motifs me retiennent encore. Ce qui me frappe d'abord, c'est que nous avons employé un si long circuit, et suivi je ne sais quelle chaîne de raisonnements, tandis que l'on pouvait démontrer si brièvement, comme on vient de le faire, toute la proposition qu'il s'agissait d'établir. Ainsi, ce qui m'inquiète, c'est que la dialectique nous ait conduits par tant de détours, comme pour nous tendre des piéges. Ensuite , je ne vois pas comment on peut dire que la science est toujours dans l'âme, surtout la science de l'argumentation, lorsqu'un si petit nombre en sont instruits, et que ceux même qui la connaissent ne l'ont apprise que longtemps après leur naissance; car nous ne pouvons pas dire que les âmes des ignorants ne soient pas des âmes, ou qu'une science qu'ils ignorent soit dans leur âme; et si ces deux propositions sont tout à fait absurdes, il s'ensuit que la vérité n'est pas toujours dans l'âme, ou que la science de l'argumentation n'est pas cette vérité.
26. L. R. Tu vois que le raisonnement ne nous a pas conduits inutilement à travers tant de détours. En effet, nous cherchions ce que c'est que la vérité, et maintenant même, après avoir parcouru tant de sentiers pour nous conduire au milieu du dédale des choses, nous ne pouvons nous flatter d'être parvenus à la découvrir. Mais que ferons-nous? Abandonnerons-nous ce que nous avons entrepris et attendrons-nous que quelques livres étrangers nous tombent dans les mains et satisfassent à cette question ? Car il en est, je pense, un grand nombre qui ont été composés avant nous, et que nous n'avons pas lus; et de nos jours, pour ne pas nous borner à de simples suppositions, nous savons que l'on a écrit sur ce sujet et en prose et en vers; qu'il a été traité par des hommes dont nous ne pouvons ignorer les écrits, et dont le génie nous est tellement connu, que nous ne saurions désespérer de trouver, dans leurs ouvrages, ce que nous cherchons. Et ne voyons-nous pas ici même, ce grand homme, qui a fait revivre, dans toute sa perfection, l'éloquence que nous regardions comme morte avant qu'il parût? Après nous [150] avoir enseigné par ses écrits la manière de vivre, nous laissera-t-il ignorer la nature de la vie (1)? A. Je ne le pense pas, et je compte beaucoup sur son secours; tout ce qui m'afflige, c'est que je ne puisse lui faire connaître, comme je le voudrais, notre ardeur soit pour lui, soit pour la vérité; sans doute il aurait compassion de notre soif du vrai, et l'étancherait plus tôt qu'elle ne l'est. Il est en paix, car il est complètement persuadé de l'immortalité de l'âme ; il ne sait pas qu'il est peut-être des hommes qui ont assez connu le malheur d'ignorer cette vérité et qu'il serait cruel de ne pas secourir, surtout quand ils le demandent. Cet autre a connu dans l'intimité notre amour pour la vérité; mais il est si éloigné de nous, et nous sommes dans une telle situation, que nous pourrions à peine communiquer par lettres. Je pense que, durant le loisir dont il jouit au delà des Alpes, il a terminé le poème destiné à dissiper les craintes de la mort, l'engourdissement et le froid mortel dont l'âme avait été si longtemps frappée. Mais avant l'arrivée de ces secours qui ne sont point en notre pouvoir, n'est il pas honteux de perdre ainsi notre temps et de laisser notre âme elle-même attachée et comme enchaînée à l'incertitude de volontés étrangères?
CHAPITRE XV. NATURE DU VRAI ET DU FAUX.
27. Où sont les prières que nous avons adressées, que nous adressons encore à Dieu, non pour qu'il nous accorde les richesses, les voluptés du corps, les suffrages et les honneurs populaires, mais pour qu'il nous ouvre le chemin et nous aide à connaître notre nature et la nature divine? Nous abandonnerait-il ainsi, ou Ferait ce nous qui l'abandonnerions? L. R. II est bien éloigné de délaisser ceux qui soupirent après de telles connaissances. Aussi devons-nous repousser l'idée d'abandonner un tel guide. Rappelons donc, en peu de mois, si cela te convient, ce qui a servi à établir ces deux propositions : Que la vérité doit
1. On ne peut guère douter qu'il ne soit question ici de saint Ambroise et de son livre des Offices.
2. Zénobe ou Zénobius,à qui sont adressés les livres de l'Ordre, et ls deuxième des lettres de saint Augustin, était digne de cet hommage par son savoir et par son talent pour la poésie. Il ne nous reste rien de lui ; mais il parait qu'il avait composé plusieurs ouvrages, entre autres un sur l'Ordre, auquel celui de saint Augustin, sur le même sujet, sert de réponse et de supplément.
toujours exister, et que la science de l'argumentation est la vérité. Tu as dit, en effet, que ces deux conséquences te faisaient hésiter, et nous empêchaient d'être parfaitement sûrs de la thèse elle-même. Veux-tu que nous cherchions d'abord comment la science peut exister dans l'âme d'un ignorant, d'un ignorant que pourtant nous ne pouvons cesser d'appeler une âme? Cette considération paraissait t'ébranler, et te forcer à douter de nouveau de tout ce que tu avais accordé. A. Au contraire , examinons d'abord ce que j'ai accordé; nous verrons ensuite ce qu'il faut penser de cette dernière difficulté; après cela, il ne restera plus, je pense, de controverse à terminer. L. R. Soit, mais écoute avec la plus grande prudence. Je sais ce qu'il t'arrive lorsque tu es attentif. Occupé trop exclusivement de la conclusion et désireux de la voir au plus tôt, tu n'examines pas avec assez de soin, et tu accordes trop légèrement ce qu'on te demande. A. Tu dis peut-être vrai, mais je m'efforcerai de lutter de tout mon pouvoir contre ce genre de maladie. Or commence à m'interroger, et ne perdons pas le temps.
28. L. R. Voici, autant que je m'en souviens, comment nous avons conclu que la vérité ne pouvait périr. Si le monde entier, disions-nous, et la vérité même périssaient, il serait vrai que le monde et la vérité ont péri. Or, il n'est rien de vrai sans la vérité. La vérité ne peut donc périr. A. J'avoue cette proposition et je serais fort surpris si elle était fausse. L. R. Passons maintenant à une autre. A. Permets-moi d'examiner encore pendant un instant la première, afin de n'être pas réduit encore à revenir honteusement sur mes pas. L. R: Ne sera-t-il donc pas vrai que la vérité a péri? Si cela n'est pas vrai, elle n'a donc pas péri; si cela est vrai, comment, après l'anéantissement de la vérité, pourra-t-il y avoir rien de vrai, puisqu'il n'y aura plus de vérité? A. Je n'ai pas besoin d'y penser ni d'y réfléchir plus longtemps; passe à autre chose. Nous ferons certainement, si nous le pouvons, que des hommes doctes et habiles lisent ce que nous venons de dire et corrigent notre témérité, s'il y en a. Car je ne vois pas que, ni en ce moment ni jamais, on puisse découvrir rien de contraire à ce que nous venons d'avancer.
20. L. R. Ne nomme-t-on pas vérité ce qui rend vrai tout ce qui est vrai? A. Sans doute. L. R. N'a-t-on pas raison d'appeler [151] rai ce qui n'est pas faux? A. Ce serait une folie d'en douter. L. R. Le faux n'est-il pas ce qui offre la ressemblance d'une autre chose, sans être cependant la chose même à laquelle il ressemble? A. Je ne vois rien qui mérite mieux le nom de faux. Cependant l'on appelle également faux ce qui est fort éloigné de ressembler au vrai. L. R. Qui le nie? mais ajoute que ce faux porte en lui quelque imitation du vrai. A. Comment? quand on dit que Médée a volé dans les airs, soutenue par des serpents ailés, cette fiction n'imite nullement le vrai, car elle n'a aucune existence. Ce qui n'existe aucunement ne peut rien imiter. L. R. Ce que tu dis est exact, mais tu ne fais pas attention que l'on ne peut même appeler fausse une chose qui n'existerait pas du tout; si une chose est fausse, elle existe; si elle n'existe pas, elle n'est pas fausse. A. Nous ne dirons donc pas que cet étrange prodige attribué à Médée soit faux? L. R. Non, sans doute, car s'il est faux, comment peut-il être un prodige? A. Ceci m'étonne; ainsi, lorsque j'entends Médée dire: J'attelle à mon char d'immenses serpents ailés ', ce n'est pas une fausseté que j'entends? L. R. C'en est une, sans doute; car il y- a quelque chose que tu peux traiter de faux. A. Quoi? je te le demande 1 L. R. La proposition même exprimée dans ce vers. A. Mais quelle ressemblance offre-t-elle avec le vrai ? L. R. Parce qu'on ne s'exprimerait pas différemment si Médée avait réellement fait ce qu'elle dit. Ainsi une proposition fausse imite par l'expression les propositions véritables. Si on n'y croit pas, elle imite seulement les propositions véritables par la similitude de l'expression; elle est fausse et non trompeuse. Si au contraire on y croit, elle imite aussi celles que l'on croit vraies. A. Je comprends maintenant qu'il y a une grande différence entre ce que nous disons et les choses dont nous parlons; aussi je donne mon assentiment à ce que tu viens d'avancer; car la seule considération qui me retenait, c'est que nous ne pouvons appeler faux que ce qui offre quelque imitation du vrai. Ne rirait-on pas avec raison de qui s'aviserait de dire que la pierre est un faux argent? Si toutefois quelqu'un avance que la pierre est de l'argent, nous répondons qu'il dit faux, c'est-à-dire qu'il exprime une proposition fausse. Pour l'étain et le plomb, c'est avec raison, je crois, que
1. Cic. de l'Inv. I, 19.
nous les appelons de faux argent; car ils offrent quelque ressemblance avec ce métal; - ce qui est faux alors, ce n'est pas notre proposition, mais son objet.
CHAPITRE XVI. PEUT-ON DONNER AUX CHOSES EXCELLENTES LES NOMS DES CHOSES MOINDRES?
30. L. R. Tu as bien saisi; mais crois-tu qu'il soit convenable de désigner l'argent sous le .nom de faux plomb? A. Je ne le crois pas. L. R. Pourquoi? A. Je n'en sais rien; tout ce que je puis dire, c'est que ma volonté serait tout à fait opposée à cette expression. L. R. Ne serait-ce pas parce que l'argent est plus parfait que le plomb et que l'on aurait l'air de le rabaisser, tandis que l'on fait une espèce d'honneur au plomb en l'appelant un faux argent? A. Tu as expliqué ce que je voulais dire. C'est pour cela, je pense, que le droit considère comme infâmes, et incapables de tester, les hommes qui s'habillent en femmes. Je ne sais si l'on ferait mieux de les appeler de fausses femmes ou de faux hommes, mais nous pouvons sans aucun doute les désigner comme de véritables histrions, comme des hommes vraiment infâmes; s'ils ne sont point reconnus et que l'on ne puisse appeler infâmes que ceux qui ont obtenu une honteuse renommée, nous restons, je pense, dans la vérité, en les appelant de vrais débauchés. L. R. Un autre moment se présentera de traiter cette question. Beaucoup d'actions ont un côté honteux, en les envisageant sous le rapport extérieur, qui peuvent être honnêtes par la fin louable vers laquelle elles sont dirigées. C'est un grand problème de savoir si un homme, pour sauver sa patrie, peut revêtir une tunique de femme, tromper son ennemi et se montrer d'autant plus un homme qu'il aura feint d'être une femme; et si un sage, qui serait certain, de quelque manière, que sa vie est nécessaire au bien de l'humanité, devrait préférer mourir de froid plutôt que de se revêtir d'habits de femmes, s'il n'en avait pas d'autres.
Mais, comme je viens de le dire, nous traiterons ailleurs cette question. Tu aperçois sans peine combien elle a besoin d'être approfondie et jusqu'où doivent s'étendre ces sortes de choses, afin de ne pas favoriser légèrement [152] d'inexcusables turpitudes. Quant à la question qui nous occupe en ce moment, il me semble qu'elle est suffisamment éclaircie, et l'on ne peut douter que rien n'est faux sans quelque imitation du vrai.
CHAPITRE XVII. Y A-T-IL QUELQUE CHOSE D'ENTIÈREMENT FAUX OU D'ENTIÈREMENT VRAI?
31. A. Passe à autre chose; car je suis parfaitement convaincu de cette vérité. L. R. Je te demande donc si, indépendamment des sciences que nous apprenons dans le jeune âge, et au nombre desquelles on doit compter l'étude de la sagesse, nous pouvons trouver quelque chose de vrai et qui ne soit pas tel que l'Achille du théâtre, en partie faux, afin de pouvoir être en partie 'vrai? A. Je crois qu'on peut trouver en grand nombre de ces sortes de choses; ce ne sont pas en effet les sciences élémentaires qui nous font connaître cette pierre, et cependant pour être une véritable pierre, elle n'imite aucun autre objet, ce qui permettrait de l'appeler fausse. Tu le vois, ce seul exemple dispense d'en citer une infinie multitude d'autres qui se présentent d'eux-mêmes à la pensée. L. R. Je le vois; mais ne crois-tu pas qu'on peut dire que tous ces objets sont des corps? A. La chose me paraîtrait telle, si je considérais le vide comme n'étant rien, ou si je pensais que l'âme peut être comptée au nombre des corps, ou si je croyais que Dieu lui-même est un corps. Hais si tous ces êtres existent, je vois qu'ils ne sont ni vrais ni faux par l'imitation. L. R. Tu me rejettes fort loin, mais je prendrai, si je le puis, un chemin plus court. Ce que tu appelles le vide diffère sûrement de ce que tu nommes la vérité. A. La différence est grande; et qu'y aurait-il de plus vide que moi si je regardais la vérité comme quelque chose de vide, ou si je désirais si vivement une chose sans réalité? Que désiré-je découvrir en effet, sinon la vérité ? L. R. Tu m'accorderas sans doute aussi qu'il ne peut rien y avoir de vrai que la vérité ne rende vrai? A. Cela déjà nous a paru évident. L. R. Maintenant, doutes-tu qu'il n'y ait que le vide et les corps? A. Je n'en doute pas. L. R. Je le pense donc, tu regardes la vérité comme étant un corps. A. Nullement. L. R. Qu'y a-t-il dans un corps? A. Je l'ignore, et cela ne fait rien à la question; car, je le crois, tu sais au moins que si le vide existe, il est plus grand là où il n'y a point de corps. L. R. Cela est évident. A. Pourquoi donc nous y arrêter? L. R. Crois-tu que la vérité ait créé le vide, ou qu'il puisse y avoir quelque chose de vrai là où la vérité n'est pas? A. Non, je ne le crois pas. L. R. Le vide n'est donc pas vrai, car un être qui n'est pas lui-même le vide ne peut pas créer le vide; d'un autre côté il est évident que ce qui manque de vérité n'est pas véritable, et ce qui est désigné sous le nom de vide est appelé ainsi parce qu'il n'est rien. Comment donc peut être vrai ce qui n'est pas, ou comment peut exister ce qui n'a nulle réalité? A. Laissons donc là le vide comme quelque chose de vide.
CHAPITRE XVIII. LES CORPS SONT-ILS VÉRITABLEMENT?
32. L. R. Que penses-tu des autres êtres? A. Que demandes-tu? L. R. Ce que tu sais très-favorable à ma cause, car il reste à parler de l'âme et de Dieu; et si ces deux êtres sont vrais parce que la vérité existe en eux, personne ne doute de l'éternité de Dieu ; et l'âme doit être également regardée comme immortelle, si l'on prouve que la vérité qui ne peut périr existe aussi en elle. C'est pourquoi examinons cette question dernière : Le corps n'est-il pas véritablement vrai, c'est-à-dire : la vérité n'est-elle pas en lui, mais seulement quelque image de la vérité ? Car si le corps même, qui sans aucun doute est sujet à la mort, est vrai comme sont vraies les sciences, la science de l'argumentation ne sera plus cette vérité qui les rend toutes vraies, puisqu'elle ne parait pas avoir formé ce corps qui est vrai. Mais s'il n'est vrai que par imitation, et qu'en conséquence il ne soit pas entièrement vrai, rien peut-être n'empêche plus d'admettre que la science de l'argumentation soit la vérité. A. Examinons cependant ce que c'est que le corps; et lorsque la question sera bien éclaircie, cette controverse, peut-être, ne sera point encore terminée. L. R. Comment peux-tu savoir la volonté de Dieu? Sois donc attentif. Je pense que tout corps est composé de forme, d'une figure; s'il ne l'avait pas, il ne serait pas corps; et si elle était véritable, [153] il serait esprit. Faut-il penser différemment? A. J'accorde en partie ce que tu avances; je doute du reste. J'en conviens, un corps ne peut exister s'il n'a quelque figure ; mais je ne comprends pas comment il serait esprit s'il avait une figure véritable. L. R. As-tu donc oublié le commencement du premier livre et les figures de géométrie? A. Tu as raison de me les rappeler; je m'en souviens fort bien et avec plaisir. L. R. Est-ce que l'on trouve dans les corps les mêmes figures que cette science considère? A. On ne saurait croire, au contraire, combien elles sont moins parfaites. L. R. Lesquelles donc crois-tu vraies? A. Ne pense pas, je te prie , qu'il était nécessaire de me faire encore cette question. Qui aurait l'esprit assez aveugle pour ne pas voir que les figures géométriques sont dans la vérité même, ou que la vérité est en elles; au lieu que les figures des corps, précisément parce qu'elles paraissent se rapprocher de ces figures géométriques, présentent je ne sais quelle imitation du vrai, et sont par conséquent fausses? Je comprends maintenant tout ce que tu voulais me faire saisir.
CHAPITRE XIX. L'IMMORTALITÉ DE LA VÉRITÉ PROUVE L'IMMORTALITÉ DE LAME.
33. L. R. Qu'est-il donc besoin de parler encore de la science de l'argumentation? En effet, que les figures 'géométriques soient dans la vérité ou que la vérité soit en elles, personne ne doute que notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, ne le conçoive : la vérité est donc aussi dans notre intelligence. Or, si chaque science est dans notre âme comme dans un sujet dont elle est inséparable, et si, d'un autre côté, la vérité ne peut périr, comment pouvons-nous, je te le demande, douter de la vie immortelle de l'âme, quoique trompés par je ne sais quelle familiarité avec l'idée de la mort? Est-ce que cette ligne, ou ce carré, ou ce cercle ont besoin d'imiter quelque autre chose pour être vrais? A. Je ne puis le penser, car il faudrait supposer que la ligne soit autre chose qu'une longueur sans largeur, et le cercle autre chose qu'une ligne courbe dont tous les points sont également éloignés du centre. L. R. Pourquoi donc hésiter? Là, où ces connaissances existent, la vérité n'existe-t-elle pas? A. Que Dieu m'éloigne de croire une pareille folie. L. R. La science n'est-elle pas dans l'âme? A. Qui oserait le nier? L. R. Mais, le sujet périssant, ce qui est dans le sujet peut-il exister? A. Qui pourrait me le persuader? L. R. Il reste à supposer que la vérité peut périr? A. Comment cela serait-il possible? L. R. L'âme est donc immortelle crois-en, enfin, tes propres arguments, crois en la vérité. Elle crie qu'elle est en toi et qu'elle est immortelle, et que la mort du corps ne peut la chasser de son siège. Ne te laisse plus séduire par ton ombre, rentre en toi-même, tu n'as plus d'autre mort à redouter que d'oublier que tu ne peux mourir. A. Je t'entends, je rentre en moi-même, je commence à me recueillir ; mais je te prie de m'expliquer ce qui reste encore à éclaircir, comment la science et la vérité peuvent exister dans l'âme d'un ignorant, que nous ne pouvons considérer comme mortelle? L. R. Cette question fournirait la matière d'un autre traité si tu voulais l'examiner avec exactitude. Je pense qu'il vaut mieux pour toi repasser sur les points que nous venons d'éclaircir le mieux que nous avons pu. S'il ne reste plus aucun doute sur toutes les propositions accordées, je crois que notre travail a été fort utile et que nous pouvons nous livrer avec une grande sécurité à des recherches ultérieures.
CHAPITRE XX. LA VÉRITÉ EST DANS TOUTES LES AMES, MÊME A LEUR INSU.
34. A. La chose est comme tu le dis, et j'obéis volontiers à tes conseils. Mais, au moins, je te demande, avant de terminer ce livre, de m'expliquer en peu de mots la différence qu'il y a entre cette figure véritable que l'intelligence conçoit, et celle que se forme l'Imagination, désignée par les Grecs sous le nom de Phantasia ou Phantasma? L. R. Tu cherches ce qui ne peut être aperçu que par l'esprit le plus pur, et dont tu es encore peu capable de soutenir la vue. Aussi le but de nos longs circuits a été d'exercer ton esprit pour le disposer à contempler cette vérité. Il est possible, néanmoins, que je parvienne à t'enseigner brièvement et d'une manière facile la grande différence de ces deux manières de concevoir. Suppose que tu as oublié quelque [154] chose et que tu désires que les autres le rappellent à ta mémoire. Ils te disent : Est-ce ceci? est-ce cela? et désignent comme semblables des objets divers. Pour toi, tu ne vois pas ce que tu désires te rappeler, et tu vois cependant que ce n'est pas ce que l'on te désigne. Quand ce phénomène se présente, peut-on dire qu'il y a oubli complet? Ce discernement, qui te fait rejeter comme faux ce qu'on te propose, n'est-il pas une espèce de souvenir? A. La chose me parait telle. L. R. Alors donc on ne voit pas encore le vrai : toutefois on ne peut être ni trompé, ni abusé, et on sait distinctement ce qu'on cherche. Mais, si quelqu'un te disait que tu as ri peu de jours après ta naissance, tu n'oserais pas soutenir que c'est faux; et, si cet homme était digne de foi, tu ne te souviendrais pas, tu croirais; car ce premier âge est enseveli pour toi dans le plus profond oubli. Ne conviens-tu pas de ce que j'avance. A. Je suis complétement d'accord. L. R. Ce dernier oubli est donc bien différent du premier, qui tient le milieu. Il est, en effet, une autre espèce d'oubli, qui se rapproche beaucoup plus du souvenir et de la reconnaissance de la vérité. En voici un exemple : nous voyons une chose, et nous nous souvenons avec certitude de l'avoir déjà vue et connue, mais où, comment, quand et auprès de qui en avons-nous eu connaissance? C'est ce que nous essayons de nous rappeler. S'agit-il d'un homme? nous cherchons où nous l'avons connu. Vient-il à nous le rappeler? tout à coup la chose se répand comme une lumière dans notre mémoire, nous n'avons plus d'efforts a faire pour nous en souvenir. Es-tu, pour cette espèce de souvenir, dans l'ignorance ou dans le doute? A. Il n'est rien de plus clair, rien dont je fasse une expérience plus fréquente.
35. L. R. Tels sont les esprits bien formés aux sciences libérales : ils les tirent certainement d'eux-mêmes par l'étude, comme si elles y étaient ensevelies dans l'oubli, et ils les déterrent en quelque sorte (1). Cependant, ils ne sont point satisfaits et ne s'arrêtent pas qu'ils ne voient clairement et complètement la vérité elle-même, dont la splendeur voilée se laisse déjà entrevoir dans ces sciences. Mais, de ces sciences mêmes se détachent comme des couleurs et des formes qui se confondent sur le miroir de la pensée; elles trompent et égarent dans les méditations; on croit y voir tout ce
1. Rét. liv. I, ch. IV, n. 4.
que l'on sait ou tout ce que l'on recherche. Mais ce sont des illusions qu'on doit éviter avec grand soin; ce qui en prouve la fausseté, c'est qu'elles varient avec le miroir de la pensée, tandis que l'image de la vérité reste une et immuable. Ainsi l'imagination se représente, se met en quelque sorte devant les yeux un carré de telle et telle grandeur. Mais que l'esprit intérieur, qui veut voir le vrai, tourne plutôt son attention, s'il le peut, vers le principe qui lui fait juger que toutes ces figures sont des carrés. A. Et si on nous disait que l'esprit n'en juge que d'après le rapport de 1'il? L. R. Pourquoi donc juge-t-il, du moins, s'il est instruit, qu'une sphère véritable, quelque grande qu'elle soit , n'est touchée qu'en un seul point par une surface véritablement plane? L'oeil a-t-il jamais vu, peut-il voir jamais rien de pareil, puisque l'imagination même ne saurait se le représenter? Ne prouvons-nous pas cette impuissance, lorsque nous nous figurons un cercle infiniment petit, et que nous imaginons des lignes conduites de la circonférence au centre? Nous en tirons deux; elles sont assez rapprochées, pour permettre à peine de placer entre elles la pointe d'une aiguille. N'est-il pas vrai que l'imagination même ne peut alors sé représenter d'autres lignes intermédiaires qui puissent parvenir jusqu'au centre- sans se mêler.? Et pourtant, la raison nous dit que l'on peul en conduire d'innombrables, que dans cet espace incroyablement étroit, elles ne se toucheront qu'au centre, et que l'on pourrait encore placer un cercle dans l'intervalle qui sépare chacune d'elles. L'imagination étant incapable de se figurer rien de semblable, et se montrant plus impuissante que les yeux mêmes, car ce sont eux qui lui donnent naissance, il est évident qu'elle diffère beaucoup de la vérité et que l'on ne voit pas l'une en voyant l'autre (1).
36. Nous expliquerons cela avec plus de soin et de détail, lorsque nous traiterons de l'intelligence; et nous avons le projet de le faire quand nous aurons éclairci et démontré ce qui nous préoccupe encore touchant la survivance de l'âme. En effet, tu crains beaucoup, je crois, que la mort de l'homme, tout en ne détruisant pas Pâme, n'anéantisse toutes ses connaissances et ne le
1. C'est, en effet, une distinction très-importante à établir que celle indiquée ici par saint Augustin, entre l'imagination et la contemplation intellectuelle; et ce qui fait que tant d'hommes s'égarent en philosophie, cest que trop habitués à imager, ils ne conçoivent pas.
155
plonge dans l'oubli de toute vérité qu'il serait parvenu à découvrir. A. On ne peut assez exprimer combien un tel malheur est à redouter. Que cette immortalité serait triste, et quelle mort ne devrait-on pas préférer, si l'âme était condamnée à vivre comme nous la voyons vivre dans l'enfant qui vient de naître, pour ne point parler de celle qu'il a dans le sein de sa mère; car je pense qu'elle n'est point nulle. L. R. Sois plein de confiance, Dieu viendra à notre secours; nous l'expérimentons, il nous a déjà aidés dans nos recherches, et c'est lui qui nous promet, après cette vie terrestre, une vie bienheureuse, où la vérité se montrera à nous sans aucun voile et sans aucun mélange d'erreur. A. Que notre espérance ne soit pas déçue.
Cette traduction anonyme a été revue et corrigée par M. l'abbé RAULX
|