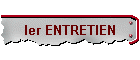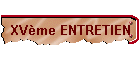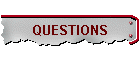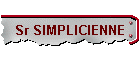|
|
QUINZIÈME ENTRETIENSUR LE SUJET DE LA TENDRETÉQUE LON A SUR SOI-MÊME
[DU JUGEMENT PROPRE]
Avant toutes choses il faut faire le signe de la Croix, et puis nous dirons quelques petites choses sur les deux questions qui mont été faites, bien que peu, afin de laisser du temps à nos Soeurs de me demander ce quelles voudront. La première est si dêtre attachée à sa propre opinion est une chose bien contraire à la perfection. Sur quoi je réponds quêtre sujet à avoir des propres opinions, ou ny être pas, est une chose qui nest ni bonne ni mauvaise, dautant que cela est tout naturel. Chacun n des opinions; mais pourtant cela ne nous empêche pas de parvenir à la perfection, pourvu que nous ne nous attachions pas à notre propre opinion ou que nous ne laimions pas, car cest cet amour de nos propres opinions qui est infiniment contraire à la perfection; cest ce que jai tant de fois dit, que lamour de notre propre jugement et lestime que lon en fait est la cause quil y n si peu de parfaits. Renoncer à la propre volonté, il sen trouve beaucoup qui le font, les uns pour un sujet, les autres pour un autre ; je ne dis pas seulement en Religion, mais dans les cours mêmes. Si un prince commande quelque chose à un courtisan, il ne refusera jamais; mais avouer que le commandement soit bien fait, cela se fait grandement 1 rarement. Je ferai bien ce que vous me commandez, en cette même façon que vous me dites, mais... Ils demeurent toujours sur leur mais, qui veut autant dire quils savent bien quil serait mieux autrement. Nul ne peut douter, mes chères Filles, que ceci ne soit fort contraire à lacquisition de la perfection, car il produit pour lordinaire des inquiétudes desprit, des bizarreries, des murmures, et enfin il nourrit lamour que nous avons de notre propre estime; de manière donc que la propre opinion ne doit pas être aimée ni estimée. Mais il faut que je vous dise quil y a des personnes qui doivent former leur opinion, comme sont les Supérieurs qui ont charge des autres, les Evêques, et ainsi de ceux qui ont quelque charge de gouvernement. Mais les autres ne le doivent nullement faire, si lobéissance ne le leur ordonne; car autrement ils perdraient le temps qui doit être employé à se tenir fidèlement auprès de Dieu. Et comme ceux-ci seraient estimés peu attentifs à leur propre perfection et personnes inutilement occupées, sils voulaient former et sarrêter à considérer leurs propres opinions, de même les Supérieurs devraient être estimés peu capables de leur charge, sils ne voulaient enfin prendre quelque résolution sur les choses qui leur sont proposées, ou faire des considérations pour bien appuyer leurs opinions. Car ce serait une chose malséante de les voir toujours irrésolus en leurs opinions; mais pourtant, si ne doivent-ils pas agréer, ni sappuyer
1. très
ou attacher à leurs propres opinions, car cest ce qui est contraire à leur perfection. Le grand saint Thomas, qui avait un esprit le plus grand que lon saurait avoir, quand il formait quelque opinion, il lassurait ou appuyait sur des raisons les plus prégnantes 2 quil se pût faire; et si néanmoins il se trouvait quelquun qui napprouvât pas ce quil avait jugé ou qui y contredît, il ne disputait point ni ne sen offensait point, mais souffrait cela de bon coeur; par où il témoignait bien quil naimait pas sa propre opinion, bien quil ne la désapprouvât pas aussi, ains laissait cela ainsi, quon le trouvât bon ou non. Après avoir fait son devoir, il ne se mettait pas en peine du reste. Les Apôtres nétaient pas attachés à leurs propres opinions, non pas même ès choses du gouvernement de lEglise, qui était une affaire si importante : si que, après avoir déterminé une affaire par la résolution quils en avaient prise, ils ne soffensaient point si lon opinait là-dessus et que quelques-uns refusassent de recevoir leurs opinions, quoique bonnes et justement fondées sur la raison; ils ne démordaient pas de leurs opinions quand elles étaient bien appuyées, mais pourtant ils ne cherchaient pas à les faire recevoir par des disputes ni contestes a 3. Si les Supérieurs voulaient changer dopinions à tous rencontres, ils seraient estimés légers et imprudents en leur gouvernement; mais si ceux qui nont point de charge voulaient être attachés à leurs opinions, les voulant former, assurer et
a. Act., XV, 7, 12, 13; 1 Cor., XI, 16.
2. pressantes 3. contestations
faire recevoir pour bonnes, ils seraient tenus pour opiniâtres; car cest une chose toute certaine que lamour de notre propre opinion dégénère en opiniâtreté sil nest fidèlement mortifié et retranché nous en voyons lexemple même entre les Apôtres. Cest une chose admirable que Notre-Seigneur ait permis que plusieurs choses dignes véritablement dêtre écrites, que les Apôtres ont faites, soient demeurées cachées sous un profond silence, et que cette imperfection que le grand saint Paul et saint Barnabé commirent ensemble ait été écrite. Cest sans doute une spéciale providence de Notre-Seigneur qui la voulu ainsi pour notre instruction particulière b. Ils sen allaient tous deux pour prêcher lEvangile ensemble et menaient quant et eux un jeune homme nommé Jean-Marc, lequel était parent de saint Barnabé. Ces deux grands Apôtres tombèrent en dispute sils le mèneraient plus loin ou sils le laisseraient, et sétant trouvés de contraire opinion sur ce fait, ne se pouvant accorder, se séparèrent lun de lautre c. Or, dites-moi maintenant, devons-nous nous troubler quand lon voit quelques tels défauts parmi nous autres, puisque les Apôtres les commirent bien ? ils sattachèrent à leur opinion jusques à descendre à lopiniâtreté, en la voulant soutenir pour bonne. Il y a certes des grands esprits qui sont fort bons, mais qui sont tellement sujets à leurs opinions et les estiment si bonnes que jamais ils nen veulent démordre; si quil faut bien prendre garde de ne la leur pas demander à limprévu 4, de peur
b. Rom., XV, 4. c. Act., XV, 37-40.
4. à limproviste
quils ne la forment sans bonnes considérations, car après, il est presque impossible de leur faire reconnaître ou confesser quils ont failli, dautant quils se vont enfonçant si avant à la recherche des raisons propres à soutenir ce quils ont une fois dit être bon, quil ny a plus moyen, sils ne sadonnent à une excellente perfection, de les en faire dédire. Il y en a dautres qui, ayant des esprits grands et fort capables, ne sont pourtant pas sujets à cette imperfection, ains se démettent assez volontiers de leurs opinions. Bien quelles soient très bonnes, ils ne sarment pourtant pas à la défense quand on leur oppose quelque contrariété ou contraire opinion à celle quils ont jugée être bonne et bien assurée 5, ainsi que nous avons dit du grand saint Thomas. Par ainsi, vous voyez que cest une chose naturelle que dêtre sujet à ses opinions. Les personnes mélancoliques y sont pour lordinaire plus sujettes que non pas ceux R qui sont dhumeur joviale et gaie, car pour lordinaire, ceux-ci sont assez aisés à tourner à toutes mains et faciles à croire ce quon leur dit. La grande sainte Paule était opiniâtre à soutenir lopinion quelle avait formée de faire des grandes austérités, plutôt que de se soumettre à sen abstenir ; de même plusieurs autres Saints, lesquels estimaient quil fallait grandement macérer le corps pour plaire à Dieu, si quils refusaient pour cela dobéir au médecin et de faire autres telles choses propres à la conservation de ces corps périssables et mortels. Et bien que cela fût une imperfection, ils
5. sûre 6. que ceux 7. beaucoup
ne laissèrent pas dêtre saints et fort agréables à Dieu; ce qui nous apprend que nous ne nous devons pas troubler quand nous apercevons en nous des imperfections ou des inclinations contraires à la vraie perfection, pourvu quon ne se rende pas opiniâtre à vouloir persévérer en icelles; car et sainte Paule et les autres qui se rendirent opiniâtres, quoique ce fût en peu de chose, ont été répréhensibles en cela. Quant à nous autres, il ne faut jamais que nous laissions tellement former nos opinions que nous nen déprenions 8 volontiers quand il est de besoin 9, soit que nous soyons obligés ou non de les former. Ceux qui sont adonnés à leur propre jugement se vont enfonçant presque continuellement à la recherche des raisons propres à soutenir ce quils ont une fois compris; ceci est naturel, mais de sy laisser aller, ce serait une imperfection notable. Dites-moi, nest-ce pas perdre le temps inutilement, spécialement ceux qui nont pas charge de le faire? Vous me dites ce que cest quil faut faire pour mortifier cette inclination? Il lui faut retrancher la nourriture. Vous vient-il en pensée quon a tort de faire faire cela de la sorte, quil serait mieux ainsi que vous lavez conçu, détournez-vous de cette pensée en disant en vous-même : Hélas! quai-je à faire de telle chose, puisquelle ne mest pas commise. Il est toujours beaucoup mieux fait de sen détourner ainsi tout simplement, que non pas de rechercher des raisons en notre esprit pour nous faire croire que nous avons
8. nous ne nous en déprenions 9. il en est besoin, cest nécessaire
tort; car au lieu de le faire, votre entendement, qui est préoccupé de son jugement particulier, vous donnera le change, et au lieu danéantir et désapprouver lopinion que vous aviez conçue, il vous donnera des raisons pour la maintenir et faire reconnaître pour bonne. Il est toujours mieux de faire comme je viens de dire, de la mépriser sans la vouloir regarder, la chasser si promptement quand on laperçoit que lon ne sache pas ce quelle voulait dire. O ma fille, il ne faut pas être si rigoureux à soi-même que dempêcher ce premier mouvement de complaisance qui nous vient quand notre opinion est approuvée et suivie, car cela ne se peut autrement, mais il ne se faut pas amuser à cette complaisance; il en faut bénir Dieu, puis passer outre sans se mettre en peine de cela, non plus que dun petit ressentiment de douleur qui nous viendrait si elle nétait pas suivie ni approuvée. Il faut quand on est requis, ou par la charité ou par lobéissance, proposer ou avancer notre opinion sur le sujet dont il est question; mais au demeurant, il faut se rendre indifférent si elle sera reçue ou non. Il faut même opiner aucunes fois sur les opinions des autres et remontrer 10 les raisons sur quoi nous avons appuyé les nôtres; mais il faut que cela se fasse modestement et humblement, sans mépriser celles des autres, ni contester pour faire recevoir les nôtres. Dites-vous si ce nest pas nourrir cette imperfection que de rechercher 11 den parler avec ceux qui ont été de notre avis, lorsquil nest plus
10. faire remarquer 11. chercher
question dy prendre nulle résolution, étant déjà déterminé ce qui sen doit faire ? Qui en doute, ma chère fille, que ce ne soit nourrir nôtre inclination, et par conséquent commettre de limperfection 12; car cest la vraie marque que lon ne sest pas soumis à lavis des autres et que lon préfère toujours le nôtre particulier. La chose qui a été proposée étant déterminée, il nen faut plus parler non plus quy penser, sinon que ce fût une chose notablement mauvaise; car alors, sil se pouvait encore trouver quelque invention pour en détourner lexécution, ou y mettre remède étant déjà faite, il le faudrait faire le plus charitablement quil se pourrait et le plus insensiblement, afin de ne troubler personne ni mépriser ce qui aurait été trouvé bon ou jugé à propos. Le meilleur remède à ceci est donc, comme jai déjà dit en termes différents, de négliger ce qui nous vient en pensée pour ce regard 13, nous appliquant à quelque chose meilleure 14 car si nous nous voulons laisser aller à faire attention sur 15 toutes les opinions que notre propre jugement nous suggèrera en diverses rencontres et occasions, quarrivera-t-il, sinon une continuelle distraction des 16 choses plus utiles qui sont propres à notre perfection, nous rendant incapables et inhabiles pour la sainte oraison? Car, ayant donné la liberté à notre esprit de samuser à la considération de telles tricheries 17, il senfoncera toujours plus avant et nous produira pensées sur pensées, opinions sur opinions et raisons sur raisons qui
12. une imperfection 13. pour ce sujet, à ce sujet 14. de meilleur 15. à 16. davec les 17. choses de rien
nous importuneront merveilleusement au temps de loraison. Car loraison nétant autre chose quune application totale de notre esprit avec toutes ses facultés en Dieu, étant lassé à la poursuite des choses inutiles, sera dautant moins habile et apte à la considération des mystères sur lesquels on veut faire loraison. Voilà donc ce que javais à vous dire sur le sujet de la première question, par laquelle nous avons été enseignés que davoir des opinions nest pas contraire à la perfection, mais oui bien davoir lamour de nos propres opinions et lestime par conséquent; car si nous ne les estimions pas, nous nen serions pas si amoureux, et si nous ne les aimions pas, nous ne nous soucierions guère quelles fussent approuvées, et ne serions pas si faciles à dire : Les autres croiront ce quils voudront, mais quant à moi... Savez-vous que veut dire ce quant à moi? Je ne me soumettrai point, ains serai ferme en ma résolution et en mon opinion. Cest, comme jai dit plusieurs fois, la dernière chose que nous quittons que notre propre jugement, et pourtant cest une des choses les plus nécessaires à quitter et renoncer pour lacquisition de la vraie perfection; car autrement, nous nacquerrons pas lhumilité qui nous empêche et nous défend de faire aucune estime de nous, ni de tout ce qui en dépend; et partant, si nous navons la pratique de cette vertu en grande recommandation, nous penserons toujours être quelque chose de meilleur que nous ne sommes, et que les autres nous en doivent de reste. Or, cest assez dit sur ce sujet. Si vous ne demandez rien davantage, nous passerons à la seconde question, qui est si la tendreté que nous avons sur nous-mêmes nous empêche beaucoup au chemin de la perfection. Ce que pour mieux entendre, il faut que je vous ressouvienne de ce que vous savez très bien, que nous avons en nous deux amours, lamour affectif et lamour effectif; et cela est aussi bien en lamour que nous avons pour Dieu quen celui que nous avons pour le prochain et pour nous-même encore. Mais nous ne parlerons pas de celui que nous portons à Dieu, ains de celui du prochain, et puis nous retournerons à nous-mêmes. Les théologiens ont accoutumé 18, pour faire bien comprendre la différence entre ces deux amours, de se servir de la comparaison dun père lequel a deux fils, dont lun est un petit mignon encore tout enfant, de bonne grâce, et lautre est homme fait, brave et généreux soldat, ou bien à quelque autre condition telle que lon voudra. Le père aime grandement ses deux fils, mais damour différent, car il aime ce petit dun amour extrêmement tendre et affectif. Regardez-le, je vous prie, quest-ce quil ne permet pas de faire à ce poupon autour de lui? Il permet quil lui entortille la barbe autour de sa main, quil la plie ou peigne ; il le dorlotte, il le tient avec une suavité non pareille, tant pour lenfant que pour lui, sur ses genoux ou entre ses bras, il le baise et rebaise. Si lenfant a été piqué dune abeille, il ne cesse de souffler dessus le mal, jusques à tant que la douleur soit apaisée; que si, au contraire, son fils aîné avait été piqué de trente
18. ont lhabitude
abeilles, il nen daignerait tourner son pied, bien quil laime dun amour grandement fort et solide. Considérez, je vous prie, la différence de ces deux amours; car bien que vous ayez vu la tendreté que ce père a peur son petit, il ne laisse pourtant pas de faire dessein de le mettre hors de sa maison et le faire chevalier de Malte, destinant son aîné pour son héritier et successeur de ses biens. Celui-ci donc est aimé de lamour effectif, et le petit de lamour affectif; lun et lautre sont aimés, mais différemment. Lamour que nous avons pour nous-mêmes est de cette sorte, car il est affectif et effectif. Lamour effectif est celui qui gouverne les grands, ambitieux dhonneurs et de richesses, qui se procurent tant de biens et qui ne se rassasient jamais den acquérir : ceux-là, dis-je, saiment grandement de cet amour effectif. Mais il y en n dautres qui saiment plus de lamour affectif: ceux-ci sont grandement tendres deux-mêmes, et ne font jamais autre chose que de se dorloter, mignarder et conserver; ils craignent tant tout ce qui leur pourrait nuire que cest grande pitié. Sils sont malades, quand bien ils nauraient mal quau bout du doigt, il ny a rien de plus mal quils sont; ils sont si misérables! Nul mal, pour grand quil soit, nest comparable à celui quils souffrent, et lon ne peut trouver jamais assez de médecins pour les guérir; ils ne cessent de se médeciner, et pensant conserver leur santé, ils la perdent et ruinent tout à fait si les autres sont malades, ce nest rien. Enfin, il ny a queux qui soient à plaindre, et pleurent tendrement sur eux-mêmes, si quils tâchent fort démouvoir ceux qui les voient à compassion; ils ne se soucient guère quon les estime patients, pourvu quon les croie bien malades et affligés imperfection, certes, propre aux enfants, et, si je lose dire, aux femmes, et encore entre les hommes à ceux qui sont dun courage efféminé et peu courageux; car entre les généreux, cette imperfection ne se rencontre point. Les esprits bien faits ne sarrêtent pas à ces niaiseries et fades tendretés qui ne sont propres que pour nous arrêter en la voie de notre perfection. Ne pouvoir souffrir que lon nous estime tendres, nest-ce pas lêtre grandement? Jai une histoire, dès que je passai de Paris à une Maison religieuse, qui sert à mon propos; et certes, jeus plus de consolation en ce 19 rencontre que je nen avais eu en tout mon voyage, bien que jeusse fait rencontre de beaucoup dâmes fort vertueuses; mais celle-ci me consola entre toutes. Il y avait en cette Maison une fille en son essai qui était merveilleusement douce, maniable, soumise et obéissante, enfin elle avait les conditions plus nécessaires pour être vraie Religieuse en la Visitation. Il arriva par malheur que les Soeurs remarquèrent en elle une imperfection et une tare corporelle 20 qui fut cause quelles commencèrent à mettre en doute si pour cela on la devait renvoyer. La Mère laimait fort et il lui fâchait de le faire; néanmoins les Soeurs sarrêtaient fort sur cette incommodité corporelle. Or, quand je passai, le différend fut remis à moi pour en déterminer selon que je jugerais devoir être fait ; si que cette bonne
19. cette 20. défaut corporel
fille, qui est de bonne maison, fut amenée devant moi, où étant, elle se mit à genoux et me dit : Il est vrai, Monsieur, que jai une telle imperfection, qui est certes assez honteuse (la nommant tout haut avec une simplicité grande). Je confesse que nos Soeurs ont bien grande raison de ne me pas vouloir recevoir, car je suis insupportable en mon défaut; mais je vous supplie de mêtre favorable, vous assurant que si elles me reçoivent, exerçant ainsi la charité en mon endroit, jaurai un grand soin de ne les point incommoder, me soumettant de bon coeur à faire le jardin, ou à être employée à dautres offices quels quils soient qui me tiennent éloignée de leur compagnie, afin que je ne les incommode point. Oh! certes, cette fille nétait guère tendre delle SI même! Je ne me pus tenir de dire que je voudrais de bon coeur avoir le même défaut naturel, et avoir le courage de le dire devant tout le monde avec la même simplicité quelle fit devant moi. Elle navait pas si peur dêtre mésestimée, comme plusieurs autres, et nétait pas si tendre dessus soi-même; elle ne faisait pas toutes ces considérations vaines et inutiles : Que dira la Supérieure si je lui dis ceci ou cela ? mais si je lui vais demander quelque soulagement. elle dira ou pensera que je suis bien tendre. Et pourquoi, sil est vrai, ne voudriez-vous pas quelle le pense? Mais quand je le lui dis, elle me fait une mine si sèche quil me semble quelle ne lagrée pas. Il se peut bien faire que la Supérieure, ayant assez dautres choses en lesprit, ne fera pas toujours
21. sur elle
attention à rire ou parler fort gracieusement quand vous lui dites votre mal; et cest ce qui vous fâche et vous ôte, dites-vous, la confiance de lui aller dire vos incommodités. O Dieu, mes chères Filles, cela sont des enfances; il faut aller simple-ment. Si la Supérieure ou la Maîtresse Pe vous ont pas bien reçues comme vous voudriez bien, une fois, voire plusieurs, il ne faut pas se fâcher pourtant, ni juger quelle fera toujours de même; oh non, Notre-Seigneur la touchera peut-être de son esprit de suavité pour la rendre plus agréable à votre premier retour. Il ne faut pas être si tendre que de vouloir dire toujours toutes les incommodités que nous avons, quand elles ne sont pas dimportance : un petit mal de tête ou un petit mal de dents qui sera peut-être bientôt passé, si vous le voulez porter pour lamour de Dieu, il nest pas besoin que vous lalliez dire pour vous faire un peu plaindre. Dites-vous que vous ne le dites pas à la Supérieure ou à celle qui vous peut faire prendre du soulagement, mais oui bien facilement aux autres, parce que vous voulez souffrir cela pour Dieu. O ma chère fille, si cela était que vous le voulussiez souffrir pour Dieu, ainsi que vous dites, vous ne liriez pas dire à une autre que vous savez bien qui se sentira obligée à déclarer votre mal à la Supérieure; et par ce moyen, vous aurez, en biaisant, le soulagement que tout à la bonne foi vous eussiez mieux fait de demander tout simplement à celle qui vous pouvait donner congé; car vous savez bien que la Soeur à qui vous dites que la tête vous fait bien mal, na pas le pouvoir de vous dire : Allez vous coucher. Ce ne peut être donc à autre intention, bien que lon ne le fasse pas à dessein, sinon dêtre un peu plainte par cette Soeur, et cela fait grand bien à lamour-propre. Or, si cest par rencontre que vous le dites, les Soeurs vous demandant peut-être comme vous vous portez à cette heure-là, il ny a point de mal, pourvu que vous le disiez tout simplement, sans lagrandir ou vous lamenter; mais hors de là il ne le faut dire sinon à la Supérieure ou à la Maîtresse. Vous répliquez que si vous le dites à la Supérieure vous craignez de vous attendrir en le disant. Ne le dites donc pas si le mal ne le requiert, je veux dire quil ne soit pas dimportance. Japprouve grandement la coutume des Soeurs Carmélites, de ne point se plaindre ni découvrir leurs incommodités à autres sinon à la Supérieure, et les Novices à la Maîtresse. Il ne faut pas craindre non plus, bien quelles soient un peu rigoureuses à faire la correction sur tel défaut, car vous ne leur ôtez pas la confiance de vous la faire : allez donc tout simplement leur dire votre mal. Oh! je crois bien du, que vous prenez plus de plaisir de le dire à celles qui nont point charge de vous soulager; car tandis que vous faites ainsi, chacun plaint ma Soeur lAssistante et se met-on en besogne pour lui pourvoir 22 les remèdes, au lieu que si vous lalliez dire à la Soeur qui a charge de vous, il faudrait entrer en sujétion de faire ce quelle ordonnerait : et cependant, cest cette bénite sujétion que nous évitons toujours de tout notre coeur, lamour-propre recherchant dêtre
22. procurer
gouvernante de nous-même et maîtresse de notre propre volonté. Mais si je dis que jai mal à la tête, la Supérieure me dira que je maille coucher. Et bien, quimporte? si vous navez pas assez de mal pour cela, il ne vous coûtera guère de dire Ma Mère ou ma Soeur, je nai pas assez de mal pour cela, ce me semble. Et si elle dit après que vous ne laissiez pas pourtant 23, vous irez tout simplement ; car il faut observer toujours une grande simplicité en toutes choses. Marcher simplement est une voie grandement agréable à Dieu et très assurée. Que dites-vous, ma chère fille ? si voyant une Soeur qui a quelque peine en lesprit, ou quelque incommodité, navoir pas la confiance ou le courage de se surmonter à vous la venir dire, et vous apercevant bien que, faute de le faire, cela la porte à quelque humeur mélancolique, si vous devez lattirer ou bien la laisser venir delle-même? A cela, il faut que la considération gouverne, car quelquefois il faut condescendre à leur tendreté en les appelant et sinformant quil 24 y a, et dautres fois il faut mortifier ces petites bizarreries en les laissant, comme qui dirait: Vous ne voulez pas vous surmonter à demander le remède propre à votre peine, souffrez-la donc à la bonne heure, vous méritez bien cela. Cette tendreté est beaucoup plus insupportable aux choses de lesprit que non pas aux corporelles; et si, elle est par malheur plus pratiquée ou nourrie par les personnes les plus spirituelles, lesquelles voudraient être saintes du premier coup, et ne
23. dy aller 24. de ce quil
voudraient pas néanmoins quil leur coutât rien, non pas même les combats que leur cause la partie inférieure par les ressentiments n quelle a ès choses contraires à la nature; et cependant, veuillons-nous ou non, il faudra que nous ayons le courage de souffrir et résister à ces efforts tout le temps de notre vie en plusieurs petites rencontres, si nous ne voulons faire banqueroute à la perfection que nous avons entreprise. Je désire grandement que lon distingue toujours les effets de la partie supérieure de notre âme davec les effets de la partie inférieure, et que nous ne nous étonnions jamais des productions de linférieure, pour mauvaises quelles puissent être; car cela nest nullement capable de nous arrêter en chemin, pourvu que nous nous tenions fermes en la partie supérieure pour aller toujours avant en la voie de la perfection, sans nous amuser et perdre le temps à nous plaindre que nous sommes imparfaits et dignes de compassion, comme si lon ne devait faire autre chose que de plaindre, notre misère et infortune dêtre si tardifs à venir à chef de notre entreprise. Cette bonne fille de laquelle nous avons parlé, ne sattendrit nullement en parlant de son défaut, ains elle me le dit avec un coeur et une contenance fort assurée, en quoi elle me plut davantage; car nous autres, il nous fait si grand bien de pleurer un peu sur nos défauts, cela contente tant lamour-propre! Il faut, mes chères Filles, être plus généreuses et ne sétonner nullement de nous voir sujettes à mille sortes dimperfections, et avoir
25. répugnances
néanmoins un grand courage pour mépriser nos inclinations, nos humeurs, bizarreries et attendrissements, mortifiant fidèlement tout cela en chaque rencontre. Que si néanmoins il nous échappe dy faire des fautes par ci par là, ne nous arrêtons pourtant pas, mais relevons notre courage pour être plus fidèles à la première occasion et passons outre, faisant du chemin en la voie de Dieu et au renoncement de nous-mêmes. Que dites-vous, ma fille, si la Supérieure vous voyant faire mauvaise mine vous demande que vous avez, et vous voyant prou de choses en lesprit pêle-mêle qui vous fâchent, ne pouvez pourtant dire ce que cest, comme il faut que vous fassiez? Il faut dire cela ainsi tout simplement: Jai plusieurs choses en lesprit, mais je ne sais que cest. Vous craignez, dites-vous, que la Supérieure pense que vous navez pas la confiance de le lui dire. Que vous doit-il soucier quelle le pense ou quelle ne le pense pas ? pourvu que vous fassiez votre devoir, de quoi vous mettez-vous en peine? Ce, que dira-t-on si je fais ceci ou cela, ou quest-ce que la Supérieure pensera, est grandement contraire à la perfection quand on sy arrête; car il faut toujours se souvenir en tout ce que je dis, que je nentends point parler de ce que fait ou dit la partie inférieure, car je nen fais nul état. Cest donc à la partie supérieure que je dis quil faut mépriser ce que dira-t-on ou que pensera-t-on? Cela vous vient quand vous avez rendu compte, parce que vous navez pas assez dit de fautes particulières vous pensez, dites-vous, que la Supérieure dira ou pensera que vous ne lui voulez pas tout dire. Cen est de même des redditions de compte comme de la confession ; il faut avoir une égale simplicité en lune comme en lautre. Or, dites-moi, faudrait-il dire : Si je me confesse de telle chose, que dira mon confesseur ou que pensera-t-il de moi ? Nullement, il pensera et dira ce quil voudra; pourvu quil mait donné labsolution et que jaie rendu mon devoir, il me suffit. Et comme après la confession il nest pas temps de sexaminer pour voir si lon a bien dit tout ce que lon a fait, ains cest le temps de se tenir attentif et tranquille auprès de Dieu avec lequel nous nous sommes réconciliés et lui rendre grâce de ses bienfaits, nétant nullement nécessaire de faire la recherche de ce que nous pourrions avoir oublié, de même en est-il après avoir rendu compte : il faut dire tout simplement ce qui nous vient; après, il ny faut plus penser. Mais aussi, comme ce ne serait pas aller à la confession bien préparé que de ne vouloir pas sexaminer, de crainte de trouver quelque chose digne de se confesser 26, de même il ne faudrait pas négliger de rentrer en soi-même, ou se divertir pour ne pas se ressouvenir de ce que lon a fait, afin den rendre compte selon lordinaire. Il ne faut aussi être si tendre à vouloir tout dire, ni recourir aux Supérieurs pour crier holà! à la moindre petite peine que vous avez, laquelle peut-être sera passée dans un quart dheure. Il faut bien apprendre à souffrir un peu généreusement ces petites choses auxquelles nous ne pouvons
26. qui méritât dêtre accusée en confession
remédier, étant des nouvelles productions, pour lordinaire, de notre nature imparfaite: comme sont ces inconstances dhumeurs, de volontés, de désirs, qui produisent tantôt un peu de chagrin, tantôt une envie de parler et puis tout pour un coup 27 une aversion grande de le faire, et choses semblables auxquelles nous sommes sujets tant que nous sommes en cette vie périssable et passagère. Mais quant à cette peine que vous dites que vous avez, laquelle vous ôte le moyen de vous tenir attentive à Dieu si vous ne lallez incontinent dire à la Supérieure, à cela je vous dis quil faut remarquer quelle ne vous ôte pas peut-être lattention à la présence de Dieu, ains plutôt la suavité de cette attention. Or, si ce nest que cela, si vous avez bien le courage et la volonté, ainsi que vous dites, de la souffrir sans rechercher du soulagement, je vous dis que vous ferez très bien de le faire, bien quelle vous apportât un peu dinquiétude, pourvu quelle ne fût pas grande. Mais si elle vous ôtait le moyen de vous tenir proche de Dieu, à cette heure-là il le faudrait aller dire à la Supérieure, non pas pour vous soulager, mais pour gagner chemin en la présence de Dieu, bien quil ny aurait pas grand mal de le faire pour vous soulager. Cest une grande pitié, certes, que la Supérieure dise : Faites ce quil vous plaira, quand on lui demande pour lui parler. Si elle vous remet à votre volonté, il faut considérer lequel est mieux, de le faire ou de ne le faire pas, et puis se résoudre, car il ne faut pas perdre le temps.
27. tout à coup
Mais dites-vous, ma chère fille, si les Soeurs ont une Supérieure de si mauvaise grâce quelle ne les reçoive point avec lesprit de suavité, quand elles viennent à elle, soit quand elles ont besoin de lui parler ou quelles demandent quelque congé, et par ce moyen leur ôte la confiance de recourir à elle en leurs nécessités, sil leur serait point permis de sadresser à celle qui tient sa place et son autorité quand elle ny est pas, sous le prétexte de ne pas tant importuner la Supérieure, et de plus, afin davoir le congé que peut-être elle ne leur donnerait pas ? Oh! non certes, ma chère Soeur, lon ne doit pas faire cela, sinon que la Supérieure fût tellement empêchée que lon lincommodât bien de lui parler. Or, je sais bien que, quand elle nest pas aux Assemblées, il ne la faudrait pas aller chercher pour lui demander congé den sortir. Nest-ce pas être bien tendre de ne vouloir pas sadresser à la Supérieure parce quelle est de mauvaise grâce ? Si elle continue à mal recevoir les Soeurs qui viennent en simplicité de coeur sadresser à elle, je confesse bien quelle fait mal et est bien imparfaite; mais les Soeurs pour cela ne doivent pas laisser de rendre leur devoir tout simplement, sadressant à elle comme à leur Mère, avec une confiance toute filiale. Mais elle me refuse pour lordinaire tout ce que je lui demande. Cest tout un, il ne faut pas laisser pourtant de lui demander ce qui semblera être bon de faire; et quant à cette considération quelle peut être importunée de vous, elle est vaine, il la faut retrancher. Mais elle ne fait pas ainsi aux autres. Cela peut bien être. Et partant, je pense quelle ne maime pas tant. Oh! cest là que je vous attendais, car cest toujours notre rendez-vous général que de revenir à nous-mêmes; nous ne sommes jamais assez aimées ou estimées de la Supérieure, qui est une chose très importante pour notre consolation. Que nous doit-il importer, pourvu que nous rendions notre devoir en son endroit, quelle nous aime ou quelle ne nous aime pas ? Oh ! dà, ma chère fille, je ne dis pas quil faille dire par esprit de mépris de la Supérieure que nous ne nous soucions pas quelle nous aime, ains plutôt par mépris de nous-même et avec intention de nous dépouiller de cette vaine affection que nous avons dêtre aimée. En quoi voulons-nous nous mortifier sinon ès occasions de contradiction qui nous arrivent? Mes chères Filles, il faut écorcher la victime si nous voulons quelle soit agréable à Dieu. En lancienne Loi d, Dieu ne voulait point que lholocauste lui fût offert, si premier 28 il nétait écorché : de même, nos coeurs ne seront jamais si propres pour être immolés et sacrifiés à lhonneur de la divine Majesté, que quand ils seront bien écorchés de leur vieille peau, qui sont nos habitudes, nos inclinations, nos répugnances, les affections superflues que nous avons sur nous-mêmes et pour notre propre volonté. Cest un grand cas 29! mais jai une si puissante répugnance daller parler à cette heure à la Supérieure, pour la présomption que jai quelle me mortifiera. Cest ici où il y va du bon; car un acte de mortification fait avec une grande
d. Levit., I, 1-6.
28. dabord 29. cest une chose surprenante
répugnance, est infiniment propre pour nous mettre fort avant en la perfection. Ce serait une chose grandement agréable si lon pouvait faire que la Supérieure eût toujours le miel sur les lèvres pour distiller sa suavité et sa douceur dans le coeur de celles qui lui voudraient parler, et que ce fût toujours. Mais ce quelle me dit ne me sert de rien pour ma consolation à cette heure que jai le coeur en amertume; et cest peut-être parce quelle ne me parle pas assez gracieusement selon que je désirerais. Oh! sans doute, cest cela; mais que faut-il faire? Il se faut moquer de tout cela comme étant des enfances. Sommes-nous consolées ? bénissons Dieu; la consolation nous manque-t-elle ? bénissons-le semblablement, et ne nous étonnons point de ces petites bizarreries. Mais si les Soeurs ne doivent pas perdre la confiance de sadresser à la Supérieure, encore quelles y aient de la répugnance, de même la Supérieure ne doit pas sabstenir de leur commander ou ordonner quelque chose, encore que les Soeurs lui témoignent de la répugnance; sinon que, apercevant une grande et puissante aversion en la Soeur, elle trouvât bon de différer un peu de temps à lexercer en la mortification, car il ne faut pas être toujours si rigoureux. Mais, mon Dieu, que les Soeurs qui auraient une Supérieure qui ne les aimerait pas seraient heureuses! bien que cela ne se puisse, car la Supérieure aime toujours les Soeurs de cet amour effectif dont nous avons parlé, leur procurant tout le bien quelle peut par lexercice de sa charge, selon quelle y est obligée; mais de cet amour affectif, tendre et mignard 30, que nous désirons si chèrement 31, cest de celui-là que je veux dire; car moins la Supérieure nous aimera de cette sorte, et moins damusement nous aurons autour de cet amour, si que nous aurons plus de temps pour nous tenir retirées auprès de Dieu, qui doit être notre soin particulier. Qui ne voit que cest par esprit de jalousie que vous entrez en humeur de quoi cette Soeur se tient si près de la Supérieure et témoigne trop tendrement son affection ? Dites-vous, ma chère fille, que ce nest pas cela, ains seulement laversion que vous avez à ces fades caresses. Or, pour cela, il nen faut pas avoir de laversion, ou du moins ne sy faut-il pas laisser aller, ains secouer notre esprit pour len divertir. Si la Soeur suit un peu trop son inclination à cette heure, vous en ferez peut-être autant bientôt après en une autre occasion, et partant il la faut supporter. Il nous faut user du même remède pour nous divertir de ces petites tricheries dhumeur, de chagrin, daversion, que nous avons dit touchant la première question du renoncement de la propre opinion, par un simple divertissement 32 de notre esprit, pour parler à Dieu dautre chose. Car, comme lamour de la propre opinion, quand elle sattache ès choses de la foi, nous fait tomber en hérésie, et nous rend malheureux (comme il advint aux Anges, qui, sétant trop attachés à lopinion quils avaient formée quils devaient être quelque chose davantage quils nétaient, furent par leur opiniâtreté à soutenir et aimer leur opinion rendus dAnges
30. délicat, gracieux 31. ardemment, avec grande affection 32. action de se détourner
glorieux, diables, éternellement damnés et éternellement attachés au mal, si que jamais plus ils ne sen peuvent déprendre; où au contraire, les Anges, pour sêtre soumis, se sont tellement attachés à Dieu que jamais ils nen peuvent être détachés, car ayant par la subtilité de leur esprit une fois pénétré le fond de quelque vérité, ils nen démordent jamais), de même, si nous napprenons à négliger et nous moquer de la variété de lesprit humain, nous perdrons le temps à nous tourmenter en nous voyant si éloignés de cette égalité après laquelle nous aspirons, et de laquelle pourtant nous ne jouirons point absolument tandis que nous serons en cette vie, cette grâce étant réservée aux esprits bienheureux là-haut au Ciel. Et bien que, comme je viens de dire, nous ne la puissions pas avoir absolument en sa perfection en cette vie, nous devons pourtant tâcher de lavoir au plus grand degré que nous pourrons. Or sus, navons-nous pas assez dit touchant cette tendreté que nous avons sur nous-même, tant de lintérieur qui regarde lesprit, comme des choses qui regardent le corps ? Les plus spirituels saiment bien aussi de lamour effectif; car nous avons dit que les mondains saiment grandement de cet amour, se souhaitant, par une affection pleine dambition, tant de biens et tant dhonneurs quils nen sont jamais contents. Les personnes qui font état de servir Dieu le plus fidèlement quelles peuvent, ne sont pas exemptes de lambition, mais elle sexerce au désir des choses intérieures, souhaitant les vertus au plus haut degré de leur perfection; mais lamour tendre et affectif ayant plus de pouvoir sur eux que non pas sur les mondains, les fait amuser à ce désir sans sappliquer soigneusement et laborieusement à la recherche de venir à chef de leur prétention, parce quil leur coûterait cher de renoncer à soi-même en tant doccasions. Répugner à nos répugnances, décliner de nos inclinations, mortifier nos affections, mortifier le propre jugement et renoncer à la propre volonté est une chose que lamour affectif et mignard que nous nous portons à nous-mêmes ne nous peut permettre sans crier : holà! que cela fait de la peine! Et cela est cause que nous ne faisons rien. Dites-vous, ma chère fille, si pour pratiquer la sainte pauvreté, il ne faut pas se tenir attentif à recevoir de bon coeur les petites disettes qui nous arrivent, tantôt en ceci, tantôt en cela ? Je lai dit à Philothée; à plus forte raison le doivent faire ceux qui en ont fait le voeu. Cest être pauvre bien agréablement, ou plutôt ce nest pas être pauvre quand rien ne nous manque. Cest sans doute quil ne se faut pas plaindre de tels rencontres, car si nous nous en plaignons, cest une marque que nous ne les aimons pas, et partant nous ne rendons pas notre devoir à la pauvreté. Ce nest pas être pauvre de navoir point dargent quand nous nen avons pas besoin et que rien ne nous manque. Notre glorieux Père saint Augustin dit dans vos Règles que celui-là est plus heureux lequel na pas besoin de beaucoup, que celui qui a besoin de beaucoup de choses de quoi les autres se passent bien. Il y a certes des personnes qui sont toujours en nécessité, parce quils ont besoin de tant de choses pour les contenter que cest grande pitié; et cest ceux-ci qui sont pauvres, pourvu quils ne se procurent pas tant de choses, parce quils ont de la disette de ce quils nont pas et quil semble quils devraient avoir. Ce que jai dit à Philothée est bon pour être pratiqué par les Religieux, excepté certains chapitres, comme sont ceux qui regardent le mariage, les danses, les jeux et semblables; mais tout le reste est très bon. Je lincite donc de 33 prendre amoureusement les occasions quelle rencontrera de pratiquer la pauvreté réelle. Si nous nous procurons dêtre toujours bien pourvus de tout ce qui nous semble aucunement nécessaire, nous ne ressentirons point deffets de la sainte pauvreté. Quant à moi, je ne voudrais pas demander ce de quoi je me pourrais bien passer, pourvu quil napportât un notable détriment à la santé; car pour avoir un peu de froid, pour porter une robe un peu trop courte, ou qui nest pas bien faite assez juste pour moi, je ne ferais nul état de cela. Mais si lon me donnait des chausses qui fussent si étroites ~ quil me fallut demeurer un demi quart dheure à les chausser, jen demanderais dautres, plutôt que de perdre le temps là tous les matins; mais pour porter quelque chose mal accommodée ou qui me blesserait un peu, je nen voudrais rien dire. Or, quant à souffrir le froid, il faut avoir égard à ne pas souffrir des grandes froidures contraires à la santé ; il ne le faut pas faire. Jai dit en deux ou trois lieux de la France une chose que je men vais vous dire maintenant
32. à 34. bas qui fussent si étroits
cest que, pour parvenir à la perfection, il faut vouloir peu et ne demander rien. Il est vrai que cest être bien pauvre dobserver ceci; mais je vous assure que cest un grand secret pour acquérir la perfection, et si caché néanmoins, quil y a peu de personnes qui le sachent, ou, sils le savent, qui en fassent leur profit. Quant à moi, si jétais Religieuse, je ne demanderais rien, au moins si jétais de lhumeur que je suis maintenant, car je ne demande rien à Notre-Seigneur, ni ne veux rien demander. Il y en a qui demandent des croix, et ne leur semble jamais que Notre-Seigneur leur en donnera assez pour satisfaire à leur ferveur; moi, je nen demande point, seulement je désire de me tenir prêt pour porter celles quil plaira à sa Bonté de menvoyer, le plus patiemment et humblement que je pourrai. Jen ferais de même si jétais en Religion: je ne demanderais du tout rien, sinon que je fusse malade, car il faut que les malades demandent confidemment leurs petites nécessités. Je ne demanderais pas même de conununier, excepté en certains jours que la coutume semble nous obliger de le demander, comme celui de la réception à lhabit, de la Profession et de la fête du Patron et je demanderais aussi une aiguille et du filet quand on me commanderait de faire quelque ouvrage, car le commandement qui mest fait de faire louvrage moblige à demander ce qui est requis pour le faire. Non, certes, ma chère fille, je ne demanderais point des mortifications ; je me tiendrais prêt pour bien recevoir celles que vous me feriez, mais je nen demanderais point. Je mamuserais à aller simplement toujours avant en mon chemin, sans mamuser à désirer aucune chose. Vous faites bien de demander à pétrir parce que vous vous sentez assez forte pour cela ; mais moi je le ferais de bon coeur quand on me le commanderait, autrement je ny penserais pas. Enfin, jaimerais mieux porter une petite croix de paille que lon me mettrait sur les épaules sans mon choix, que non pas den aller couper une bien grande dans un bois avec beaucoup de travail, et la porter par après avec une grande peine ; et je croirais, comme il serait véritable, être plus agréable à Dieu avec la croix de paille que non pas avec celle que je me serais fabriquée avec plus de peine et de sueur, parce que je la porterais avec plus de satisfaction pour lamour-propre qui se plaît tant à ses inventions, et si peu à se laisser conduire et gouverner en simplicité, qui est ce que je vous désire le plus. Faire tout simplement tout ce qui nous est commandé ou par les Règles, ou par les Constitutions, ou bien par nos Supérieurs, et puis nous tenir en repos pour tout le reste, tant près de Dieu que nous pourrons. Que dites-vous, ma chère fille, que sur ce que jai dit tantôt quil se fallait mortifier fidèlement, si vous devez vous abstenir ordinairement de manger telle ou telle viande que vous aimez fort ? Si cétait moi, je ne le ferais pas, car nous sommes obligés par la parole sacrée de Notre-Seigneur e de manger ce que lon nous mettra devant ; et cela se fait sans choix. Quand lon me donnerait ce
e. Luc., X, 8.
que jaimerais bien, je le mangerais avec actions de grâces; quand on ne men donnerait pas, je ne men soucierais pas.Mais dites-vous quil y a de deux sortes de viandes en votre portion. Je mangerais toujours ce qui se rencontrerait de mon côté et selon mon appétit ou nécessité, et puis je laisserais le reste, bien que ce fût ce qui serait plus à mon goût; mais si javais bien du dégoût, je choisirais ce que je pourrais mieux manger hors de là, je prendrais sans choix ce qui me serait donné et au même ordre quil me serait donné. Sur le sujet de la pauvreté, jai dit quil est bon de souffrir quelque petite nécessité sans se plaindre, ni désirer, encore moins demander, ce qui nous manque. Celles qui ne le voudront faire peuvent demander ce quelles auront besoin, dautant que les Règles le permettent, et cela nest pas contre la pauvreté ainsi que vous dites ; mais aussi nest-il pas selon icelle, ni selon la perfection. En tâchant de vous accommoder vous ne faites pas mal, pourvu que vous ne vous rendiez trop exactes à la recherche de vos commodités, et que vous vous teniez dans les termes de lobservance pour ce regard 35 ; mais aussi perdons-nous, par ce moyen, des pratiques de vertu qui sont fort propres à notre condition. Non, ma chère Soeur, la charité ne requiert pas que les Soeurs se tiennent en attention pour reconnaître et remarquer si quelque chose ne manque point à quelques-unes, tandis quelles nen ont point de charge ; mais si elles aperçoivent quelque nécessité en une Soeur, elles doivent en avertir la Supérieure tout simplement,
35. à cet égard
sans lagrandir ni diminuer, non plus que si cétait pour elles-mêmes. Vous demandez si cest manquer à lobservance et faire mal que de choisir une serviette plus déliée pour la Supérieure, et ne lui donner pas celle qui se rencontre, sans choix, comme lon fait aux autres Soeurs. A cela, ma chère fille, je vous réponds que ce qui a été fait pour ce regard jusquà présent na pas été mal, mais si est-ce pourtant que désormais il ne le faut plus faire. La Supérieure a ses honneurs et singularités à part : elle est appelée ma Mère, elle a le pouvoir et lautorité de commander et dordonner, et les Soeurs lui obéissent; hors de cela, il ne faut point de singularité, ainsi quil est dit dans les Constitutions, sinon de la nécessité comme les autres Soeurs. Il faut donc conclure maintenant et clore notre Entretien par la recommandation de la simplicité et générosité desprit ; marcher toujours en la voie de notre propre perfection, sans nous amuser en chemin, quel rencontre de contradiction que nous puissions faire, soit de nos propres imperfections, répugnances ou passions immortifiées, soit des autres exercices qui proviennent dailleurs. De quel côté que ce soit, ne nous lassons point de souffrir pour Notre-Seigneur, auquel soit à jamais rendu grâce, gloire et louange par tous les siècles des siècles. Amen.
|